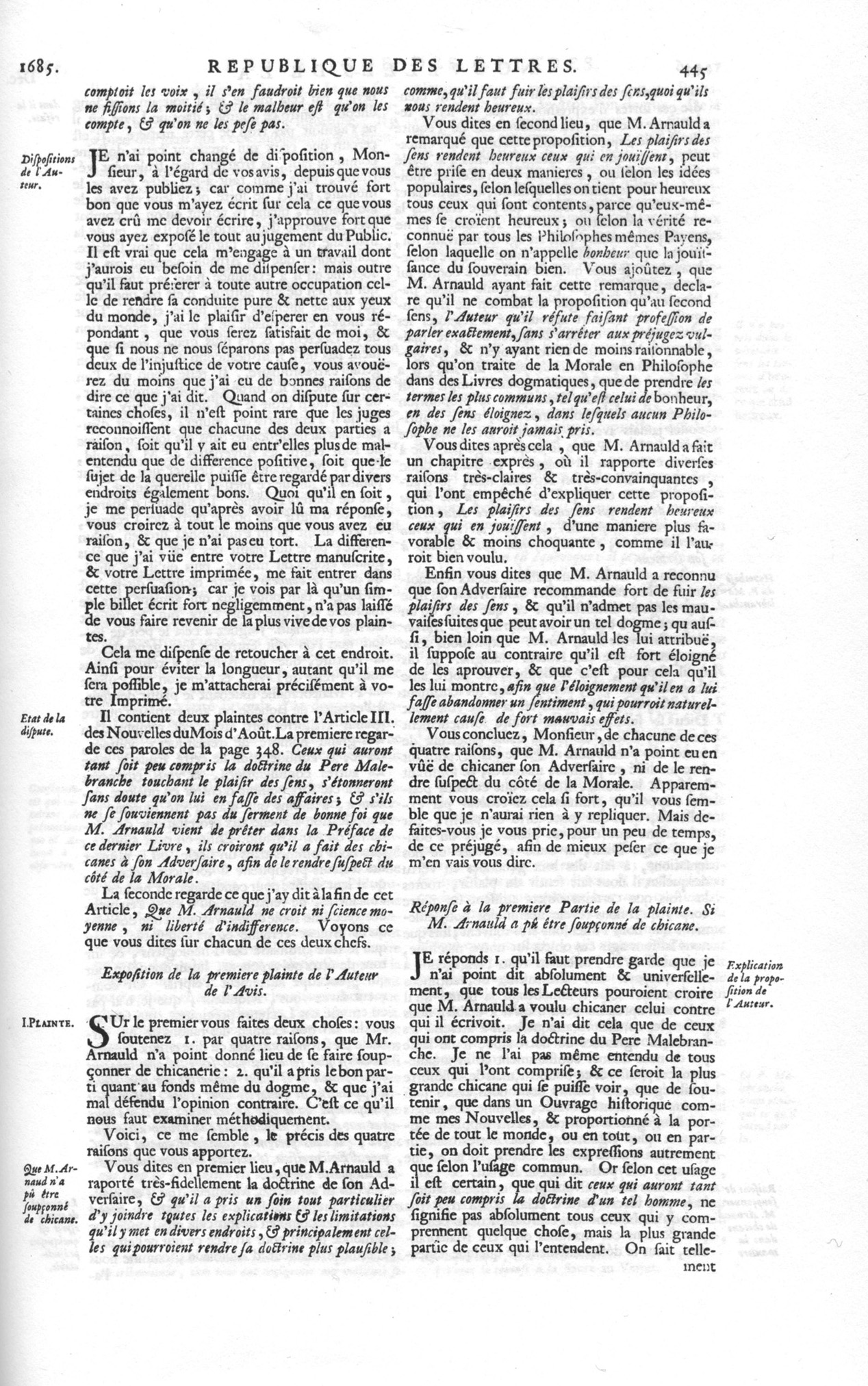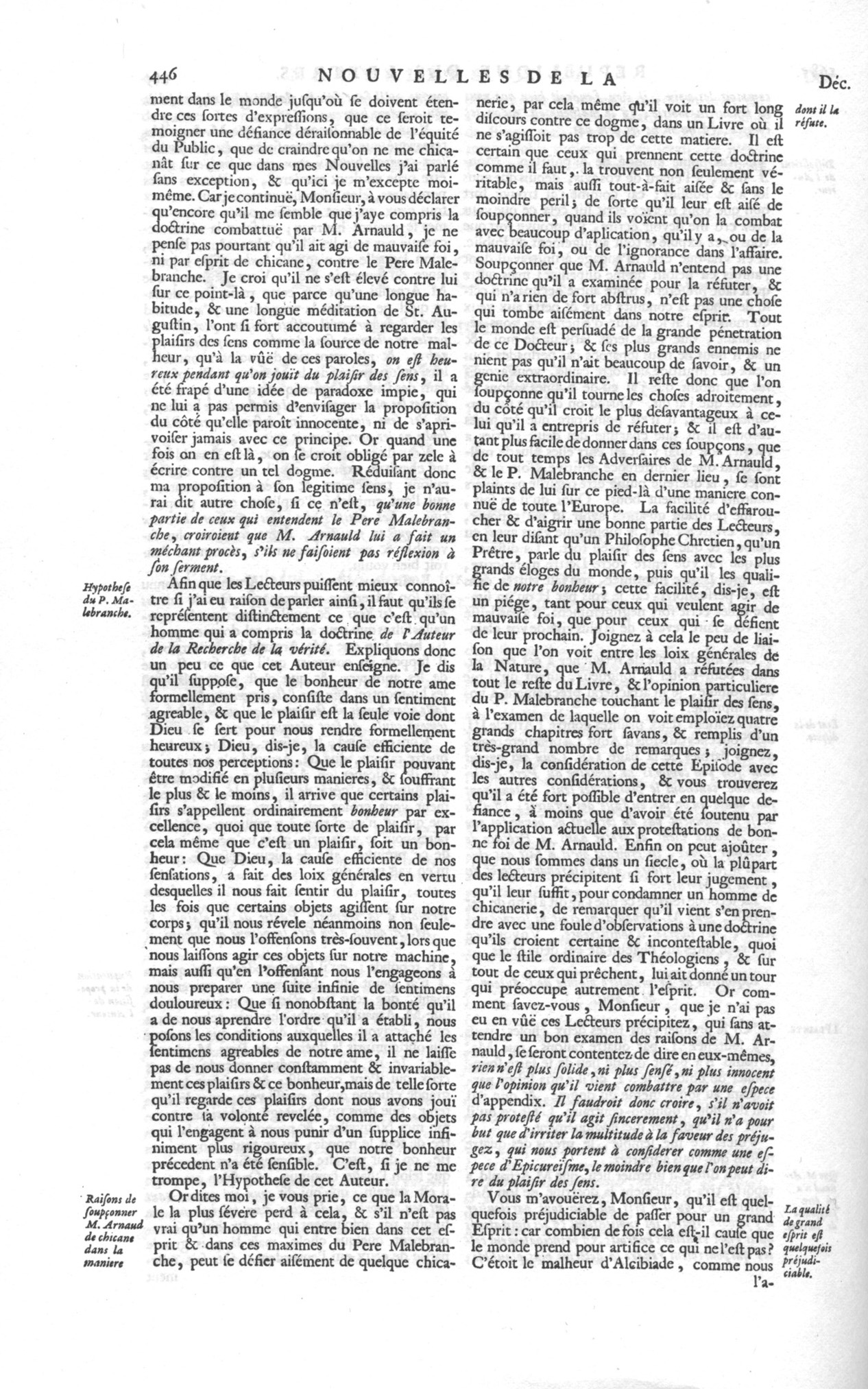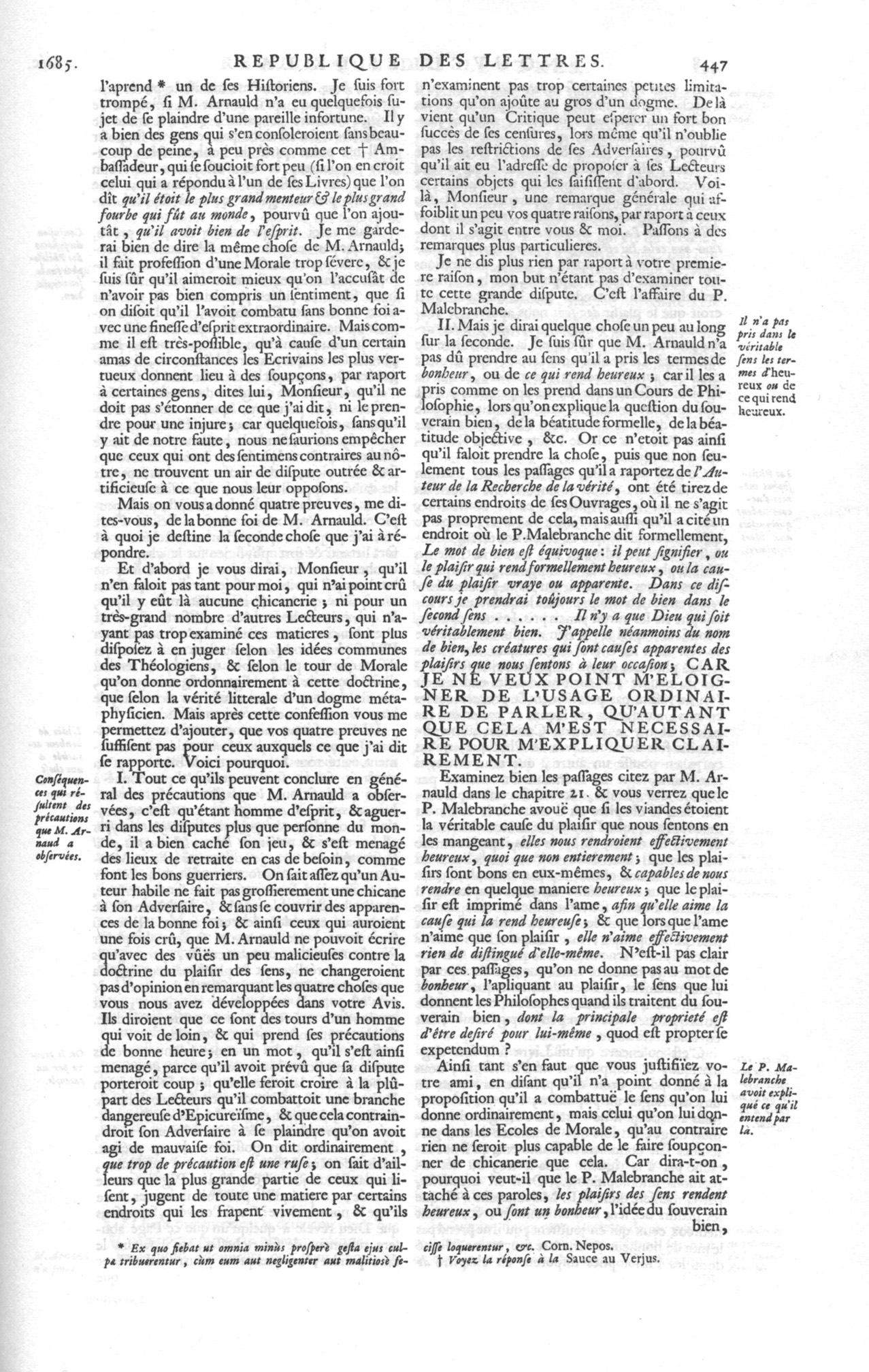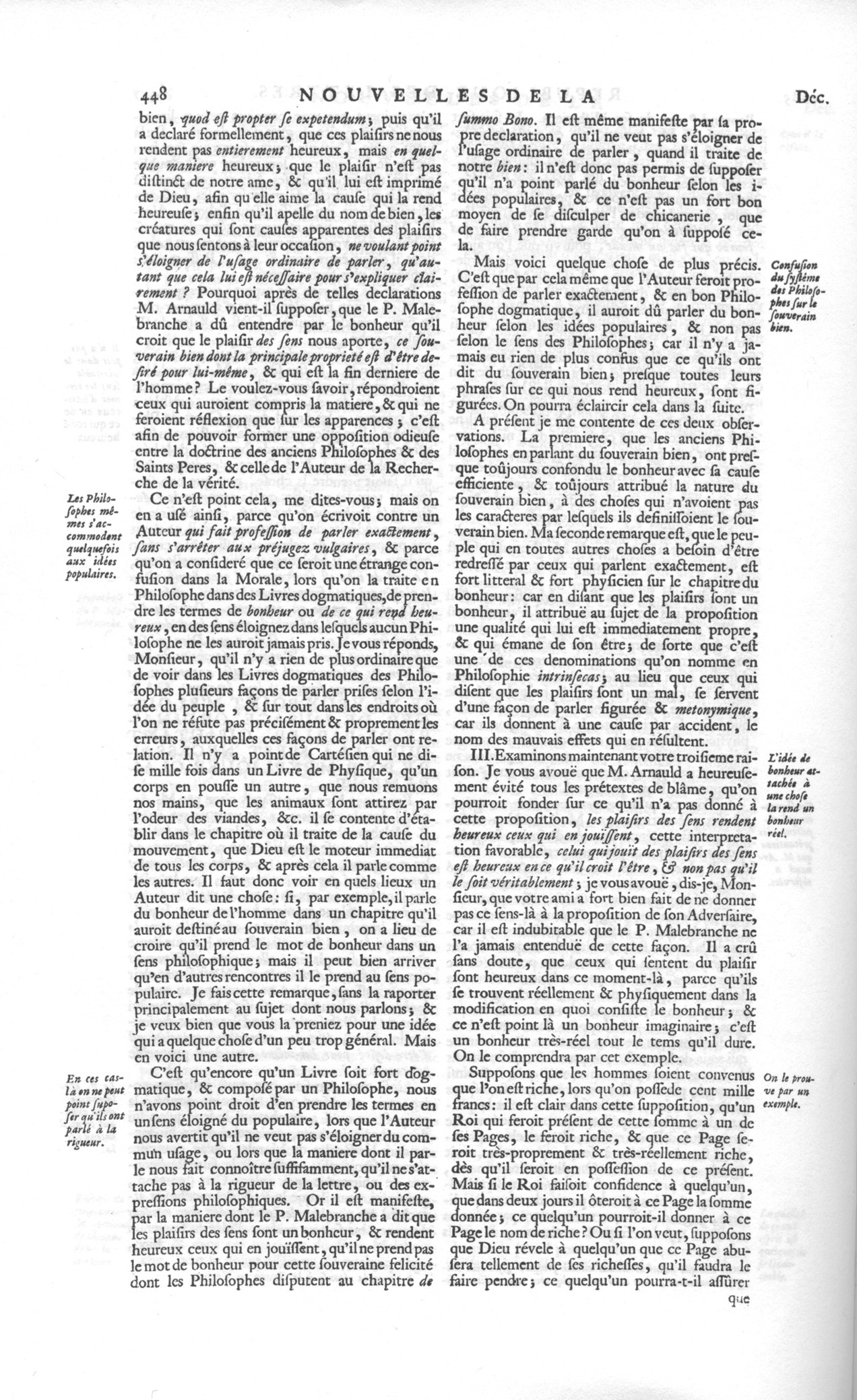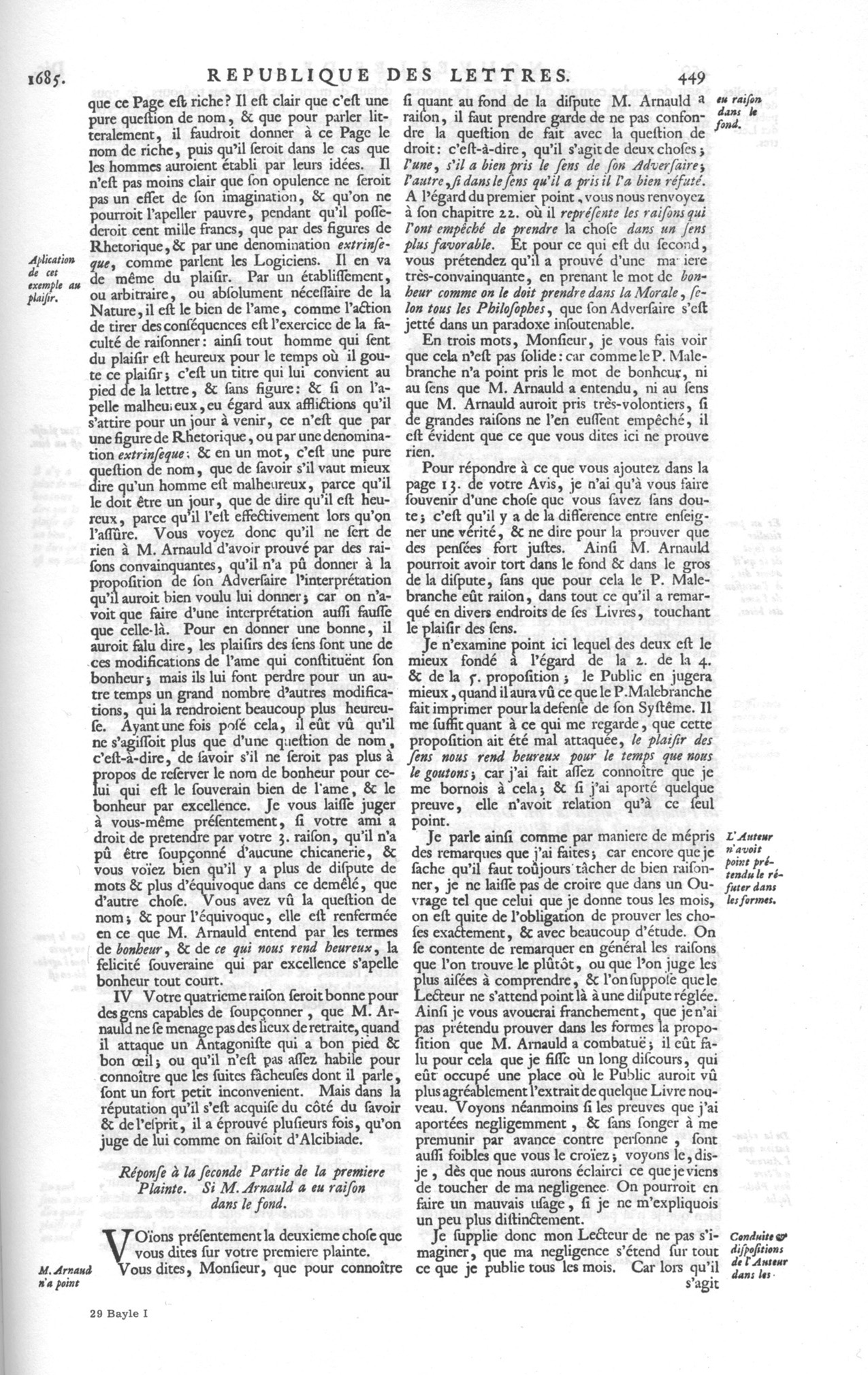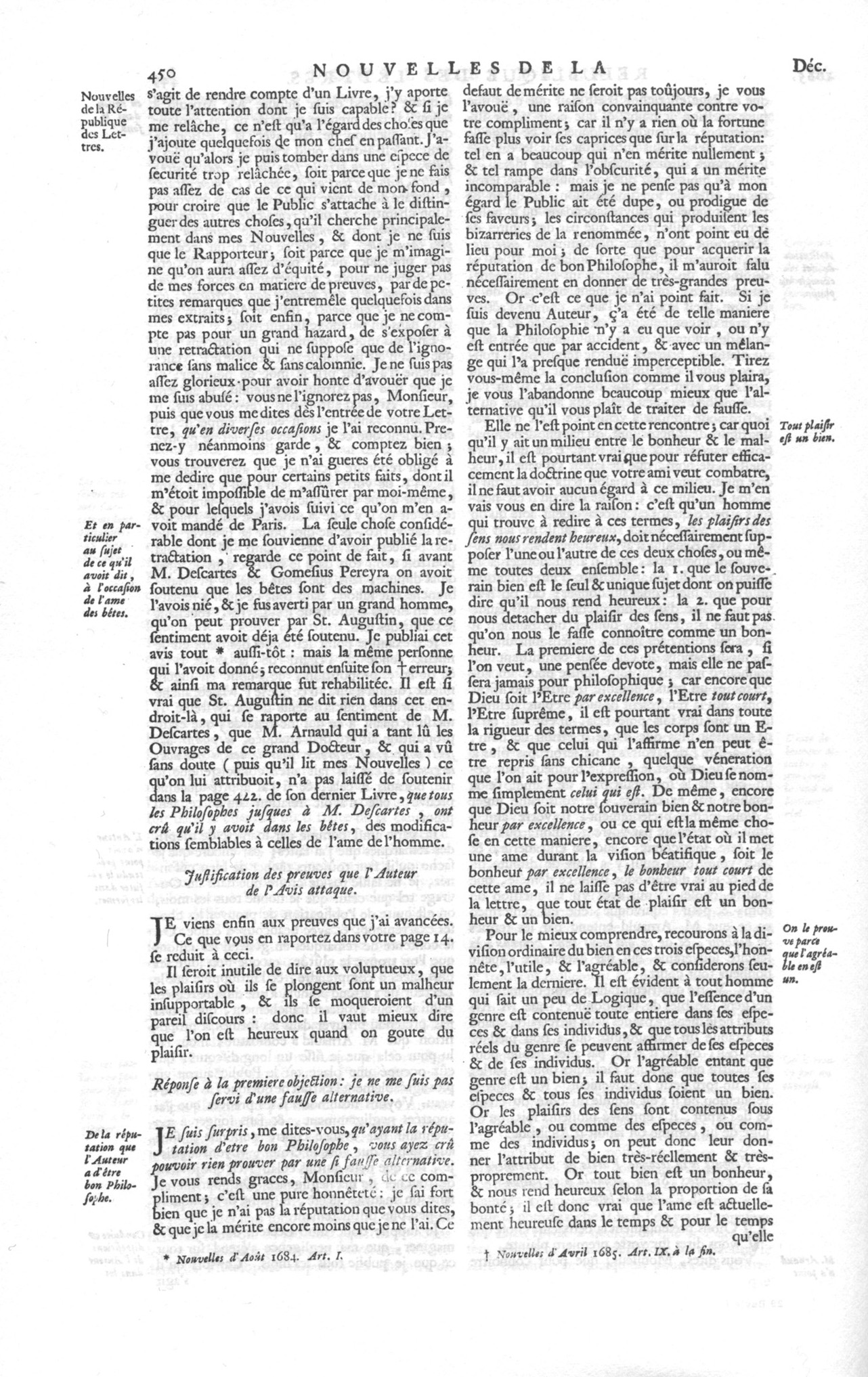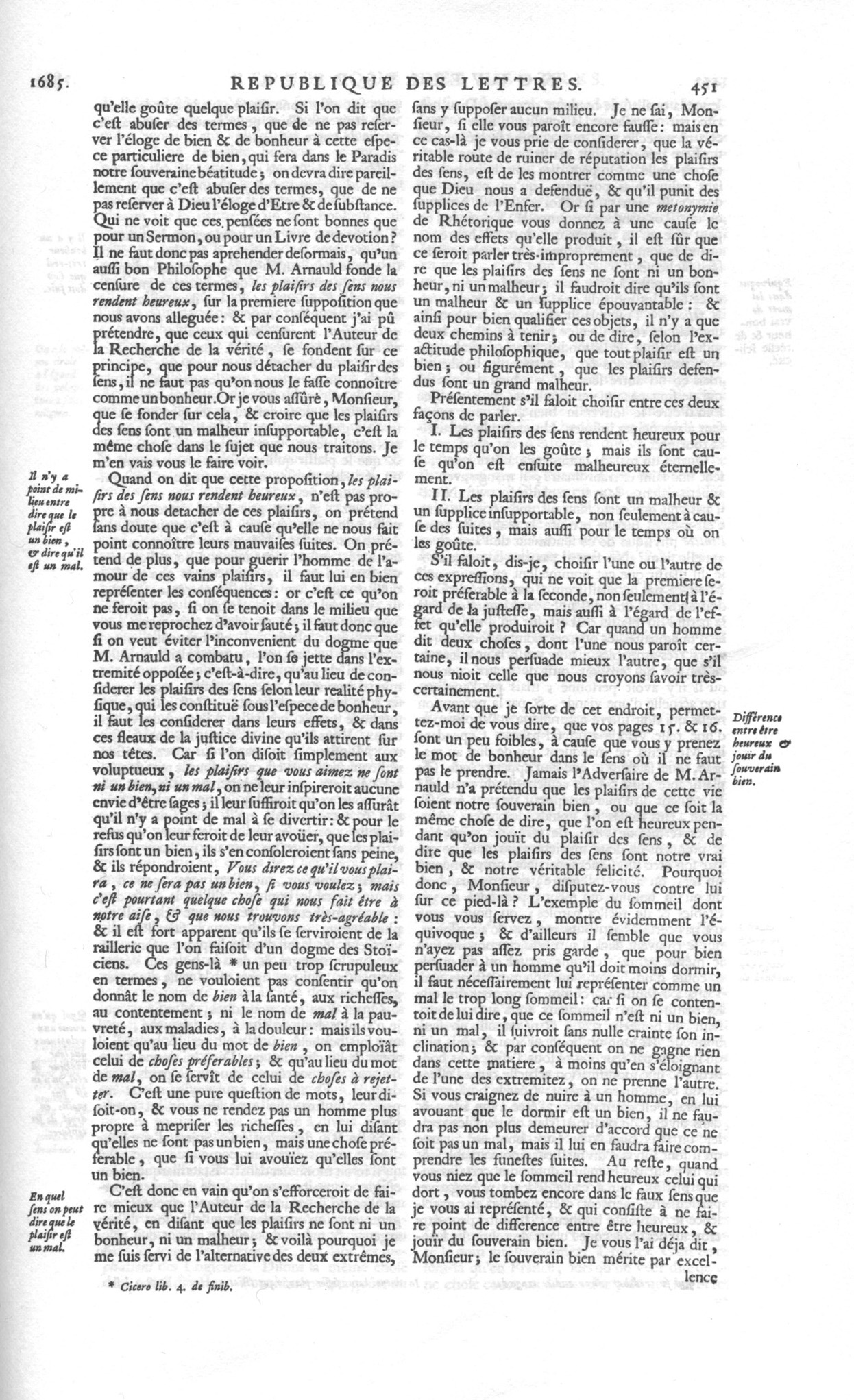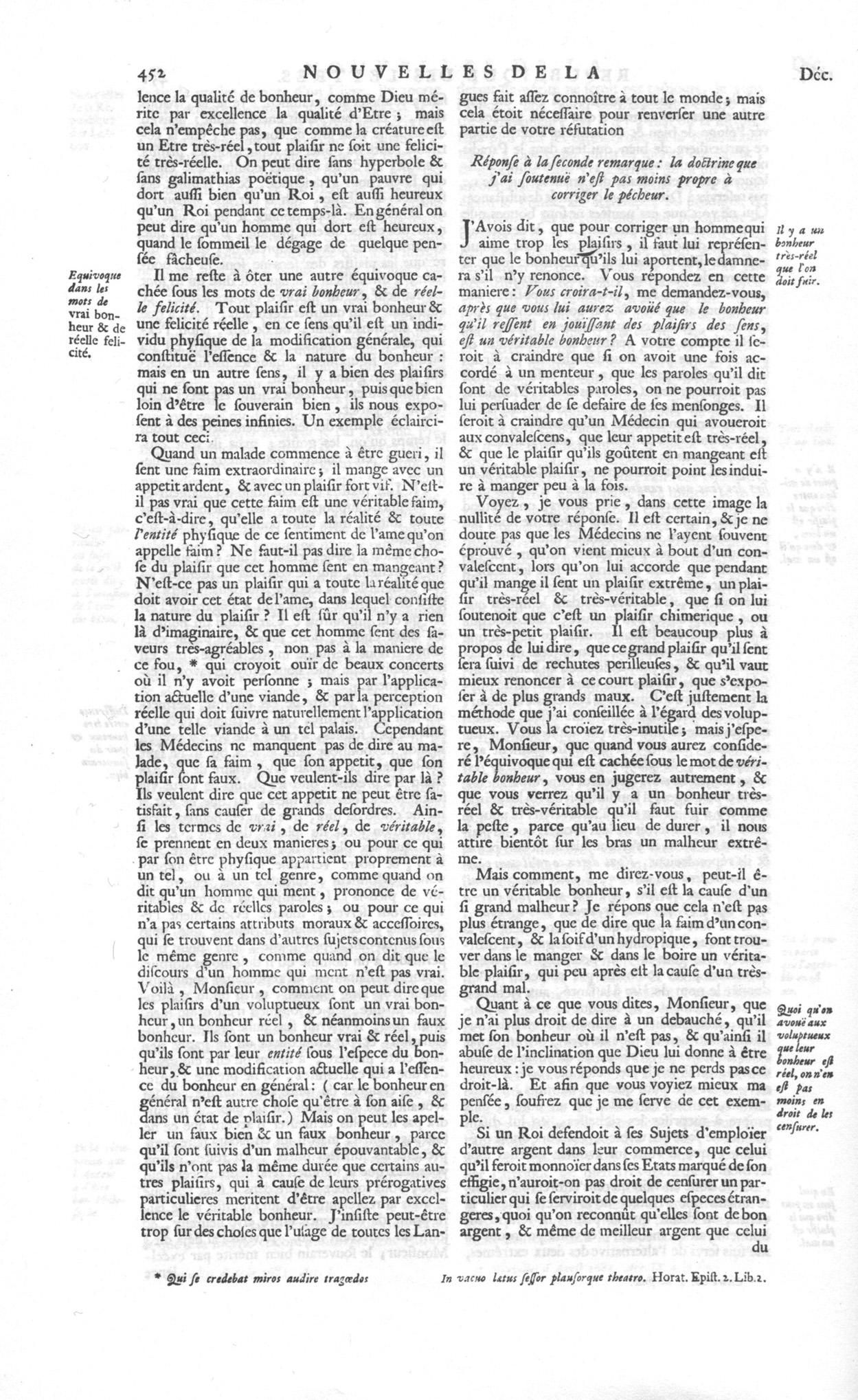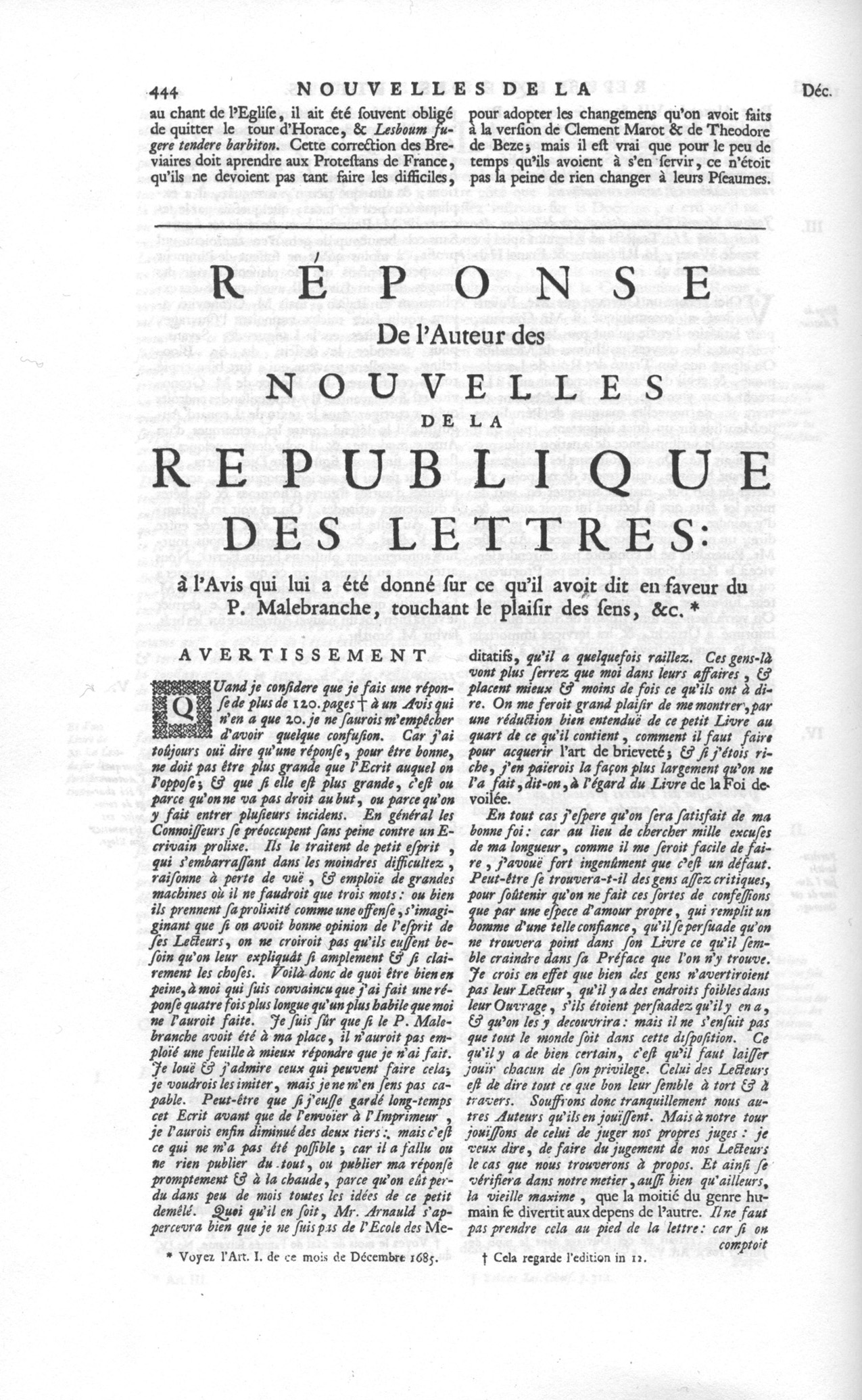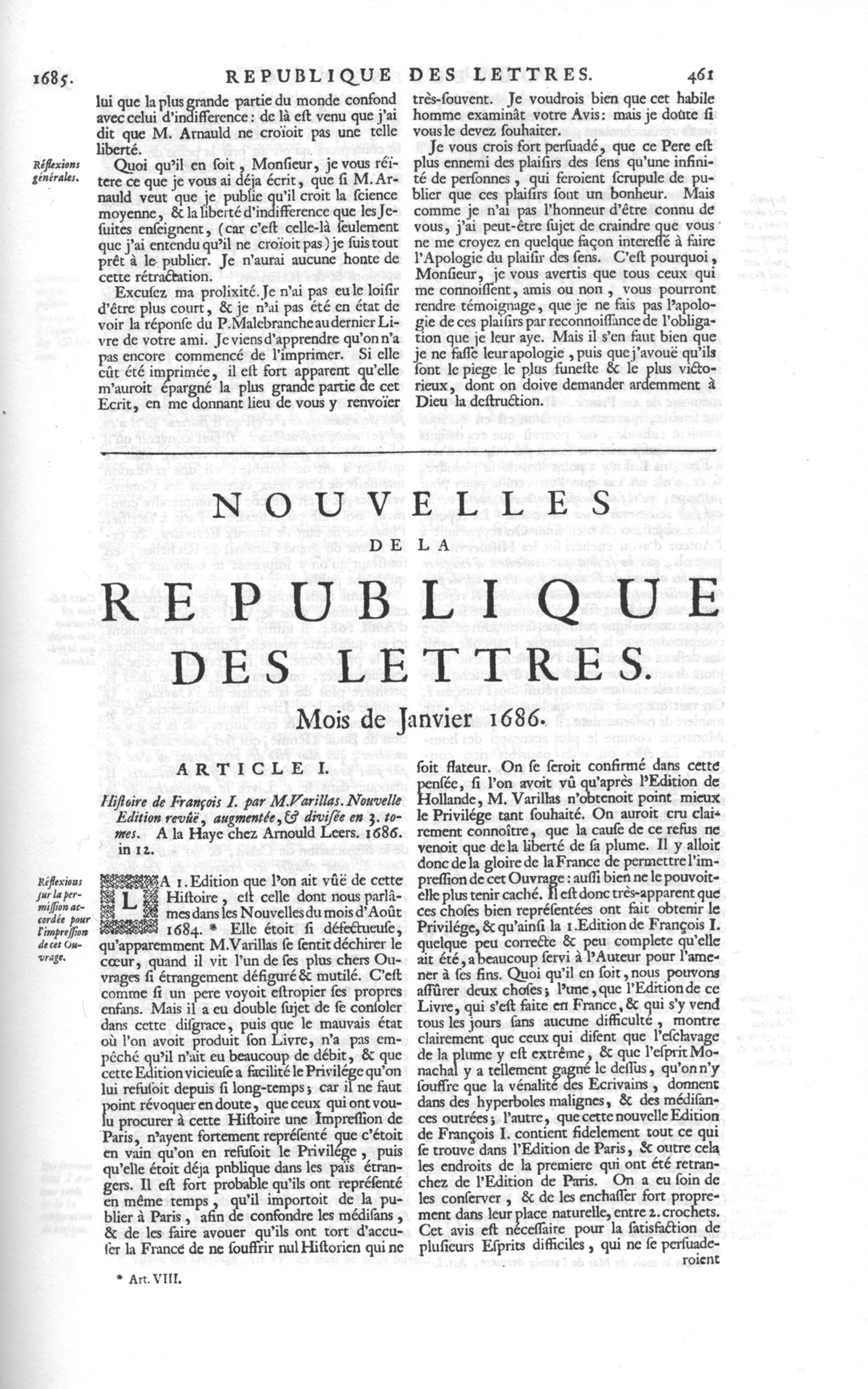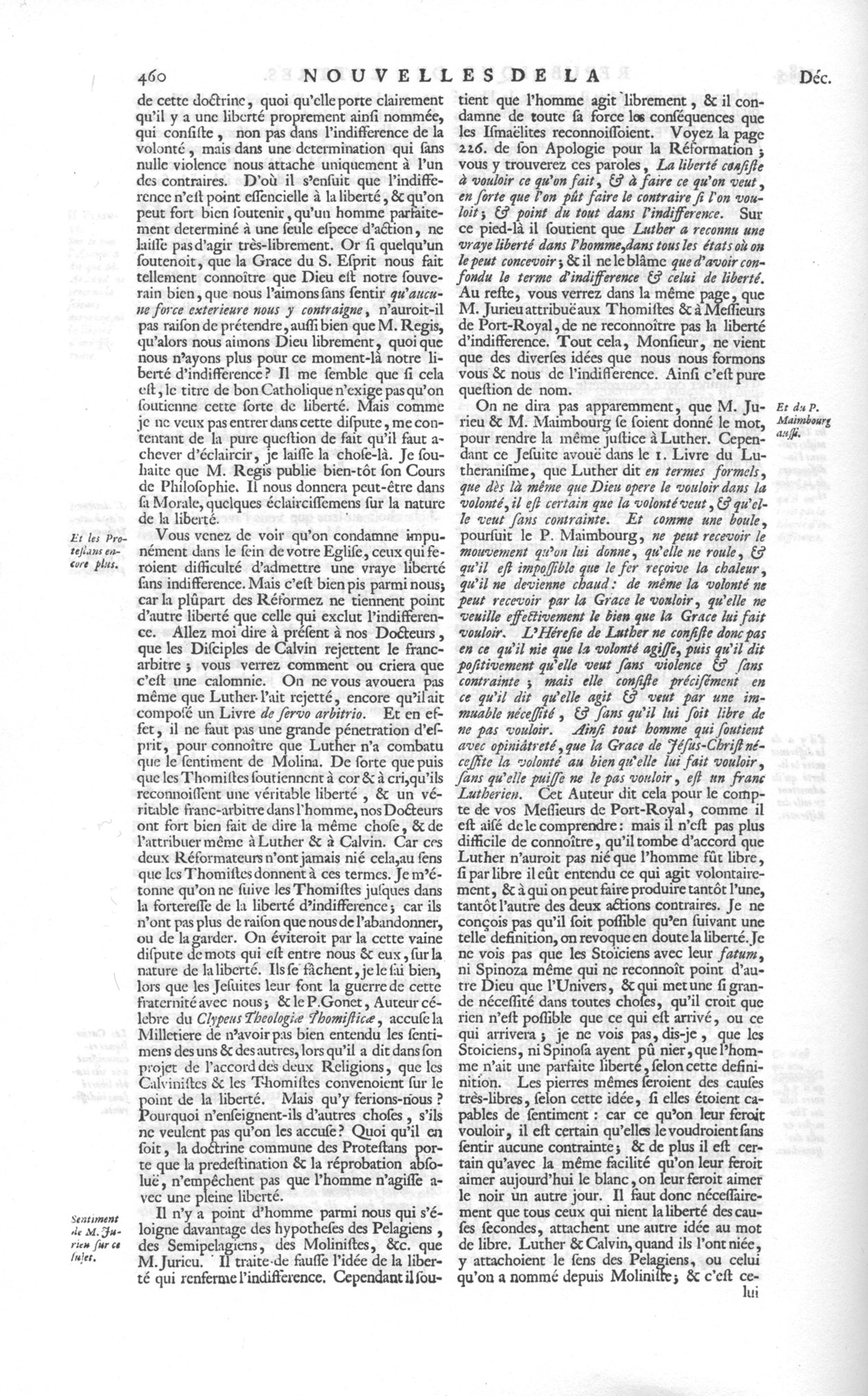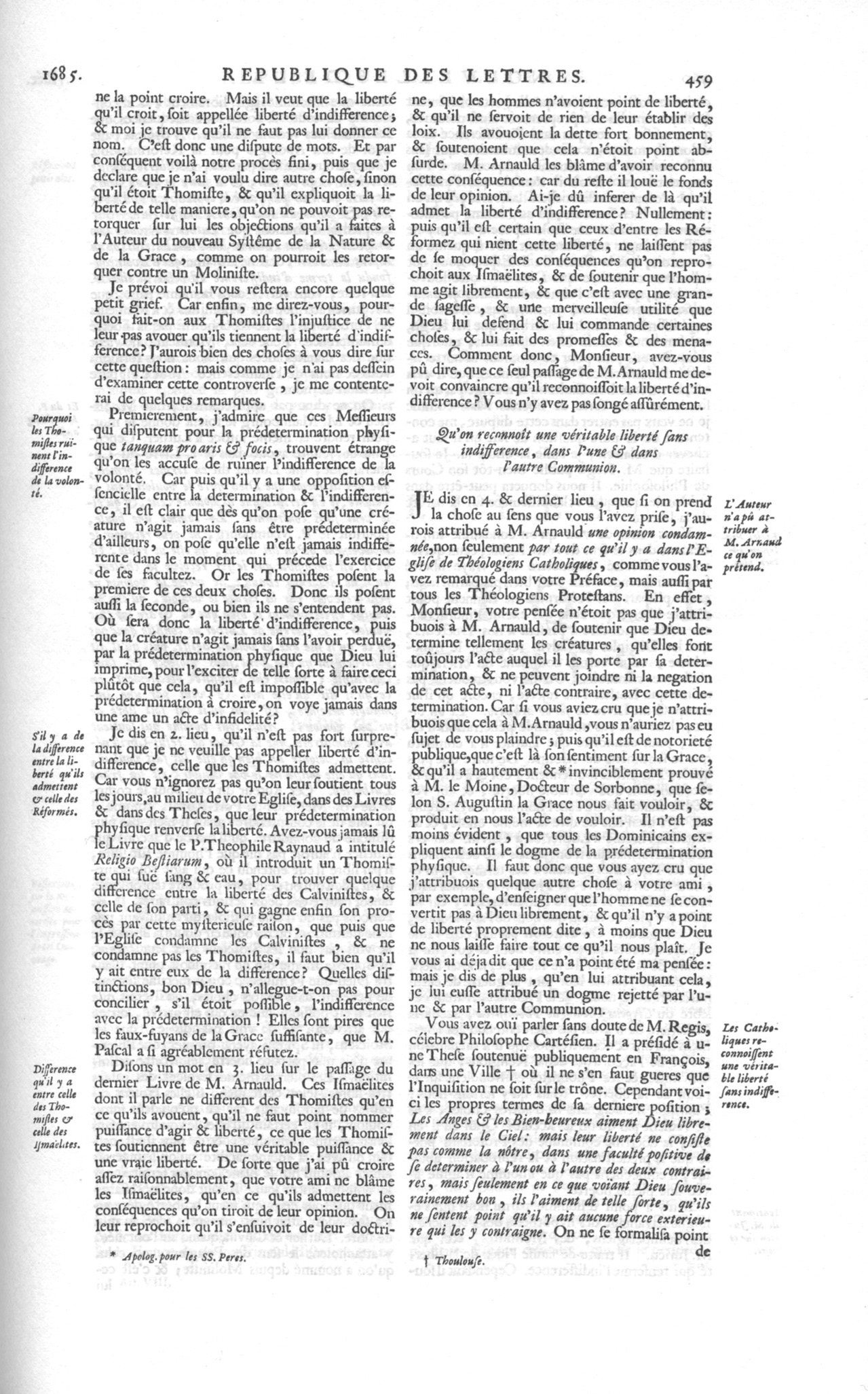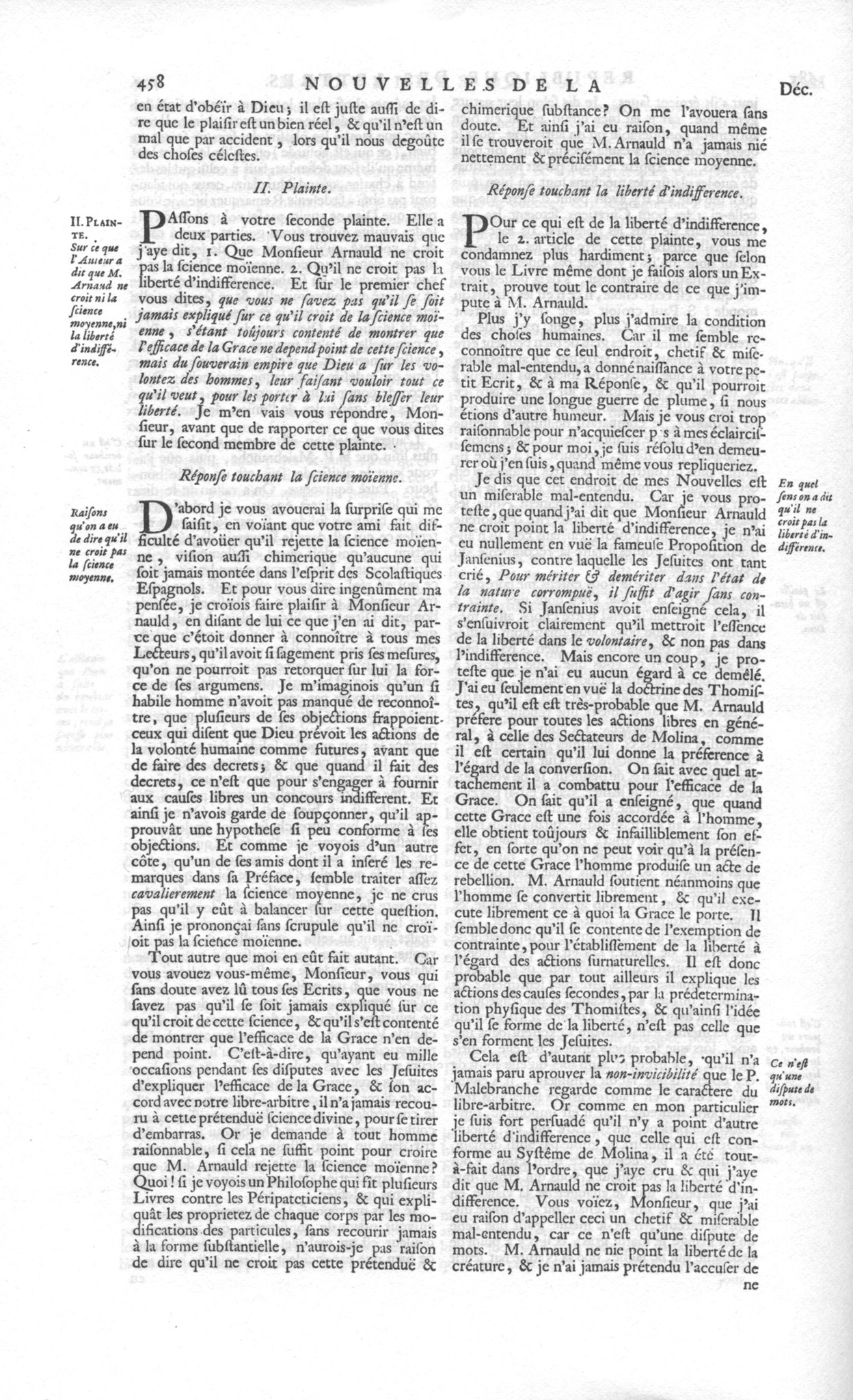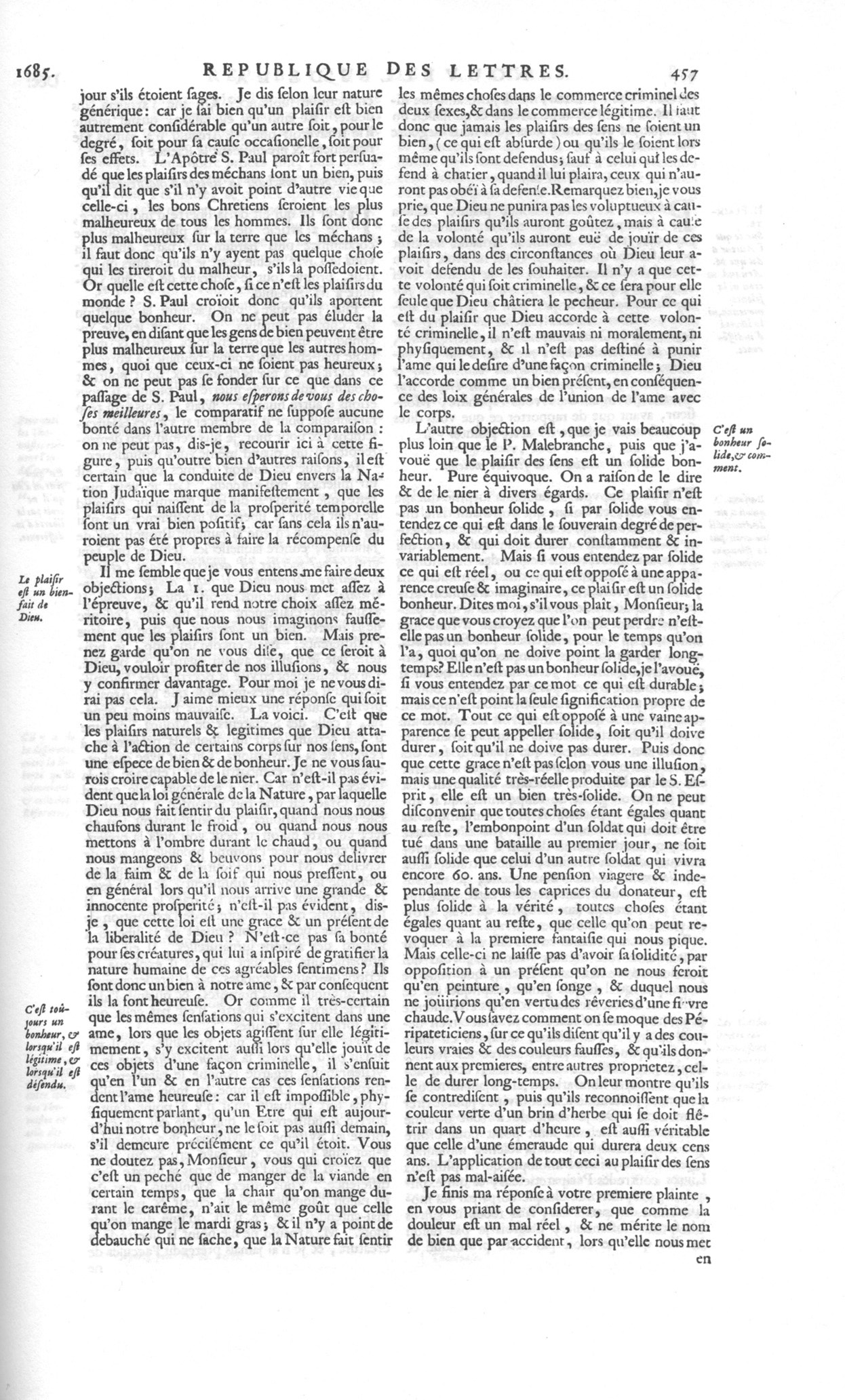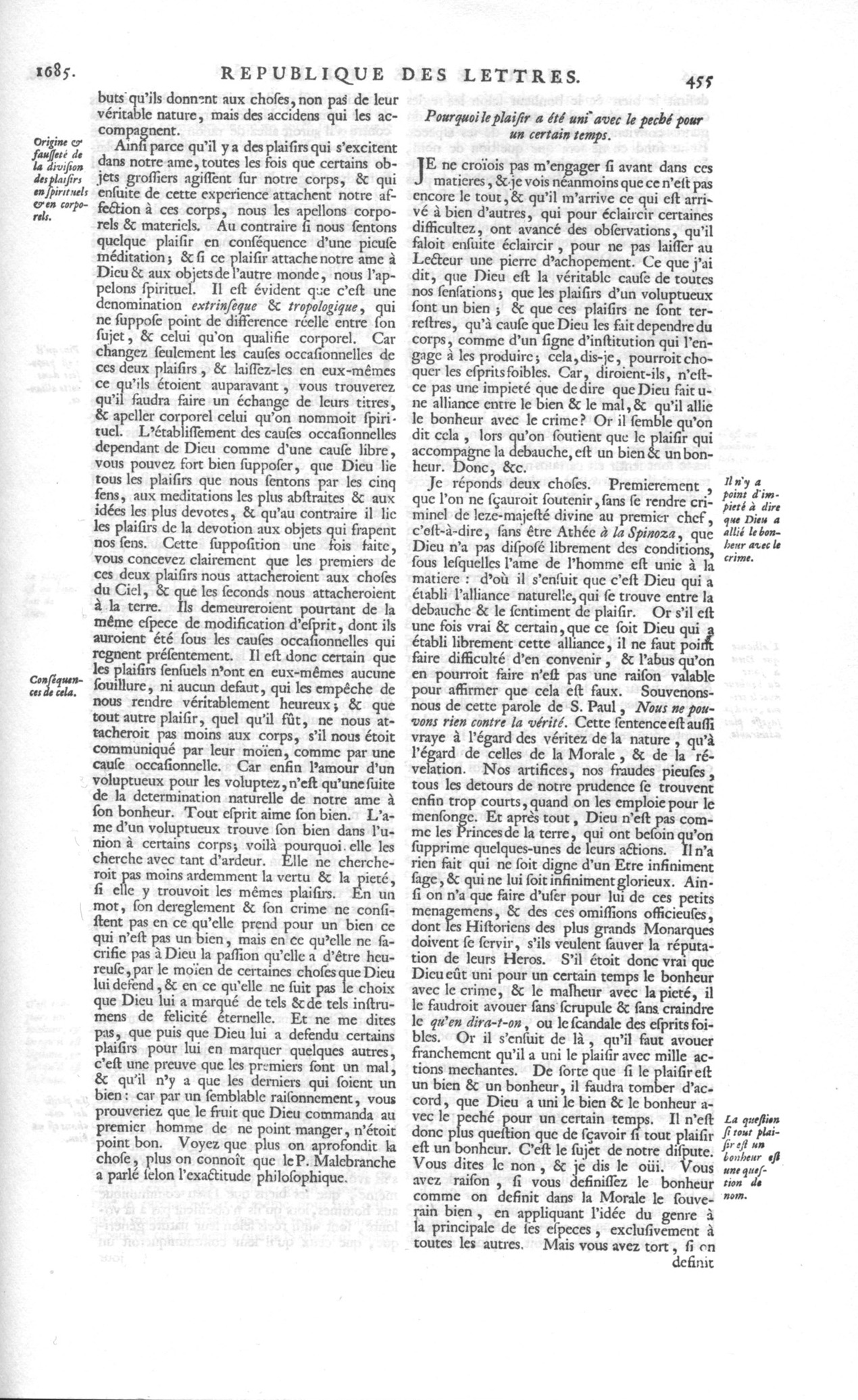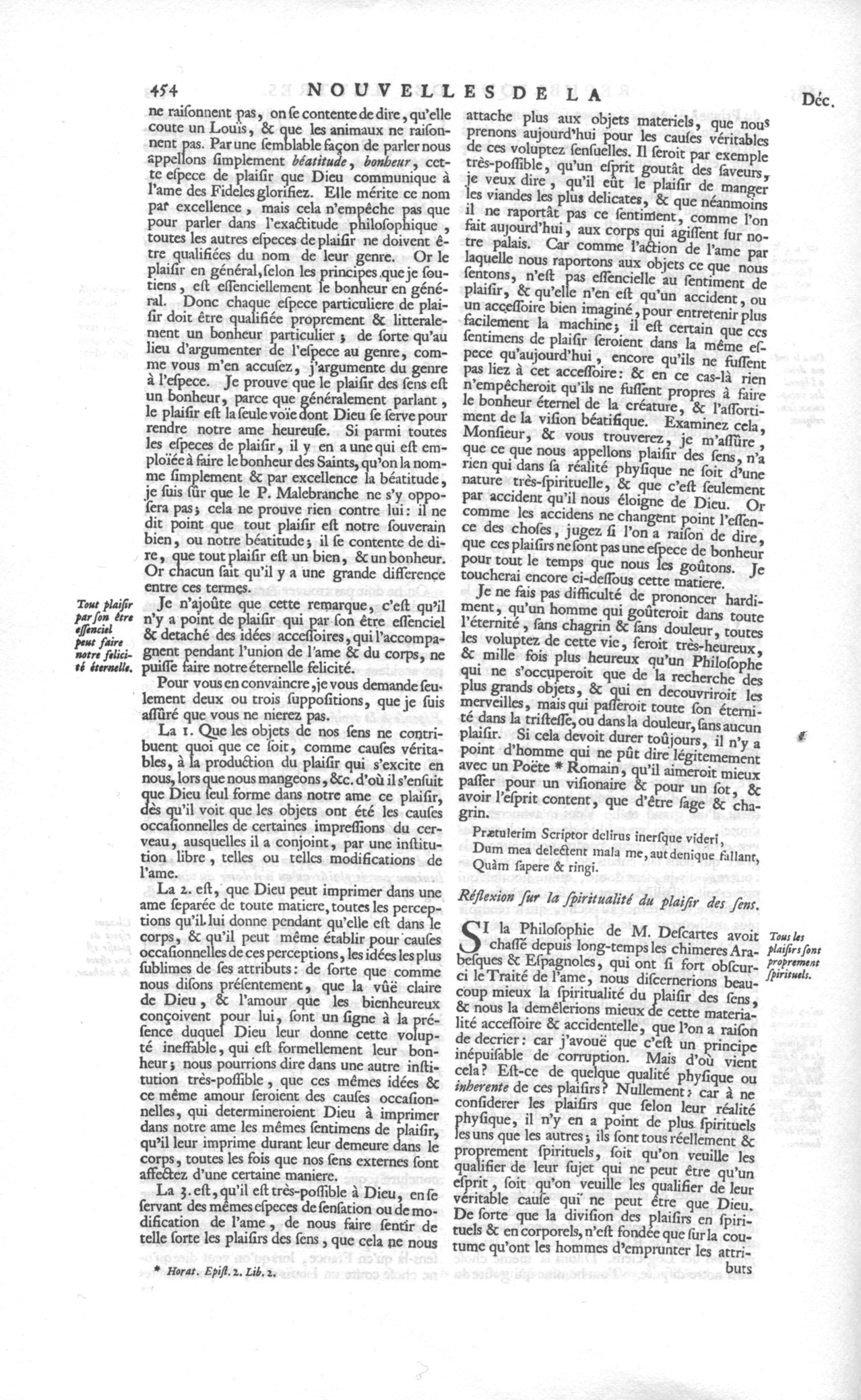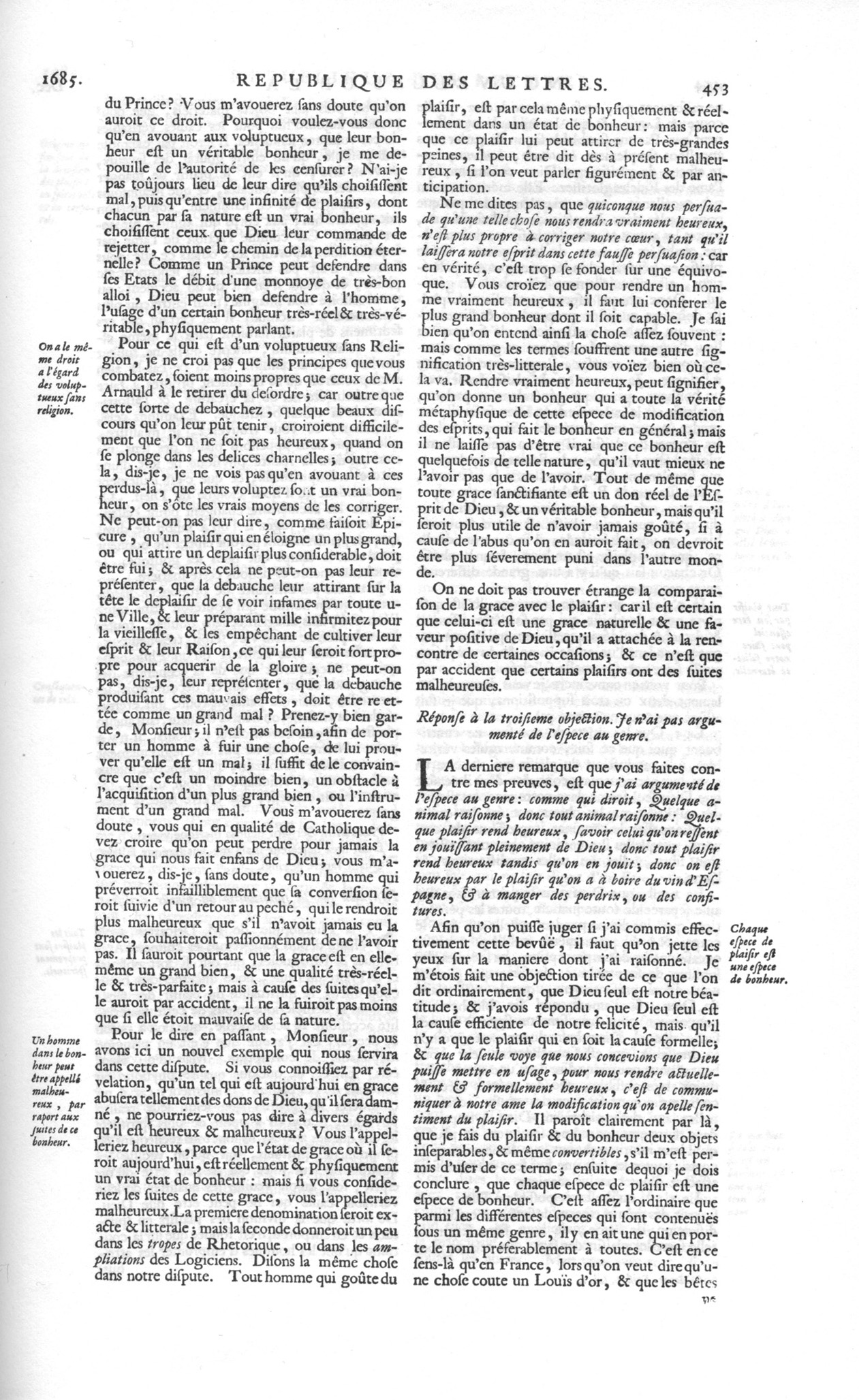Lettre 495 : Pierre Bayle à Antoine Arnauld
Réponse de l’auteur des Nouvelles de la republique des lettres : à l’ Avis qui lui a été donné sur ce qu’il avoit dit en faveur du P[ère] Malebranche, touchant le plaisir des sens, etc.
AVERTISSEMENT
Quand je considere que je fais une réponse de plus de 120 pages à un Avis qui n’en a que 20 [1]. je ne saurois m’empêcher d’avoir quelque confusion. Car j’ai toûjours ouï dire qu’une réponse, pour être bonne, ne doit pas être plus grande que l’écrit auquel on l’oppose ; et que si elle est plus grande, c’est ou parce qu’on ne va pas droit au but, ou parce qu’on y fait entrer plusieurs incidens. En général les connoisseurs se préoccupent sans peine contre un ecrivain prolixe. Ils le traitent de petit esprit, qui s’embarrassant dans les moindres difficultez, raisonne à perte de vuë, et emploïe de grandes machines où il ne faudrait que trois mots : ou bien ils prennent sa prolixité comme une offense, s’imaginant que si on avait une bonne opinion de l’esprit de ses lecteurs, on ne croiroit pas qu’ils eussent besoin qu’on leur expliquât si amplement et si clairement les choses. Voilà donc de quoi être bien en peine, à moi qui suis convaincu que j’ai fait une réponse quatre fois plus longue qu’un plus habile que moi ne l’auroit faite. Je suis sûr que si le P[ère] Malebranche avoit été à ma place, il n’auroit pas emploïé une feuille à mieux répondre que je n’ai fait. Je louë et j’admire ceux qui peuvent faire cela ; je voudrois les imiter, mais je ne m’en sens pas capable. Peut-être que si j’eusse gardé long-temps cet écrit avant que de l’envoïer à l’imprimeur, je l’aurois enfin diminué des deux tiers : mais c’est ce qui ne m’a pas été possible ; car il a fallu ou ne rien publier du tout, ou publier ma réponse promptement et à la chaude, parce qu’on eût perdu dans peu de mois toutes les idées de ce petit demêlé. Quoi qu’il en soit, Mr Arnauld s’appercevra bien que je ne suis pas de l’Ecole des méditatifs, qu’il a quelquefois raillez. Ces gens-là vont plus serrez que moi dans leurs affaires, et placent mieux et moins de fois ce qu’ils ont à dire. On me feroit grand plaisir de me montrer par une réduction bien entenduë de ce petit livre au quart de ce qu’il contient, comment il faut faire pour acquerir l’art de brieveté ; et si j’étois riche, j’en païerois la façon plus largement qu’on ne l’a fait, dit-on, à l’égard du livre de La Foi devoilée [2].
En tout cas j’espere qu’on sera satisfait de ma bonne foi : car au lieu de chercher mille excuses de ma longueur, comme il me seroit facile de faire, j’avouë fort ingenûment que c’est un défaut. Peut-être se trouvera-t-il des gens assez critiques, pour soûtenir qu’on ne fait ces sortes de confessions que par une espece d’amour propre, qui remplit un homme d’une telle confiance, qu’il se persuade qu’on ne trouvera point dans son livre ce qu’il semble craindre dans sa préface que l’on y trouve. Je crois en effet que bien des gens n’avertiroient pas leur lecteur, qu’il y a des endroits foibles dans leur ouvrage, s’ils étoient persuadez qu’il y en a, et qu’on les y decouvrira : mais il ne s’ensuit pas que tout le monde soit dans cette disposition. Ce qu’il y a de bien certain, c’est qu’il faut laisser jouïr chacun de son privilege. Celui des lecteurs est de dire tout ce que bon leur semble à tort et à travers. Souffrons donc tranquillement nous autres auteurs qu’ils en jouïssent. Mais à notre tour jouïssons de celui de juger nos propres juges : je veux dire, de faire du jugement de nos lecteurs le cas que nous trouverons à propos. Et ainsi se vérifiera dans notre metier, aussi bien qu’ailleurs, la vieille maxime, que la moitié du genre humain se divertit aux depens de l’autre. Il ne faut pas prendre cela au pied de la lettre : car si on / comptoit les voix, il s’en faudroit bien que nous ne fissions la moitié ; et le malheur est qu’on les compte, et qu’on ne les pese pas.
[Dispositions de l’auteur.] Je n’ai point changé de disposition, Monsieur, à l’égard de vos avis, depuis que vous les avez publiez ; car comme j’ai trouvé fort bon que vous m’ayez écrit sur cela ce que vous avez crû me devoir écrire, j’approuve fort que vous ayez exposé le tout au jugement du public. Il est vrai que cela m’engage à un travail dont j’aurois eu besoin de me dispenser : mais outre qu’il faut préferer à toute autre occupation celle de rendre sa conduite pure et nette aux yeux du monde, j’ai le plaisir d’esperer en vous répondant, que vous serez satisfait de moi, et que si nous ne nous séparons pas persuadez tous deux de l’injustice de votre cause, vous avouërez du moins que j’ai eu de bonnes raisons de dire ce que j’ai dit. Quand on dispute sur certaines choses, il n’est point rare que les juges reconnoissent que chacune des deux parties a raison, soit qu’il y ait eu entr’elles plus de malentendu que de difference positive, soit que le sujet de la querelle puisse être regardé par divers endroits également bons. Quoi qu’il en soit, je me persuade qu’après avoir lû ma réponse, vous croirez à tout le moins que vous avez eu raison, et que je n’ai pas eu tort. La difference que j’ai vüe entre votre lettre manuscrite, et votre lettre imprimée, me fait entrer dans cette persuasion ; car je vois là qu’un simple billet écrit fort negligemment, n’a pas laissé de vous faire revenir de la plus vive de vos plaintes [3].
Cela me dispense de retoucher à cet endroit. Ainsi pour éviter la longueur, autant qu’il me sera possible, je m’attacherai précisément à votre imprimé.
[Etat de la dispute.] Il contient deux plaintes contre l’article III des Nouvelles du mois d’août. La premiere regarde ces paroles de la page 348. Ceux qui auront tant soit peu compris la doctrine du Pere Malebranche touchant le plaisir des sens, s’etonneront sans doute* qu’on lui en fasse des affaires ; et s’ils ne se souviennent pas du serment de bonne foi que M. Arnauld vient de prêter dans la préface de ce dernier livre, ils croiront qu’il a fait des chicanes à son adversaire, afin de le rendre suspect du côté de la morale.
La seconde regarde ce que j’ay dit à la fin de cet article, Que M. Arnauld ne croit ni science moyenne, ni liberté d’indifference. Voyons ce que vous dites sur chacun de ces deux chefs.
[1. Plainte.] Sur le premier vous faites deux choses : vous soutenez I. par quatre raisons, que Mr Arnauld n’a point donné lieu de se faire soupçonner de chicanerie : 2. qu’il a pris le bon parti quant au fonds même du dogme, et que j’ai mal défendu l’opinion contraire. C’est ce qu’il nous faut examiner méthodiquement.
Voici, ce me semble, le précis des quatre raisons que vous apportez.
[Que M. Arnauld n’a pû être soupçonné de chicane.] Vous dites en premier lieu, que M. Arnauld a raporté très-fidellement la doctrine de son adversaire, et qu’il a pris un soin tout particulier d’y joindre toutes les explications et les limitations qu’il y met en divers endroits, et principalement celles qui pourroient rendre sa doctrine plus plausible ; comme qu’il faut fuir les plaisirs des sens, quoi qu’ils nous rendent heureux.
Vous dites en second lieu, que M. Arnauld a remarqué que cette proposition, Les plaisirs des sens rendent heureux ceux qui en jouïssent, peut être prise en deux manieres, ou selon les idées populaires, selon lesquelles on tient pour heureux tous ceux qui sont contents, parce qu’eux-mêmes se croïent heureux ; ou selon la verité reconnuë par tous les philosophes même payens, selon laquelle on n’appelle bonheur que la jouïssance du souverain bien. Vous ajoütez, que M. Arnauld ayant fait cette remarque, declare qu’il ne combat la proposition qu’au second sens, l’Auteur qu’il réfute faisant profession de parler exactement, sans s’arrêter aux préjugez vulgaires, et n’y ayant rien de moins raisonnable, lors qu’on traite de la morale en philosophie dans des livres dogmatiques, que de prendre les termes les plus communs, tel qu’est celui de bonheur, en des sens éloignez, dans lesquels aucun philosophe ne les auroit jamais pris.
Vous dites après cela, que M. Arnauld a fait un chapitre exprès, où il rapporte diverses raisons très-claires et très-convainquantes, qui l’ont empêché d’expliquer cette proposition, Les plaisirs des sens rendent heureux ceux qui en jouïssent, d’une maniere plus favorable et moins choquante, comme il l’auroit bien voulu.
Enfin vous dites que M. Arnauld a reconnu que son adversaire recommande fort de fuir les plaisirs des sens, et qu’il n’admet pas les mauvaises suites que peut avoir un tel dogme ; qu’aussi, bien loin que M. Arnauld les lui attribuë, il suppose au contraire qu’il est fort éloigné de les a[p]prouver, et que c’est pour cela qu’il les lui montre, afin que l’éloignement qu’il en a lui fasse abandonner un sentiment, qui pourroit naturellement cause[r] de fort mauvais effets.
Vous concluez, Monsieur, de chacune de ces quatre raisons, que M. Arnauld n’a point eu en vûë de chicaner son adversaire, ni de le rendre suspect du côté de la morale. Apparemment vous croïez cela si fort, qu’il vous semble que je n’aurai rien à y repliquer. Mais defaites-vous je vous prie, pour un peu de temps, de ce préjugé, afin de mieux peser ce que je m’en vais vous dire.
Réponse à la premiere partie de la plainte. Si M. Arnauld a pû être soupçonné de chicane.
[Explication de la proposition de l’auteur.] Je réponds I. qu’il faut prendre garde que je n’ai point dit absolument et universellement, que tous les lecteurs pouroient croire que M. Arnauld a voulu chicaner celui contre qui il écrivoit. Je n’ai dit cela que de ceux qui ont compris la doctrine du Pere Malebranche. Je ne l’ai pas même entendu de tous ceux qui l’ont comprise ; et ce seroit la plus grande chicane qui se puisse voir, que de soutenir, que dans un ouvrage historique comme mes Nouvelles, et proportionné à la portée de tous le monde, ou en tout, ou en partie, on doit prendre les expressions autrement que selon l’usage commun. Or selon cet usage il est certain, que qui dit ceux qui auront tant soit peu compris la doctrine d’un tel homme, ne signifie pas absolument tous ceux qui y comprennent quelque chose, mais la plus grande partie de ceux qui l’entendent. On sait telle- / ment dans le monde jusqu’où se doivent étendre ces sortes d’expressions, que ce seroit temoigner une défiance déraisonnable de l’équité du public, que de craindre qu’on ne me chicanât sur ce que dans mes Nouvelles j’ai parlé sans exception, et qu’ici je m’excepte moi-même. Car je continuë, Monsieur, à vous déclarer qu’encore qu’il me semble que j’aye compris la doctrine combattuë par M. Arnauld, je ne pense pas pourtant qu’il ait agi de mauvaise foi, ni par esprit de chicane, contre le Pere Malebranche. Je croi qu’il ne s’est élevé contre lui sur ce point-là, que parce qu’une longue habitude, et une longue méditation de s[ain]t Augustin, l’ont si fort accoutumé à regarder les plaisirs des sens comme la source de notre malheur, qu’à la vûë de ces paroles, on est heureux pendant qu’on jouït du plaisir des sens, il a été frap[p]é d’une idée de
[Hypothese du P[ere] Malebranche.] Afin que les lecteurs puissent mieux connoître si j’ai eu raison de parler ainsi, il faut qu’ils se représentent distinctement ce que c’est qu’un homme qui a compris la doctrine de l’auteur de la Recherche de la vérité. Expliquons donc un peu ce que cet auteur enseigne. Je dis qu’il suppose, que le bonheur de notre ame formellement pris, consiste dans un sentiment agreable, et que le plaisir est la seule voie dont Dieu se sert pour nous rendre formellement heureux ; Dieu, dis-je, la cause efficiente de toutes nos perceptions : Que le plaisir pouvant être modifié en plusieurs manieres, et souffrant le plus et le moins, il arrive que certains plaisirs s’appellent ordinairement bonheur par excellence, quoi que toute sorte de plaisir, par cela même que c’est un plaisir, soit un bonheur : Que Dieu, la cause efficiente de nos sensations, a fait des loix générales en vertu desquelles il nous fait sentir du plaisir, toutes les fois que certains objets agissent sur notre corps ; qu’il nous révele néanmoins non seulement que nous l’offensons très-souvent, lors que nous laissons agir ces objets sur notre machine, mais aussi qu’en l’offensant nous l’engageons à nous preparer une suite infinie de sentimens douloureux : Que si nonobstant la bonté qu’il a de nous aprendre l’ordre qu’il a établi, nous posons les conditions auxquelles il a attaché les sentimens agreables de notre ame, il ne nous laisse pas de nous donner constamment et invariablement ces plaisirs et ce bonheur, mais de telle sorte qu’il regarde ces plaisirs dont nous avons jouï contre la volonté revelée, comme des objets qui l’engagent à nous punir d’un supplice infiniment plus rigoureux, que notre bonheur précedent n’a été sensible. C’est si je ne me trompe, l’hypothese de cet auteur.
[Raisons de soupçonner M. Arnauld de chicane dans la maniere dont il la réfute.] Or dites moi, je vous prie, ce que la morale la plus sévère perd à cela, et s’il n’est pas vrai qu’un homme qui entre bien dans cet esprit et dans ces maximes du Pere Malebranche, peut se défier aisément de quelque chicanerie, par cela même qu’il voit un fort long discours contre ce dogme, dans un livre où il ne s’agissoit pas trop de cette matiere. Il est certain que ceux qui prennent cette doctrine comme il faut, la trouvent non seulement véritable, mais aussi tout-à-fait aisée et sans le moindre peril ; de sorte qu’il leur est aisé de soupçonner, quand ils voient qu’on la combat avec beaucoup d’application, qu’il y a, ou de la mauvaise foi, ou de l’ignorance dans l’affaire. Soupçonner que M. Arnauld n’entend pas une doctrine qu’il a examinée pour la réfuter, et qui n’a rien de fort abstrus, n’est pas une chose qui tombe aisément dans notre esprit. Tout le monde est persuadé de la grande pénetration de ce docteur ; et ses plus grands ennemis ne nient pas qu’il n’ait beaucoup de savoir, et un genie extraordinaire. Il reste donc que l’on soupçonne qu’il tourne les choses adroitement, du côté qu’il croit le plus desavantageux à celui qu’il a entrepris de réfuter ; et il est d’autant plus facile de donner dans ces soupçons, que de tout temps les adversaires de M. Arnauld, et le P[ère] Malebranche en dernier lieu, se sont plaints de lui sur ce pied-là d’une maniere connuë de toute l’Europe. La facilité d’effaroucher et d’aigrir une bonne partie des lecteurs, en leur disant qu’un philosophe chretien, qu’un prêtre, parle du plaisir des sens avec les plus grands éloges du monde, puis qu’il les qualifie de notre bonheur ; cette facilité, dis-je, est un piège, tant pour ceux qui veulent agir de mauvaise foi, que pour ceux qui se défient de leur prochain. Joignez à cela le peu de liaison que l’on voit entre les loix générales de la nature, que M. Arnauld a réfutées dans tout le reste du livre, et l’opinion particuliere du P[ère] Malebranche touchant le plaisir des sens, à l’examen de laquelle on voit emploïez quatre grands chapitres forts savans, et remplis d’un très-grand nombre de remarques ; joignez, dis-je, la considération de cette episode avec les autres considérations, et vous trouverez qu’il a été fort possible d’entrer en quelque defiance, à moins que d’avoir été soutenu par l’application actuelle aux protestations de bonne foi de M. Arnauld. Enfin on peut ajoûter, que nous sommes dans un siecle, où la plûpart des lecteurs précipitent si fort leur jugement, qu’il leur suffit, pour condamner un homme de chicanerie, de remarquer qu’il vient s’en prendre avec une foule d’observations à une doctrine qu’ils croient certaine et incontestable, quoi que le stile ordinaire des théologiens, et sur tout de ceux qui prêchent, lui ait donné un tour qui préoccupe autrement l’esprit. Or comment savez-vous, Monsieur, que je n’ai pas eu en vûë ces lecteurs précipitez, qui sans attendre un bon examen des raisons de M. Arnauld, se seront contentez de dire en eux-mêmes, rien n’est plus solide, ni plus sensé, ni plus innocent que l’opinion qu’il vient combattre par une espece d’appendix. Il faudroit donc croire, s’il n’avoit pas protesté qu’il agit sincerement, qu’il n’a pour but que d’irriter la multitude à la faveur des préjugez, qui nous portent à considerer comme une espece d’épicureïsme, le moindre bien que l’on peut dire du plaisir des sens.
[La qualité de grand esprit est quelquefois préjudiciable.] Vous m’avouërez, Monsieur, qu’il est quelquefois préjudiciable de passer pour un grand esprit : car combien de fois cela est-il cause que le monde prend pour artifice ce qui ne l’est pas ? C’étoit le malheur d’ Alcibiade [4], comme nous / l’aprend un de ses historiens. Je suis fort trompé, si M. Arnauld n’a eu quelquefois sujet de se plaindre d’une pareille infortune. Il y a bien des gens qui s’en consoleroient sans beaucoup de peine, à peu près comme cet ambassadeur, qui se soucioit fort peu (si l’on en croit celui qui a répondu à l’un de ses livres) que l’on dît qu’il étoit le plus grand menteur et le plus grand fourbe qui fût au monde, pourvû que l’on ajoutât, qu’il avoit bien de l’esprit. Je me garderai bien de dire la même chose de M. Arnauld ; il fait profession d’une morale trop sévere, et je suis sûr qu’il aimeroit mieux qu’on l’accusât de n’avoir pas bien compris un sentiment, que si on disoit qu’il l’avoit combattu sans bonne foi avec une finesse d’esprit extraordinaire. Mais comme il est très-possible, qu’à cause d’un certain amas de circonstances les écrivains les plus vertueux donnent lieu à des soupçons, par ra[p]port à certaines gens, dites lui, Monsieur, qu’il ne doit pas s’étonner de ce que j’ai dit, ni le prendre pour une injure ; car quelquefois, sans qu’il y ait de notre faute, nous ne saurions empêcher que ceux qui ont des sentimens contraires au nôtre, ne trouvent un air de dispute outrée et artificieuse à ce que nous leur opposons.
Mais on vous a donné quatre preuves, me dites-vous, de la bonne foi de M. Arnauld. C’est à quoi je destine la seconde chose que j’ai à répondre.
Et d’abord je vous dirai, Monsieur, qu’il n’en faloit pas tant pour moi, qui n’ai point crû qu’il y eût là aucune chicanerie ; ni pour un très-grand nombre d’autres lecteurs, qui n’ayant pas trop examiné ces matieres, sont plus disposez à en juger selon les idées communes des théologiens, et selon le tour de morale qu’on donne ordinnairement à cette doctrine, que selon la vérité litterale d’un dogme métaphysicien. Mais après cette confession vous me permettez d’ajouter, que vos quatre preuves ne suffisent pas pour ceux auxquels ce que j’ai dit se rapporte. Voici pourquoi.
[Conséquences qui résultent des précautions que M. Arnauld a observées.] I. Tout ce qu’ils peuvent conclure en général des précautions que M. Arnauld a observées, c’est qu’étant homme d’esprit, et aguerri dans les disputes plus que personne du monde, il a bien caché son jeu, et s’est menagé des lieux de retraite en cas de besoin, comme font les bons guerriers. On sait assez qu’un auteur habile ne fait pas grossierement une chicane à son adversaire, et sans se couvrir des apparences de la bonne foi ; et ainsi ceux qui auroient une fois crû que M. Arnauld ne pouvoit écrire qu’avec des vûës un peu malicieuses contre la doctrine du plaisir des sens, ne changeroient pas d’opinion en remarquant les quatre choses que vous nous avez développées dans votre Avis. Ils diroient que ce sont des tours d’un homme qui voit de loin, et qui prend ses précautions de bonne heure ; en un mot, qu’il s’est ainsi menagé, parce qu’il avoit prévû que sa dispute porteroit coup ; qu’elle feroit croire à la plûpart des lecteurs qu’il combattoit une branche dangereuse d’épicureïsme, et que cela contraindroit son adversaire à se plaindre qu’on avoit agi de mauvaise foi. On dit ordinairement, que trop de précaution est une ruse ; on sait d’ailleurs que la plus grande partie de ceux qui lisent, jugent de toute une matiere par certains endroits qui les frapent vivement, et qu’ils n’examinent pas trop certaines petites limitations qu’on ajoûte au gros d’un dogme. De là vient qu’un critique peut esperer un fort bon succès de ses censures, lors même qu’il n’oublie pas les restrictions de ses adversaires pourvû qu’il ait eu l’adresse de proposer à ses lecteurs certains objets qui les saisissent d’abord. Voilà, Monsieur, une remarque générale qui affoiblit un peu vos quatre raisons, par rapport à ceux dont il s’agit entre vous et moi. Passons à des remarques plus particulieres.
Je ne dis plus rien par rapport à votre premiere raison, mon but n’étant pas d’examiner toute cette grande dispute. C’est l’affaire du P[ere] Malebranche.
[Il n’a pas pris dans le véritable sens les termes d’heureux ou de ce qui rend heureux.] II. Mais je dirai quelque chose un peu au long sur la seconde. Je suis sûr que M. Arnauld n’a pas dû prendre au sens qu’il a pris les termes de bonheur, ou de ce qui rend heureux ; car il les a pris comme on les prend dans un cours de philosophie, lors qu’on explique la question du souverain bien, de la béatitude formelle, de la béatitude objective, etc. Or ce n’etoit pas ainsi qu’il faloit prendre la chose, puis que non seulement tous les passages qu’il a raportez de l’auteur de La Recherche de la vérité, ont été tirez de certains endroits de ses ouvrages, où il ne s’agit pas proprement de cela, mais aussi qu’il a cité un endroit où le P[ère] Malebranche dit formellement, Le mot de bien est équivoque : il peut signifier, ou le plaisir qui rend formellement heureux, ou la cause du plaisir vraye ou apparente. Dans ce discours je prendrai toûjours le mot de bien dans le second sens... Il n’y a que Dieu qui soit véritablement bien. J’appelle néanmoins du nom de bien, les créatures qui sont causes apparentes des plaisirs que nous sentons à leurs occasions ; CAR JE NE VEUX POINT M’ELOIGNER DE L’USAGE ORDINAIRE DE PARLER, QU’AUTANT QUE CELA M’EST NECESSAIRE POUR M’EXPLIQUER CLAIREMENT.
Examinez bien les passages citez par M. Arnauld dans le chapitre 21 et vous verrez que le P[ère] Malebranche avouë que si les viandes étoient la véritable cause du plaisir que nous sentons en les mangeant, elles nous rendroient effectivement heureux, quoi que non entierement ; que les plaisirs sont bons en eux-mêmes, et capables de nous rendre en quelque maniere heureux ; que le plaisir est imprimé dans l’ame, afin qu’elle aime la cause qui la rend heureuse ; et que lors que l’ame n’aime que son plaisir, elle n’aime effectivement rien de distingué d’elle-même. N’est-il pas clair que ces passages, qu’on ne donne pas au mot de bonheur, l’appliquant au plaisir, le sens que lui donnent les philosophes quand ils traitent du souverain bien, dont la principale proprieté est d’être desiré pour lui-même, quod est propter se expetendum ?
[Le P[ère] Malebranche avoit expliqué ce qu’il entend par là.] Ainsi tant s’en faut que vous justifïez votre ami, en disant qu’il n’a point donné à la proposition qu’il a combattuë le sens qu’on lui donne ordinairement, mais celui qu’on lui donne dans les Ecoles de morale, qu’au contraire rien ne seroit plus capable de le faire soupçonner de chicanerie que cela. Car dira-t-on, pourquoi veut-il que le P[ère] Malebranche ait attaché à ces paroles, les plaisirs des sens rendent heureux, ou sont un bonheur, l’idée du souverain / bien, quod est propter se expetendum ; puis qu’il a declaré formellement, que ces plaisirs ne nous rendent pas entierement heureux, mais en quelque maniere heureux ; que le plaisir n’est pas distinct de notre ame, et qu’il lui est imprimé de Dieu, afin qu’elle aime la cause qui la rend heureuse ; enfin qu’il ap[p]elle du nom de bien, les créatures qui sont causes apparentes des plaisirs que nous sentons à leur occasion, ne voulant point s’éloigner de l’usage ordinaire de parler, qu’autant que cela lui est nécessaire pour s’expliquer clairement ? Pourquoi après de telles declarations M. Arnauld vient-il supposer, que le P[ère] Malebranche a dû entendre par le bonheur qu’il croit que le plaisir des sens nous ap[p]orte, ce souverain bien dont la principale proprieté est d’être desiré pour lui-même, et qui est la fin derniere de l’homme ? Le voulez-vous savoir, répondroient ceux qui auroient compris la matiere, et qui ne feroient réflexion que sur les apparences ; c’est afin de pouvoir former une opposition odieuse entre la doctrine des anciens philosophes et des Saints Peres, et celle de l’auteur de La Recherche de la vérité.
[Les philosophes mêmes s’accommodent quelquefois aux idées populaires.] Ce n’est point cela, me dites-vous ; mais on en a usé ainsi, parce qu’on écrivoit contre un auteur qui fait profession de parler exactement, sans s’arrêter aux préjugez vulgaires, et parce qu’on a consideré que ce seroit une étrange confusion dans la morale, lors qu’on la traite en philosophe dans des livres dogmatiques, de prendre les termes de bonheur ou de ce qui rend heureux, en des sens éloignez dans lesquels aucun philosophe ne les auroit jamais pris. Je vous réponds, Monsieur, qu’il n’y a rien de plus ordinaire que de voir dans les livres dogmatiques des philosophes plusieurs façons de parler prises selon l’idée du peuple, et sur tout dans les endroits où l’on ne réfute pas précisément et proprement les erreurs, auxquelles ces façons de parler ont relation. Il n’y a point de cartésien qui ne dise mille fois dans un livre de physique, qu’un corps en pousse un autre, que nous remuons nos mains, que les animaux sont attirez par l’odeur des viandes, etc. Il se contente d’établir dans le chapitre où il traite de la cause du mouvement, que Dieu est le moteur immediat de tous les corps, et après cela il parle comme les autres. Il faut donc voir en quels lieux un auteur dit une chose : si, par exemple, il parle du bonheur de l’homme dans un chapitre qu’il auroit destiné au souverain bien, on a lieu de croire qu’il prend le mot de bonheur dans un sens philosophique ; mais il peut bien arriver qu’en d’autres rencontres il le prend au sens populaire. Je fais cette remarque, sans la rapporter principalement au sujet dont nous parlons ; et je veux bien que vous la preniez pour une idée qui a quelque chose d’un peu trop général. Mais en voici une autre.
[En ces cas-là on ne peut point sup[p]oser qu’ils ont parlé à la rigueur.] C’est qu’encore qu’un livre soit fort dogmatique, et composé par un philosophe, nous n’avons point droit d’en prendre les termes en un sens éloigné du populaire, lors que l’auteur nous avertit qu’il ne veut pas s’éloigner du commun usage, ou lors que la maniere dont il parle nous fait connoître suffisamment, qu’il ne s’attache pas à la rigueur de la lettre, ou des expressions philosophiques. Or il est manifeste, par la maniere dont le P[ère] Malebranche a dit que les plaisirs des sens sont un bonheur, et rendent heureux ceux qui en jouïssent, qu’il ne prend pas le mot de bonheur pour cette souveraine felicité dont les philosophes disputent au chapitre de summo Bono. Il est même manifeste par sa propre declaration, qu’il ne veut pas s’éloigner de l’usage ordinaire de parler, quand il traite de notre bien : il n’est donc pas permis de supposer qu’il n’a point parlé du bonheur selon les idées populaires, et ce n’est pas un fort bon moyen de se disculper de chicanerie, que de faire prendre garde qu’on à supposé cela.
[Confusion du systême des philosophes sur le souverain bien.] Mais voici quelque chose de plus précis. C’est que par cela même que l’auteur feroit profession de parler exactement, et en bon philosophe dogmatique, il auroit dû parler du bonheur selon les idées populaires, et non pas selon le sens des philosophes ; car il n’y a jamais eu rien de plus confus que ce qu’ils ont dit du souverain bien ; presque toutes leurs phrases sur ce qui nous rend heureux, sont figurées. On pourra éclaircir cela dans la suite.
A présent je me contente de ces deux observations. La premiere, que les anciens philosophes en parlant du souverain bien, ont presque toûjours confondu le bonheur avec sa cause efficiente, et toûjours attribué la nature du souverain bien, à des choses qui n’avoient pas les caracteres par lesquels ils definissoient le souverain bien. Ma seconde remarque est, que le peuple qui en toutes autres choses a besoin d’être redressé par ceux qui parlent exactement, est fort litteral et fort physicien sur le chapitre du bonheur : car en disant que les plaisirs sont un bonheur, il attribuë au sujet de la proposition une qualité qui lui est immediatement propre, et qui émane de son être ; de sorte que c’est une de ces denominations qu’on nomme en philosophie intrinsecas ; au lieu que ceux qui disent que les plaisirs sont un mal, se servent d’une façon de parler figurée et metonymique, car ils donnent à une cause par accident, le nom des mauvais effets qui en résultent.
[L’idée de bonheur attachée à une chose la rend un bonheur réel.] III Examinons maintenant votre troisieme raison. Je vous avouë que M. Arnauld a heureusement évité tous les prétextes de blâme, qu’on pourroit fonder sur ce qu’il n’a pas donné à cette proposition, les plaisirs des sens rendent heureux ceux qui en jouïssent, cette interpretation favorable, celui qui jouït des plaisirs des sens est heureux en ce qu’il croit l’être, et non pas qu’il le soit véritablement ; je vous avouë, dis-je, Monsieur, que votre ami a fort bien fait de ne donner pas ce sens-là à la proposition de son adversaire, car il est indubitable que le P[ère] Malebranche ne l’a jamais entenduë de cette façon. Il a crû sans doute, que ceux qui sentent du plaisir sont heureux dans ce moment-là, parce qu’ils se trouvent réellement et physiquement dans la modification en quoi consiste le bonheur ; et ce n’est point là un bonheur imaginaire ; c’est un bonheur très-réel tout le tems qu’il dure. On le comprendra par cet exemple.
[On le prouve par un exemple.] Supposons que les hommes soient convenus que l’on est riche, lors qu’on possede cent mille francs : il est clair dans cette supposition, qu’un roi qui feroit présent de cette somme à un de ses pages, le feroit riche, et que ce page seroit très-proprement et très-réellement riche, dès qu’il seroit en possession de ce présent. Mais si le roi faisoit confidence à quelqu’un, que dans deux jours il ôteroit à ce page la somme donnée ; ce quelqu’un pourroit-il donner à ce page le nom de riche ? Ou si l’on veut, supposons que Dieu révele à quelqu’un que ce page abusera tellement de ses richesses, qu’il faudra le faire pendre ; ce quelqu’un pourra-t-il assûrer / que ce page est riche ? Il est clair que c’est une pure question de nom, et que pour parler litteralement, il faudroit donner à ce page le nom de riche, puis qu’il seroit dans le cas que les hommes auroient établi par leurs idées. Il n’est pas moins clair que son opulence ne seroit pas un effet de son imagination, et qu’on ne pouroit l’ap[p]eller pauvre, pendant qu’il possederoit cent mille francs, que par des figures de rhetorique, et par une denomination extrinseque, comme parlent les logiciens.
[Ap[p]lication de cet exemple au plaisir.] Il en va de même du plaisir. Par un établissement, ou arbitraire, ou absolument nécessaire de la nature, il est le bien de l’ame, comme l’action de tirer des conséquences est l’exercice de la faculté de raisonner : ainsi tout homme qui sent du plaisir est heureux pour le temps où il goute ce plaisir ; c’est un titre qui lui convient au pied de la lettre, et sans figure : et si on l’ap[p]elle malheureux, eu égard aux afflictions qu’il s’attire pour un jour à venir, ce n’est que par une figure de rhetorique, ou par une denomination extrinseque : et en un mot, c’est une pure question de nom, que de savoir s’il vaut mieux dire qu’un homme est malheureux, parce qu’il le doit être un jour, que de dire qu’il est heureux, parce qu’il l’est effectivement lors qu’on l’assûre. Vous voyez donc qu’il ne sert de rien à M. Arnauld d’avoir prouvé par des raisons convainquantes, qu’il n’a pû donner à la proposition de son adversaire l’interprétation qu’il auroit bien voulu lui donner ; car on n’avoit que faire d’une interprétation aussi fausse que celle-là. Pour en donner une bonne, il auroit fal[l]u dire, les plaisirs des sens sont une de ces modifications de l’ame qui constituënt son bonheur, mais ils lui font perdre pour un autre temps un grand nombre d’autres modifications, qui la rendroient beaucoup plus heureuse. Ayant une fois posé cela, il eût vû qu’il ne s’agissoit plus que d’une question de nom, c’est-à-dire, de savoir s’il ne seroit pas plus à propos de reserver le nom de bonheur pour celui qui est le souverain bien de l’ame, et le bonheur par excellence. Je vous laisse juger à vous-même présentement, si votre ami a droit de pretendre par votre 3. raison, qu’il n’a pû être soupçonné d’aucune chicanerie, et vous voïez bien qu’il y a plus de dispute de mots et plus d’équivoque dans ce demêlé, que d’autre chose. Vous avez vû la question de nom ; et pour l’équivoque, elle est renfermée en ce que M. Arnauld entend par les termes de bonheur, et de ce qui nous rend heureux, la felicité souveraine qui par excellence s’ap[p]elle bonheur tout court.
IV Votre quatrieme raison seroit bonne pour des gens capables de soupçonner, que M. Arnauld ne se menage pas des lieux de retraite, quand il attaque un antagoniste qui a bon pied et bon œil ; ou qu’il n’est pas assez habile pour connoître que les suites fâcheuses dont il parle, sont un fort petit inconvenient. Mais dans la réputation qu’il s’est acquise du côté du savoir et de l’esprit, il a éprouvé plusieurs fois, qu’on juge de lui comme on faisoit d’Alcibiade [5].
Réponse à la seconde partie de la premiere plainte. Si M. Arnauld a eu raison dans le fond.
[M. Arnauld n’a point eu raison dans le fond.] Voïons présentement la deuxieme chose que vous dites sur votre premiere plainte. Vous dites, Monsieur, que pour connoître si quant au fond de la dispute M. Arnauld a raison, il faut prendre garde de ne pas confondre la question de fait avec la question de droit : c’est-à-dire, qu’il s’agit de deux choses ; l’une, s’il a bien pris le sens de son adversaire ; l’autre, si dans le sens qu’il a pris il l’a bien réfuté. A l’égard du premier point, vous nous renvoyez à son chapitre 22. où il représente les raisons qui l’ont empêché de prendre la chose dans un sens plus favorable. Et pour ce qui est du second, vous prétendez qu’il a prouvé d’une maniere très-convainquante, en prenant le mot de bonheur comme on le doit prendre dans la morale, selon tous les philosophes, que son adversaire s’est jetté dans un paradoxe insoutenable.
En trois mots, Monsieur, je vous fais voir que cela n’est pas solide : car comme le P[ère] Malebranche n’a point pris le mot de bonheur, ni au sens que M. Arnauld a entendu, ni au sens que M. Arnauld auroit pris très-volontiers, si de grandes raisons ne l’en eussent empêché, il est évident que ce que vous dites ici ne prouve rien.
Pour répondre à ce que vous ajoutez dans la page 13. de votre Avis, je n’ai qu’à vous faire souvenir d’une chose que vous savez sans doute ; c’est qu’il y a de la difference entre enseigner une vérité, et ne dire pour la prouver que des pensées forts justes. Ainsi M. Arnauld pourroit avoir tort dans le fond et dans le gros de la dispute, sans que pour cela le P[ère] Malebranche eût raison, dans tout ce qu’il a remarqué en divers endroits de ses livres, touchant le plaisir des sens.
Je n’examine point ici lequel des deux est le mieux fondé à l’égard de la 2. de la 4. et de la 5. proposition ; le public en jugera mieux, quand il aura vû ce que le P[ère] Malebranche fait imprimer pour la defense de son systême. Il me suffit quant à ce qui me regarde, que cette proposition ait été mal attaquée, le plaisir des sens nous rend heureux pour le temps que nous le goutons ; car j’ai fait assez connoître que je me bornois à cela ; et si j’ai ap[p]orté quelque preuve, elle n’avoit relation qu’à ce seul point.
[L’auteur n’avoit point prétendu le réfuter dans les formes.] Je parle ainsi comme par maniere de mépris des remarques que j’ai faites ; car encore que je sache qu’il faut toûjours tâcher de bien raisonner, je ne laisse pas de croire que dans un ouvrage tel que celui que je donne tous les mois, on est quit[t]e de l’obligation de prouver les choses exactement, et avec beaucoup d’étude. On se contente de remarquer en général les raisons que l’on trouve le plûtôt, ou que l’on juge les plus aisées à comprendre, et l’on suppose que le lecteur ne s’attend point là à une dispute réglée. Ainsi je vous avouerai franchement, que je n’ai pas prétendu prouver dans les formes la proposition que M. Arnauld a combatuë ; il eût fallu pour cela que je fisse un long discours, qui eût occupé une place où le public auroit vû plus agréablement l’extrait de quelque livre nouveau. Voyons néanmoins si les preuves que j’ai ap[p]ortées negligemment, et sans songer à me premunir par avance contre personne, sont aussi foibles que vous le croïez ; voyons le, dis-je, dès que nous aurons éclairci ce que je viens de toucher de ma negligence. On pourroit en faire un mauvais usage, si je ne m’expliquois un peu plus distinctement.
[Conduite et dispositions de l’auteur dans les Nouvelles de la république des lettres.] Je supplie donc mon lecteur de ne pas s’imaginer, que ma negligence s’étend sur tout ce que je publie tous les mois. Car lors qu’il / s’agit de rendre compte d’un livre, j’y ap[p]orte toute l’attention dont je suis capable. Et si je me relâche, ce n’est qu’a l’égard des choses que j’ajoute quelquefois de mon chef en passant. J’avouë qu’alors je puis tomber dans une espece de securité trop relâchée, soit parce que je ne fais pas assez de cas de ce qui vient de mon fond, pour croire que le public s’attache à le distinguer des autres choses, qu’il cherche principalement dans mes Nouvelles, et dont je ne suis que le rapporteur ; soit parce que je m’imagine qu’on aura assez d’équité, pour ne juger pas de mes forces en matiere de preuves, par de petites remarques que j’entremêle quelquefois dans mes extraits ; soit enfin, parce que je ne compte pas pour un grand hazard, de s’exposer à une retractation qui ne suppose que de l’ignorance sans malice et sans calomnie. Je ne suis pas assez glorieux pour avoir honte d’avouër que je me suis abusé : vous ne l’ignorez pas, Monsieur, puis que vous dites dès l’entrée de votre lettre, qu’en diverses occasions je l’ai reconnu. Prenez-y néanmoins garde, et comptez bien ; vous trouverez que je n’ai gueres été obligé à me dedire que pour certains petits faits, dont il m’étoit impossible de m’assûrer par moi-même, et pour lesquels j’avois suivi ce qu’on m’en avoit mandé de Paris [6].
[Et en particulier au sujet de ce qu’il avoit dit, à l’occasion de l’ame des bêtes.] La seule chose considérable dont je me souvienne d’avoir publié la retractation, regarde ce point de fait, si avant M. Descartes et Gomesius Pereyra on avoit soutenu que les bêtes sont des machines. Je l’avoit nié, et je fus averti par un grand homme [7], qu’on peut prouver par s[ain]t Augustin , que ce sentiment avoit déja été soutenu. Je publiai cet avis tout aussi-tôt : mais la même personne qui l’avoit donné ; reconnut ensuite son erreur ; et ainsi ma remarque fut rehabilitée. Il est si vrai que s[ain]t Augustin ne dit rien dans cet endroit-là, qui se rap[p]orte au sentiment de M. Descartes, que M. Arnauld qui a tant lû les ouvrages de ce grand docteur, et qui a vû sans doute (puis qu’il lit mes Nouvelles) ce qu’on lui attribuoit, n’a pas laissé de soutenir dans la page 442. de son dernier livre, que tous les philosophes jusques à M. Descartes, ont crû qu’il y avoit dans les bêtes , des modifications semblables à celles de l’ame de l’homme.
Justification des preuves que l’auteur de l’ Avis attaque.
Je viens enfin aux preuves que j’ai avancées. Ce que vous en raportez dans votre page 14. se reduit à ceci.
Il seroit inutile de dire aux voluptueux, que les plaisirs où ils se plongent sont un malheur insupportable, et ils se moqueroient d’un pareil discours : donc il vaut mieux dire que l’on est heureux quand on goute du plaisir.
Réponse à la premiere objection : je ne me suis pas servi d’une fausse alternative.
[De la réputation que l’auteur a d’être bon philosophe.] Je suis surpris, me dites-vous, qu’ayant la réputation d’etre bon philosophe, vous avez crû pouvoir rien prouver par une si fausse alternative. Je vous rends graces, Monsieur, de ce compliment ; c’est une pure honnêteté : je sai fort bien que je n’ai pas la réputation que vous dites, et que je la mérite encore moins que je ne l’ai. Ce defaut de mérite ne seroit pas toûjours, je vous l’avouë, une raison convainquante contre votre compliment ; car il n’y a rien où la fortune fasse plus voir ses caprices que sur la réputation : tel en a beaucoup qui n’en mérite nullement ; et tel rampe dans l’obscurité, qui a un mérite incomparable : mais je ne pense pas qu’à mon égard le public ait été dupe, ou prodigue de ses faveurs ; les circonstances qui produisent les bizarreries de la renommée, n’ont point eu de lieu pour moi ; de sorte que pour acquerir la réputation de bon philosophe, il m’auroit fal[l]u nécessairement en donner de très-grandes preuves. Or c’est ce que je n’ai point fait. Si je suis devenu auteur, ç’a été de telle maniere que la philosophie n’y a eu que voir, ou n’y est entrée que par accident, et avec un mêlange qui l’a presque renduë imperceptible. Tirez vous-même la conclusion comme il vous plaira, je vous l’abandonne beaucoup mieux que l’alternative qu’il vous plaît de traiter de fausse.
[Tout plaisir est un bien.] Elle ne l’est point en cette rencontre ; car quoi qu’il y ait un milieu entre le bonheur et le malheur, il est pourtant vrai que pour réfuter efficacement la doctrine que votre ami veut combat[t]re, il ne faut avoir aucun égard à ce milieu. Je m’en vais vous en dire la raison : c’est qu’un homme qui trouve à redire à ces termes, les plaisirs des sens nous rendent heureux, doit nécessairement supposer l’une ou l’autre de ces deux choses, ou même toutes deux ensemble : la I. que le souverain bien est le seul et unique sujet dont on puisse dire qu’il nous rend heureux : la 2. que pour nous detacher du plaisir des sens, il ne faut pas qu’on nous le fasse connoître comme un bonheur. La premiere de ces prétentions sera, si l’on veut, une pensée devote, mais elle ne passera jamais pour philosophique ; car encore que Dieu soit l’Etre par excellence, l’Etre tout court, l’Etre suprême, il est pourtant vrai dans toute la rigueur des termes, que les corps sont un être, et que celui qui l’affirme n’en peut être repris sans chicane, quelque véneration que l’on ait pour l’expression, où Dieu se nomme simplement celui qui est. De même, encore que Dieu soit notre souverain bien et notre bonheur par excellence, ou ce qui est la même chose en cette maniere, encore que l’état où il met une ame durant la vision béatifique, soit le bonheur par excellence, le bonheur tout court de cette ame, il ne laisse pas d’être vrai au pied de la lettre, que tout état de plaisir est un bonheur et un bien.
[On le prouve parce que l’agréable en est un.] Pour le mieux comprendre, recourons à la division ordinaire du bien en ces trois especes, l’honnête, l’utile, et l’agréable, et considerons seulement la derniere. Il est évident à tout homme qui fait un peu de logique, que l’essence d’un genre est contenuë toute entiere dans ses especes et dans ses individus, et que tous les attributs réels du genre se peuvent affirmer de ses especes et ses individus. Or l’agréable entant que genre est un bien ; il faut donc que toutes ses especes et tous ses individus soient un bien. Or les plaisirs des sens sont contenus sous l’agréable, ou comme des especes, ou comme des individus ; on peut donc leur donner l’attribut de bien très-réellement et très-proprement. Or tout bien est un bonheur, et nous rend heureux selon la proposition de sa bonté ; il est donc vrai que l’ame est actuellement heureuse dans le temps et pour le temps / qu’elle goûte quelque plaisir. Si l’on dit que c’est abuser des termes, que de ne pas reserver l’éloge de bien et de bonheur à cette espece particuliere de bien, qui fera dans le paradis notre souveraine béatitude ; on devra dire pareillement que c’est abuser des termes, que de ne pas reserver à Dieu l’éloge d’Etre et de substance. Qui ne voit que ces pensées ne sont bonnes que pour un sermon, ou pour un livre de devotion ? Il ne faut donc pas aprehender desormais, qu’un aussi bon philosophe que M. Arnauld fonde la censure de ces termes, les plaisirs des sens nous rendent heureux, sur la premiere supposition que nous avons alleguée : et par conséquent j’ai pû prétendre, que ceux qui censurent l’auteur de La Recherche de la vérité, se fondent sur ce principe, que pour nous détacher du plaisir des sens, il ne faut pas qu’on nous le fasse connoître comme un bonheur. Or je vous assure, Monsieur, que se fonder sur cela, et croire que les plaisirs des sens sont un malheur insupportable, c’est la même chose dans le sujet que nous traitons. Je m’en vais vous le faire voir.
[Il n’y a point de milieu entre dire que le plaisir est un bien, et dire qu’il est un mal.] Quand on dit que cette proposition, les plaisirs des sens nous rendent heureux, n’est pas propre à nous detacher de ces plaisirs, on prétend sans doute que c’est à cause qu’elle ne nous fait point connoître leurs mauvaises suites. On prétend de plus, que pour guerir l’homme de l’amour de ces vains plaisirs, il faut lui en bien représenter les conséquences : or c’est ce qu’on ne feroit pas, si on le tenoit dans le milieu que vous me reprochez d’avoir sauté ; il faut donc que si on veut éviter l’inconvenient du dogme que M. Arnauld a combat[t]u, l’on se jette dans l’extremité opposée ; c’est-à-dire, qu’au lieu de considerer les plaisirs des sens selon leur realité physique, qui les constituë sous l’espece de bonheur, il faut les considerer dans leurs effets, et dans ces fleaux de la justice divine qu’ils attirent sur nos têtes. Car si l’on disoit simplement aux voluptueux, les plaisirs que vous aimez ne sont ni un bien, ni un mal, on ne leur inspireroit aucune envie d’être sages ; il leur suffiroit qu’on les assurât qu’il n’y a point de mal à se divertir : et pour le refus qu’on leur feroit de leur avoüer, que les plaisirs sont un bien, ils s’en consoleroient sans peine, et ils répondroient, Vous direz ce qu’il vous plaira, ce ne sera pas un bien, si vous voulez ; mais c’est pourtant quelque chose qui nous fait être à notre aise, et que nous trouvons très-agréable ; et il est fort apparent qu’ils se serviroient de la raillerie que l’on faisoit d’un dogme des stoïciens. Ces gens-là un peu trop scrupuleux en termes, ne vouloient pas consentir qu’on donnât le nom de bien à la santé, aux richesses, au contentement ; ni le nom de mal à la pauvreté, aux malades, à la douleur : mais ils vouloient qu’au lieu du mot de bien, on emploïat celui de choses préferables ; et qu’au lieu du mot de mal, on se servît de celui de choses à rejetter. C’est une pure question de mots, leur disoit-on, et vous ne rendez pas un homme plus propre à mepriser les richesses, en lui disant qu’elles ne sont pas un bien, mais une chose préferable, que si vous lui avouïez qu’elles sont un bien.
[En quel sens on peut dire que le plaisir est un mal.] C’est donc en vain qu’on s’efforceroit de faire mieux que l’auteur de La Recherche de la vérité, en disant que les plaisirs ne sont ni un bonheur, ni un malheur ; voilà pourquoi je me suis servi de l’alternative des deux extrêmes, sans y supposer aucun milieu. Je ne sai, Monsieur, si elle vous paroît encore fausse : mais en ce cas-là je vous prie de considerer, que la véritable route de ruiner de réputation les plaisirs des sens, est de les montrer comme une chose que Dieu nous a defenduë, et qu’il punit des supplices de l’enfer. Or si par une metonymie de rhétorique vous donnez à une cause le nom des effets qu’elle produit, il est sûr que ce seroit parler très-improprement, que de dire que les plaisirs des sens ne sont ni un bonheur, ni un malheur ; il faudroit dire qu’ils sont un malheur et un supplice épouvantable : et ainsi pour bien qualifier ces objets, il n’y a que deux chemins à tenir ; ou de dire, selon l’exactitude philosophique, que tout plaisir est un bien ; ou figurément, que les plaisirs defendus sont un grand malheur.
Présentement s’il fal[l]oit choisir entre ces deux façons de parler.
I. Les plaisirs des sens rendent heureux pour le temps qu’on les goûte ; mais ils sont cause qu’on est ensuite malheureux éternellement.
II. Les plaisirs des sens sont un malheur et un supplice insupportable, non seulement à cause des suites, mais aussi pour le temps où on les goûte.
S’il faloit, dis-je, choisir l’une ou l’autre de ces expressions, qui ne voit que la premiere seroit préferable à la seconde, non seulement à l’égard de la justesse, mais aussi à l’égard de l’effet qu’elle produiroit ? Car quand un homme dit deux choses, dont l’une nous paroît certaine, il nous persuade mieux l’autre, que s’il nous nioit celle que nous croyons savoir très-certainement.
[Différence entre être heureux et jouïr du souverain bien.] Avant que je sorte de cet endroit, permettez-moi de vous dire, que vos pages 15. et 16. sont un peu foibles, à cause que vous y prenez le mot de bonheur dans le sens où il ne faut pas le prendre. Jamais l’adversaire de M. Arnauld n’a prétendu que les plaisirs de cette vie ne soient notre souverain bien, ou que ce soit la même chose de dire, que l’on est heureux pendant qu’on jouït du plaisir des sens, et de dire que les plaisirs des sens sont notre vrai bien, et notre véritable felicité. Pourquoi donc, Monsieur, disputez-vous contre lui sur ce pied-là ? L’exemple du sommeil dont vous vous servez, montre évidemment l’équivoque ; et d’ailleurs il semble que vous n’avez pas assez pris garde, que pour bien persuader à un homme qu’il doit moins dormir, il faut nécessairement lui représenter comme un mal le trop long sommeil : car si on se contentoit de lui dire, que ce sommeil n’est ni un bien, ni un mal, il suivroit sans nulle crainte son inclination ; et par conséquent on ne gagne rien dans cette matiere, à moins qu’en s’éloignant de l’une des extremitez, on ne prenne l’autre. Si vous craignez de nuire à un homme, en lui avouant que le dormir est un bien, il ne faudra pas non plus demeurer d’accord que ce ne soit pas un mal, mais il lui en faudra faire comprendre les funestes suites. Au reste, quand vous niez que le sommeil rend[e] heureux celui qui dort, vous tombez encore dans le faux sens que je vous ai représenté, et qui consiste à ne faire point de difference entre être heureux, et jouïr du souverain bien. Je vous l’ai déja dit, Monsieur, le souverain bien mérite par excel / lence la qualité de bonheur, comme Dieu mérite par excellence la qualité d’Etre ; mais cela n’empêche pas, que comme la créature est un Etre très-réel, tout plaisir ne soit une felicité très-réelle. On peut dire sans hyperbole et sans galimathias poëtique, qu’un pauvre qui dort aussi bien qu’un roi, est aussi heureux qu’un roi pendant ce temps-là. En général on peut dire qu’un homme qui dort est heureux, quand le sommeil le dégage de quelque pensée fâcheuse.
[Equivoque dans les mots de vrai bonheur et de réelle felicité.] Il me reste à ôter une autre équivoque cachée sous les mots de vrai bonheur, et de réelle felicité. Tout plaisir est un vrai bonheur et une felicité réelle, en ce sens qu’il est un individu physique de la modification générale, qui constituë l’essence et la nature du bonheur : mais en un autre sens, il y a bien des plaisirs qui ne sont pas un vrai bonheur, puis que bien loin d’être le souverain bien, ils nous exposent à des peines infinies. Un exemple éclaircira tout ceci.
Quand un malade commence à être gueri, il sent une faim extraordinaire ; il mange avec un appetit ardent, et avec un plaisir fort vif. N’est-il pas vrai que cette faim est une véritable faim, c’est-à-dire qu’elle a toute la réalité et toute l’entité physique de ce sentiment de l’ame qu’on appelle faim ? Ne faut-il pas dire la même chose du plaisir que cet homme sent en mangeant ? N’est-ce pas un plaisir qui a toute la réalité que doit avoir cet état de l’ame, dans lequel consiste la nature du plaisir ? Il est sûr qu’il n’y a rien là d’imaginaire, et que cet homme sent des saveurs très-agréables, non pas à la maniere de ce fou, qui croyoit ouïr de beaux concerts où il n’y avoit personne ; mais par l’application actuelle d’une viande, et par la perception réelle qui doit suivre naturellement l’application d’une telle viande à un tel palais. Cependant les médecins ne manquent pas de dire au malade, que sa faim, que son appetit, que son plaisir sont faux. Que veulent-ils dire par là ? Ils veulent dire que cet appetit ne peut être satisfait, sans causer de grands desordres. Ainsi les termes de vrai, de réel, de véritable, se prennent en deux manieres ; ou pour ce qui par son être physique appartient proprement à un tel, ou à un tel genre, comme quand on dit qu’un homme qui ment, prononce de véritables et réelles paroles ; ou pour ce qui n’a pas certains attributs moraux et accessoires, qui se trouvent dans d’autres sujets contenus sous le même genre, comme quand on dit que le discours d’un homme qui ment n’est pas vrai. Voilà, Monsieur, comment on peut dire que les plaisirs d’un voluptueux sont un vrai bonheur, un bonheur réel, et néanmoins un faux bonheur. Ils sont un bonheur vrai et réel, puis qu’ils sont par leur entité sous l’espece du bonheur, et une modification actuelle qui a l’essence du bonheur en général : (car le bonheur en général n’est autre chose qu’être à son aise, et dans un état de plaisir.) Mais on peut les ap[p]eller un faux bien et un faux bonheur, parce qu’il sont suivis d’un malheur épouvantable, et qu’ils n’ont pas la même durée que certains autres plaisirs, qui à cause de leurs prérogatives particulieres meritent d’être ap[p]ellez par excellence le véritable bonheur. J’insiste peut-être trop sur des choses que l’usage de toutes les langues fait assez connoître à tout le monde ; mais cela étoit nécessaire pour renverser une autre partie de votre réfutation.
Réponse à la seconde remarque : la doctrine que j’ai soutenuë n’est pas moins propre à corriger le pécheur.
[Il y a un bonheur très-réel que l’on doit fuir.] J’avois dit, que pour corriger un homme qui aime trop les plaisirs, il faut lui représenter que le bonheur qu’ils lui ap[p]ortent, le damnera s’il n’y renonce. Vous répondez en cette maniere : Vous croira-t-il, me demandez-vous, après que vous lui aurez avoüé que le bonheur qu’il ressent en jouïssant des plaisirs des sens, est un véritable bonheur ? A votre compte il seroit à craindre que si on avoit une fois accordé à un menteur, que les paroles qu’il dit sont de véritables paroles, on ne pourroit pas lui persuader de se défaire de ses mensonges. Il seroit à craindre qu’un medecin qui avoueroit aux convalescens, que leur appetit est très-réel, et que le plaisir qu’ils goûtent en mangeant est un véritable plaisir, ne pourroit point les induire à manger peu à la fois.
Voyez, je vous prie, dans cette image la nullité de votre réponse. Il est certain, et je ne doute pas que les médecins ne l’ayent souvent éprouvé, qu’on vient mieux à bout d’un convalescent, lors qu’on lui accorde que pendant qu’il mange il sent un plaisir extrême, un plaisir très-réel et très-véritable, que si on lui soutenoit que c’est un plaisir chimerique, ou un très-petit plaisir. Il est beaucoup plus à propos de lui dire, que ce grand plaisir qu’il sent sera suivi de rechutes perilleuses, et qu’il vaut mieux renoncer à ce court plaisir, que s’exposer à de plus grands maux. C’est justement la méthode que j’ai conseillée à l’égard des voluptueux. Vous la croïez très-inutile ; mais j’espere, Monsieur, que quand vous aurez consideré l’équivoque qui est cachée sous le mot de véritable bonheur, vous en jugerez autrement, et que vous verrez qu’il y a un bonheur très-réel et très-véritable qu’il faut fuir comme la peste, parce qu’au lieu de durer, il nous attire bientôt sur les bras un malheur extrême.
Mais comment, me direz-vous, peut-il être un véritable bonheur, s’il est la cause d’un si grand malheur ? Je répons que cela n’est pas plus étrange, que de dire que la faim d’un convalescent, et la soif d’un hydropique, font trouver dans le manger et dans le boire un véritable plaisir, qui peu après est la cause d’un très-grand mal.
[Quoi qu’on avouë aux voluptueux que le bonheur est réel, on n’en est pas moins en droit de les censurer.] Quant à ce que vous dites, Monsieur, que je n’ai plus droit de dire à un débauché, qu’il met son bonheur où il n’est pas, et qu’ainsi il abuse de l’inclination que Dieu lui donne à être heureux : je vous réponds que je ne perds pas ce droit-là. Et afin que vous voyiez mieux ma pensée, soufrez que je me serve de cet exemple.
Si un roi defendoit à ses sujets d’emploïer d’autre argent dans leur commerce, que celui qu’il feroit monnoïer dans ses Etats marqué de son effigie, n’auroit-on pas droit de censurer un particulier qui se serviroit de quelques especes étrangeres, quoi qu’on reconnût qu’elles sont de bon argent, et même de meilleur argent que celui / du prince ? Vous m’avouerez sans doute qu’on auroit ce droit. Pourquoi voulez-vous donc qu’en avouant aux voluptueux, que leur bonheur est un véritable bonheur, je me dépouille de l’autorité de les censurer ? N’ai-je pas toûjours lieu de leur dire qu’ils choisissent mal, puis qu’entre une infinité de plaisirs, dont chacun par sa nature est un vrai bonheur, ils choisissent ceux que Dieu leur commande de rejetter, comme le chemin de la perdition éternelle ? Comme un prince peut defendre dans ses Etats le débit d’une monnoye de très-bon alloi, Dieu peut bien defendre à l’homme, l’usage d’un certain bonheur très-réel et très véritable, physiquement parlant.
[On a le même droit à l’égard des voluptueux sans religion.] Pour ce qui est d’un voluptueux sans religion, je ne croi pas que les principes que vous combatez, soient moins propres que ceux de M. Arnauld à le retirer du desordre ; car outre que cette sorte de debauchez, quelque beaux discours qu’on leur pût tenir, croiroient difficilement que l’on ne soit pas heureux, quand on se plonge dans les delices charnelles ; outre cela, dis-je, je ne vois pas qu’en avouant à ces perdus-là, que leurs voluptez sont un vrai bonheur, on s’ôte les vrais moyens de les corriger. Ne peut-on pas leur dire, comme faisoit Epicure, qu’un plaisir qui en éloigne un plus grand, ou qui attire un deplaisir plus considerable, doit être fui ; et après cela ne peut-on pas leur représenter, que la debauche leur attirant sur la tête le deplaisir de se voir infames par toute une ville, et leur préparant mille infirmitez pour la vieillesse, et les empêchant de cultiver leur esprit et leur raison, ce qui leur seroit fort propre pour acquerir de la gloire ; ne peut-on pas, dis-je, leur représenter, que la débauche produisant ces mauvais effets, doit être re[j]ettée comme un grand mal ? Prenez-y bien garde, Monsieur ; il n’est pas besoin, afin de porter un homme à fuir une chose, de lui prouver qu’elle est un mal ; il suffit de le convaincre que c’est un moindre bien, un obstacle à l’acquisition d’un plus grand bien, ou l’instrument d’un grand mal. Vous m’avouerez sans doute, vous qui en qualité de catholique devez croire qu’on peut perdre pour jamais la grace qui nous fait enfans de Dieu ; vous m’avouerez, dis-je, sans doute, qu’un homme qui préverroit infailliblement que sa conversion seroit suivie d’un retour au peché, qui le rendroit plus malheureux que s’il n’avoit jamais eu la grace, souhaiteroit passionnément de ne l’avoir pas. Il sauroit pourtant que la grace est en elle-même un grand bien, et une qualité très-réelle et très-parfaite ; mais à cause des suites qu’elle auroit par accident, il ne la fuiroit pas moins que si elle étoit mauvaise de sa nature.
[Un homme dans le bonheur peut être appellé malheureux, par rap[p]ort aux suites de ce bonheur.] Pour le dire en passant, Monsieur, nous avons ici un nouvel exemple qui nous servira dans cette dispute. Si vous connoissiez par revelation, qu’un tel qui est aujourd’hui en grace abusera tellement des dons de Dieu, qu’il sera damné, ne pourriez-vous pas dire à divers égards qu’il est heureux et malheureux ? Vous l’appelleriez heureux, parce que l’état de grace où il seroit aujourd’hui, est réellement et physiquement un vrai état de bonheur : mais si vous consideriez les suites de cette grace, vous l’appelleriez malheureux. La premiere denomination seroit exacte et litterale ; mais la seconde donneroit un peu dans les tropes de rhetorique, ou dans les ampliations des logiciens. Disons la même chose dans notre dispute. Tout homme qui goûte du plaisir, est par cela même physiquement et réellement dans un état de bonheur : mais parce que ce plaisir lui peut attirer de très-grandes peines, il peut être dit dès à présent malheureux, si l’on veut parler figurément et par anticipation.
Ne me dites pas, que quiconque nous persuade qu’une telle chose nous rendra vraiment heureux, n’est plus propre à corriger notre cœur, tant qu’il laissera notre esprit dans cette fausse persuasion : car en vérité, c’est trop se fonder sur une équivoque. Vous croïez que pour rendre un homme vraiment heureux, il faut lui conferer le plus grand bonheur dont il soit capable. Je sai bien qu’on entend ainsi la chose assez souvent : mais comme les termes souffrent une autre signification très-litterale, vous voïez bien où cela va. Rendre vraiment heureux, peut signifier, qu’on donne un bonheur qui a toute la vérité métaphysique de cette espece de modification des esprits, qui fait le bonheur en général ; mais il ne laisse pas d’être vrai que ce bonheur est quelque fois de telle nature, qu’il vaut mieux ne l’avoir pas que de l’avoir. Tout de même que toute grace sanctifiante est un don réel de l’Esprit de Dieu, et un véritable bonheur, mais qu’il seroit plus utile de n’avoir jamais goûté, si à cause de l’abus qu’on auroit fait, on devroit être plus séverement puni dans l’autre monde.
On ne doit pas trouver étrange la comparaison de la grace avec le plaisir : car il est certain que celui-ci est une grace naturelle et une faveur positive de Dieu, qu’il a attachée à la rencontre de certaines occasions ; et ce n’est que par accident que certains plaisirs ont des suites malheureuses.
Réponse à la troisieme objection. Je n’ai pas argumenté de l’espece au genre.
La derniere remarque que vous faites contre mes preuves, est que j’ai argumenté de l’espece au genre : comme qui diroit, Quelque animal raisonne ; donc tout animal raisonne : Quelque plaisir rend heureux, savoir celui qu’on ressent en jouïssant pleinement de Dieu ; donc tout plaisir rend heureux tandis qu’on en jouït ; donc on est heureux par le plaisir qu’on a à boire du vin d’Espagne, et à manger des perdrix, ou des confitures.
[Chaque espece de plaisir est une espece de bonheur.] Afin qu’on puisse juger si j’ai commis effectivement cette bevûë, il faut qu’on jette les yeux sur la maniere dont j’ai raisonné. Je m’étois fait une objection tirée de ce que l’on dit ordinairement, que Dieu seul est notre béatitude ; et j’avois répondu, que Dieu seul est la cause efficiente de notre felicité, mais qu’il n’y a que le plaisir qui en soit la cause formelle ; et que la seule voye que nous concevions que Dieu puisse mettre en usage, pour nous rendre actuellement et formellement heureux, c’est de communiquer à notre ame la modification qu’on ap[p]elle sentiment du plaisir. Il paroît clairement par là, que je fais du plaisir et du bonheur deux objets inseparables, et même convertibles, s’il m’est permis d’user de ce terme ; ensuite dequoi je dois conclure, que chaque espece de plaisir est une espece de bonheur. C’est assez l’ordinaire que parmi les différentes especes qui sont contenuës sous un même genre, il y en ait une qui en porte le nom préferablement à toutes. C’est en ce sens-là qu’en France, lors qu’on veut dire qu’une chose coute un louïs d’or, et que les bêtes / ne raisonnent pas, on se contente de dire, qu’elle coute un louïs, et que les animaux ne raisonnent pas. Par une semblable façon de parler nous appelons simplement béatitude, bonheur, cette espece de plaisir que Dieu communique à l’ame des fideles glorifiez. Elle mérite ce nom par excellence, mais cela n’empêche pas que pour parler de l’exactitude philosophique, toute les autres especes de plaisir ne doivent être qualifiées du nom de leur genre. Or le plaisir en général, selon les principes que je soutiens, est essentiellement le bonheur en général. Donc chaque espece particuliere de plaisir doit être qualifiée proprement et litteralement un bonheur particulier ; de sorte qu’au lieu d’argumenter de l’espece au genre, comme vous m’en accusez, j’argumente du genre à l’espece. Je prouve que le plaisir des sens est un bonheur, parce que généralement parlant, le plaisir est la seule voïe dont Dieu se serve pour rendre notre ame heureuse. Si parmi toutes les especes de plaisir, il y en a une qui est emploïée à faire le bonheur des saints, qu’on le nomme simplement et par excellence la béatitude, je suis sûr que le P[ère] Malebranche ne s’y opposera pas ; cela ne prouve rien contre lui : il ne dit point que tout plaisir est notre souverain bien, ou notre béatitude ; il se contente de dire, que tout plaisir est un bien, et un bonheur. Or chacun sait qu’il y a une grande difference entre ces termes.
[Tout plaisir par son être essenciel peut faire notre felicité éternelle.] Je n’ajoûte que cette remarque, c’est qu’il n’y a point de plaisir qui par son être essenciel et detaché des idées accessoires, qui l’accompagnent pendant l’union de l’ame et du corps, ne puisse faire notre éternelle felicité.
Pour vous en convaincre, je vous demande seulement deux ou trois suppositions, que je suis assûré que vous ne nierez pas.
La I. Que les objets de nos sens ne contribuent quoi que ce soit, comme causes véritables, à la production du plaisir qui s’excite en nous, lors que nous mangeons, etc. d’où il s’ensuit que Dieu seul forme dans notre ame ce plaisir, dès qu’il voit que les objets ont été les causes occasionnelles de certaines impressions du cerveau, ausquelles il a conjoint, par une institution libre, telles ou telles modifications de l’ame.
La 2. est, que Dieu peut imprimer dans une ame separée de toute matiere, toutes les perceptions qu’il lui donne pendant qu’elle est dans le corps, et qu’il peut même établir pour causes occasionnelles de ces perceptions, les idées les plus sublimes et ses attributs : de sorte que comme nous disons présentement, que la vûë claire de Dieu, et l’amour que les bienheureux conçoivent pour lui, sont un signe à la presence duquel Dieu leur donne cette volupté ineffable, qui est formellement leur bonheur ; nous pourrions dire dans une autre institution très-possible, que ces mêmes idées et ce même amour seroient des causes occasionnelles, qui determineroient Dieu à imprimer dans notre ame les mêmes sentimens de plaisir, qu’il leur imprime durant leur demeure dans le corps, toutes les fois que nos sens externes sont affectez d’une certaine maniere.
La 3. est, qu’il est très-possible à Dieu, en se servant des mêmes especes de sensation ou de modification de l’ame, de nous faire sentir de telle sorte les plaisirs des sens, que cela ne nous attache plus aux objets materiels, que nous prenons aujourd’hui pour les causes véritables de ces voluptez sensuelles. Il seroit par exemple très-possible, qu’un esprit goutât des saveurs, je veux dire, qu’il eût le plaisir de manger les viandes les plus delicates, et que néanmoins il ne rap[p]ortât pas ce sentiment, comme l’on fait aujourd’hui, aux corps qui agissent sur notre palais. Car comme l’action de l’ame par laquelle nous rap[p]ortons aux objets ce que nous sentons, n’est pas essencielle au sentiment de plaisir, et quelle n’en est qu’un accident, ou un accessoire bien imaginé, pour entretenir plus facilement la machine ; il est certain que ces sentimens de plaisir seroient dans la même espece qu’aujourd’hui, encore qu’ils ne fussent pas liez à cet accessoire : et en ce cas-là rien n’empêcheroit qu’ils ne fussent propres à faire le bonheur éternel de la créature, et l’assortiment de la vision béatifique. Examinez cela, Monsieur, et vous trouverez, je m’assûre, que ce que nous appellons plaisir des sens, n’a rien qui dans sa réalité physique ne soit d’une nature très-spirituelle, et que c’est seulement par accident qu’il nous éloigne de Dieu. Or comme les accidens ne changent point l’essence des choses, jugez si l’on a raison de dire, que ces plaisirs ne sont pas une espece de bonheur pour tout le temps que nous les goûtons. Je toucherai encore ci-dessous cette matiere.
Je ne fais pas difficulté de prononcer hardiment, qu’un homme qui goûteroit dans toute l’éternité, sans chagrin et sans douleur, toutes les voluptez de cette vie, seroit très-heureux, et mille fois plus heureux qu’un philosophe qui ne s’occuperoit que de la recherche des plus grands objets, et qui en decouvriroit les merveilles, mais qui passeroit toute son éternité dans la tristesse, ou dans la douleur, sans aucun plaisir. Si cela devoit durer toûjours, il n’y a point d’homme qui ne pût dire légitimement avec un poëte romain, qu’il aimeroit mieux passer pour un visionnaire et pour un sot, et avoir l’esprit content, que d’être sage et chagrin.
Prætulerim Scripto delirus inersque videri,
Dum mea delectent mala me, aut denique fallant,
Quàm sapere et ringi [8].
Réflexion sur la spiritualité du plaisir des sens.
[Tous les plaisirs sont proprement spirituels.] Si la philosophie de M. Descartes avoit chassé depuis long-temps les chimeres arabesques et espagnoles, qui ont si fort obscurci le Traité de l’ame, nous discernerions beaucoup mieux la spiritualité du plaisir des sens, et nous la demêlerions mieux de cette materialité accessoire et accidentelle, que l’on a raison de decrier : car j’avouë que c’est un principe inépuisable de corruption. Mais d’où vient cela ? Est-ce de quelque qualité physique ou inherente de ces plaisirs ? Nullement car à ne considerer les plaisirs que selon leur réalité physique, il n’y en a point de plus spirituels les uns que les autres ; ils sont tous réellement et proprement spirituels, soit qu’on veuille les qualifier de leur sujet qui ne peut être qu’un esprit, soit qu’on veuille les qualifier de leur véritable cause qui ne peut être que Dieu. De sorte que la division des plaisirs en spirituels et en corporels, n’est fondée que sur la coutume qu’ont les hommes d’emprunter les attri / buts qu’ils donnent aux choses, non pas de leur véritable nature, mais des accidens qui les accompagnent.
[Origine et fausseté de la division des plaisirs en spirituels et en corporels.] Ainsi parce qu’il y a des plaisirs qui s’excitent dans notre ame, toutes les fois que certains objets grossiers agissent sur notre corps, et qui ensuite de cette experience attachent notre affection à ces corps, nous les ap[p]ellons corporels et materiels. Au contraire si nous sentons quelque plaisir en conséquence d’une pieuse méditation ; et si ce plaisir attache notre ame à Dieu et aux objets de l’autre monde, nous l’ap[p]elons spirituel. Il est évident que c’est une denomination extrinseque et tropologique, qui ne suppose point de difference réelle entre son sujet, et celui qu’on qualifie corporel. Car changez seulement les causes occasionnelles de ces deux plaisirs, et laissez-les en eux-mêmes ce qu’ils étoient auparavant, vous trouverez qu’il faudra faire un échange de leurs titres, et ap[p]eller corporel celui qu’on nommoit spirituel. L’établissement des causes occasionnelles dependant de Dieu comme d’une cause libre, vous pouvez fort bien supposer, que Dieu lie tous les plaisirs que nous sentons par les cinq sens, aux meditations les plus abstraites et aux idées les plus devotes, et qu’au contraire il lie les plaisirs de la devotion aux objets qui frappent nos sens. Cette supposition une fois faite, vous concevez clairement que les premiers de ces deux plaisirs nous attacheroient aux choses du ciel, et que les seconds nous attacheroient à la terre. Ils demeureroient pourtant de la même espece de modification d’esprit, dont ils auroient été sous les causes occasionnelles qui regnent présentement.
[Conséquences de cela.] Il est donc certain que les plaisirs sensuels n’ont en eux-mêmes aucune souillure, ni aucun defaut, qui les empêche de nous rendre véritablement heureux ; et que tout autre plaisir, quel qu’il fût, ne nous attacheroit pas moins aux corps, s’il nous étoit communiqué par leur moïen, comme par une cause occasionnelle. Car enfin l’amour d’un volupteux pour les voluptez, n’est qu’une suite de la determination naturelle de notre ame à son bonheur. Tout esprit aime son bien. L’ame d’un voluptueux trouve son bien dans l’union à certains corps ; voilà pourquoi elle les cherche avec tant d’ardeur. Elle ne chercheroit pas moins ardemment la vertu et la pieté, si elle y trouvoit les mêmes plaisirs. En un mot, son dereglement et son crime ne consistent pas en ce qu’elle prend pour un bien ce qui n’est pas un bien, mais en ce qu’elle ne sacrifie pas à Dieu la passion qu’elle a d’être heureuse, par le moïen de certaines choses que Dieu lui defend, et en ce qu’elle ne suit pas le choix que Dieu lui a marqué de tels et de tels instrumens de felicité éternelle. Et ne me dites pas, que puis que Dieu lui a defendu certains plaisirs pour lui en marquer quelques autres, c’est une preuve que les premiers sont un mal, et qu’il n’y a que les derniers qui soient un bien : car par un semblable raisonnement, vous prouveriez que le fruit que Dieu commanda au premier homme de ne point manger, n’étoit point bon. Voyez que plus on ap[p]rofondit la chose, plus on connoît que le P[ère] Malebranche a parlé selon l’exactitude philosophique [9].
Pourquoi le plaisir a été uni avec le peché pour un certain temps.
Je ne croiois pas m’engager si avant dans ces matieres, et je vois néanmoins que ce n’est pas encore le tout, et qu’il m’arrive ce qui est arrivé à bien d’autres, qui pour éclaircir certaines difficultez, ont avancé des observations, qu’il fal[l]oit ensuite éclaircir, pour ne pas laisser au lecteur une pierre d’achop[p]ement. Ce que j’ai dit, que Dieu est la véritable cause de toutes nos sensations ; que les plaisirs d’un voluptueux sont un bien ; et que ces plaisirs ne sont terrestres, qu’à cause que Dieu les fait dependre du corps, comme d’un signe d’institution qui l’engage à les produire ; cela, dis-je, pourroit choquer les esprits foibles. Car diroient-ils, n’est-ce pas une impieté que de dire que Dieu fait une alliance entre le bien et le mal, et qu’il allie le bonheur avec le crime ? Or il semble qu’on dit cela, lors qu’on soutient que le plaisir qui accompagne la débauche, est un bien et un bonheur. Donc etc.
[Il n’y a point d’impieté à dire que Dieu a allié le bonheur avec le crime.] Je réponds deux choses. Premierement que l’on ne sçauroit soutenir, sans se rendre criminel de leze-majesté divine au premier chef, c’est-à-dire, sans être athée à la Spinoza , que Dieu n’a pas disposé librement des conditions, sous lesquelles l’ame de l’homme est unie à la matiere : d’où il s’ensuit que c’est Dieu qui a établi l’alliance naturelle, qui se trouve entre la debauche et le sentiment de plaisir. Or s’il est une fois vrai et certain, que ce soit Dieu qui a établi librement cette alliance, il ne faut point faire difficulté d’en convenir, et l’abus qu’on en pourroit faire n’est pas une raison valable pour affirmer que cela est faux. Souvenons-nous de cette parole de s[ain]t Paul, Nous ne pouvons rien contre la vérité. Cette sentence est aussi vraye à l’égard des véritez de la nature, qu’à l’égard de celles de la morale, et de la révelation. Nos artifices, nos fraudes pieuses, tous les detours de notre prudence se trouvent enfin trop courts, quand on les emploie pour le mensonge. Et après tout, Dieu n’est pas comme les princes de la terre, qui ont besoin qu’on supprime quelques-unes de leurs actions [10]. Il n’a rien fait qui ne soit digne d’un Etre infiniment sage, et qui ne lui soit infiniment glorieux. Ainsi on n’a que faire d’user pour lui de ces petits menagemens, et de ces omissions officieuses, dont les historiens des plus grands monarques doivent se servir, s’ils veulent sauver la réputation de leurs heros. S’il étoit donc vrai que Dieu eût uni pour un certain temps le bonheur avec le crime, et le malheur avec la pieté, il le faudroit avouer sans scrupule et sans craindre le qu’en dira-t-on, ou le scandale des esprits foibles. Or il s’ensuit de là, qu’il faut avouer franchement qu’il a uni le plaisir avec mille actions mechantes. De sorte que si le plaisir est un bien et un bonheur, il faudra tomber d’accord, que Dieu a uni le bien et le bonheur avec le peché pour un certain temps.
[La question si tout plaisir est un bonheur est une question de nom.] Il n’est donc plus question que de sçavoir si tout plaisir est un bonheur. C’est le sujet de notre dispute. Vous dites le non, et je dis le oüi. Vous avez raison, si vous definissez le bonheur comme on definit dans la morale le souverain bien, en appliquant l’idée du genre à la principale de ses especes, exclusivement à toutes les autres. Mais vous avez tort, si on / definit le bien et le bonheur selon les regles communes, qui veulent que les attributs du genre conviennent à chacune de ses especes. Et au fond ce ne sera que question de nom, et nous ne serons pas plus religieux l’un que l’autre par rapport à la présente difficulté, ni plus indulgens pour les pécheurs. Car si je dis que Dieu a uni pour un temps le bonheur avec le crime, je n’enferme pas plus de choses dans cette proposition, que vous en entendez, lors que vous dites que Dieu a uni le plaisir avec le crime pour un certain temps ; et je vous crois trop habile, pour vous figurer qu’un voluptueux se mette fort en peine de ce qu’on lui niera, qu’on puisse donner à son plaisir la definition du bien. Definissez le comme il vous plaira, vous diroit-il, peu m’importe. Je sai bien ce que je sai : c’est que si je devois être éternellement dans l’état où je me trouve quand je me divertis, je serois heureux éternellement. Vous ne pourriez pas le contredire de bonne foi. Car si les voluptez charnelles devoient toûjours durer sans degout, sans chagrin, aussi pures et aussi vives qu’elles se font sentir en certains momens, il est certain qu’elles pourroient rendre un homme éternellement heureux, etc.
Voila ma premiere reponse. Elle fait voir que l’objection ne tombe pas plus sur moi que sur un autre. Mais voici une seconde consideration qui ôte directement la difficulté. J’ai tant d’envie de vous satisfaire, que je me servirai d’un principe que vous ne pourrez pas desavouer, puis que je l’emprunte de votre théologie.
[L’alliance que Dieu a faite du bonheur avec le crime, rend la sagesse plus admirable.] Je dis, Monsieur, que bien loin que ce soit une impieté, que d’admettre pour un certain temps cette alliance du crime avec le bonheur, et de la vertu avec le malheur ; qu’au contraire il n’y a rien qui rende plus admirable la sagesse infinie de Dieu. Car rien n’a été plus propre que cette alliance, à mettre l’homme en état d’aimer Dieu par choix et par un principe de raison, et de mériter par sa foi la gloire du paradis. (N’abusez point, je vous prie de ce terme de mérite. Je m’en sers par condescendance, et je saurois bien le réduire à son véritable sens, s’il le faloit.) Si le plaisir eût accompagné naturellement la vertu et la devotion, et si la douleur eût été jointe naturellement au vice, nous n’aurions pas obeï à Dieu d’une maniere raisonnable, digne de lui et de nous, mais brutalement, machinalement, par instinct, sans choix, sans réflexion, sans que notre fidelité eût jamais été à l’épreuve. Mais de la maniere que Dieu a établi les choses, il éprouve si nous sommes capables de souffrir pour lui, si nous nous fions assez à ses promesses, pour vouloir lui faire credit de nos mortifications, en pratiquant la vertu, et en renonçant au plaisir présent que le vice nous procureroit.
Cette conduite est semblable en quelque façon à celle d’un pere très-riche, qui pour éprouver ses enfans, et pour les dresser à une obéïssance raisonnable et généreuse, leur proposeroit ces deux partis : ou de leur donner seulement de quoi ne pas mourir de faim pendant sa vie, s’ils obéïssoient aux ordres penibles qu’il leur donneroit ; ce qu’il récompenseroit de tous ses biens par son testament : ou de leur fournir pendant sa vie une pension annuelle de 50. mille livres, pour contenter leurs passions, celles-là même qu’il desapprouveroit le plus ; mais à condition aussi qu’ils seroient tout-à-fait exclus de son heritage. Un fils verroit en cette rencontre s’il auroit assez de raison, pour vaincre le poids de la machine et l’impression du plaisir présent ; et s’il en avoit assez pour cela, il se rendroit digne d’une succession que la nature lui avoit donnée, et il témoigneroit à son pere une amitié et un respect très-raisonnable. Ceux qui prendroient le dernier parti, seroient comme des machines qui vont par tout où on les pousse à chaque moment, sans distinguer le bien et le mieux, et sans pourvoir à l’avenir.
Nouvelle preuve que tout plaisir est un bien.
[Fins qu’il s’est proposées dans cette alliance.] Ceci me confirme dans mon opinion. Car si les plaisirs des sens n’étoient pas un bien réel, et un solide bonheur pour le temps où on les goûte, Dieu ne nous mettroit pas en état de mériter le paradis par un choix qui témoignât notre confiance, et ce ne seroit point nous mettre à l’épreuve, ni exiger une marque d’amitié difficile à obtenir ; ce qui est pourtant le but que Dieu se propose dans l’établissement qu’il a fait. Quel credit feroit-on à Dieu, en renonçant aux plaisirs sensibles, et en se mortifiant ? On renonceroit à une chose qui ne seroit pas un bien, et on se soumettoit à une autre qui ne seroit pas un mal. Voilà sans doute un sacrifice bien considerable et bien digne qu’on nous en tînt compte, puis qu’il y auroit tant de peine à se determiner pour le bon parti, dans l’alternative qui nous seroit proposée. Dieu y mettroit d’un côté une infinie béatitude à recueillir après notre mort, sans la privation d’aucun bien, sans le sentiment d’aucun mal durant cette vie ; (car les plaisirs ausquels on renonceroit ne sont, selon vous ni un bien, ni un bonheur ; et vous devez dire aussi pour raisonner conséquemment, que les afflictions de cette vie ne sont ni un mal, ni un malheur) et il mettroit de l’autre les peines infinies de l’enfer à souffrir après cette vie, sans aucun bien durant celle-ci. Cela ne convient nullement aux fins que Dieu se propose. Il faut pour nous bien mettre à l’épreuve, qu’il nous présente d’un côté une gloire infinie pour l’avenir, jointe avec les douleurs de cette vie et avec la mortification des sens ; et de l’autre, les supplices de l’enfer avec des biens présens très-réels et très-solides. Si nous méprisons ces biens présens, non pas à cause d’eux-mêmes, mais parce que Dieu ne veut pas que nous les goûtions ; cela va bien. Mais quel gré nous sauroit-on de ce que nous mépriserions pour Dieu une chose qui ne vaut rien en elle-même, et qui ne sauroit nous apporter aucun bien ? Quand je parle ainsi, Monsieur, je parle selon le stile de la devotion chretienne, qui ne compte pour une bonne œuvre que ce qu’on fait pour l’amour de Dieu. Car je sai d’ailleurs que la bonne philosophie nous peut fournir de grandes raisons de mépriser les plaisirs sensibles.
[Le plaisir des méchans est un bien.] Souvenez-vous, je vous prie, de ce pere que je vous ai allegué en supposition, et remarquez bien que comme l’argent qu’il accorderoit à ses fils pour se divertir contre son gré, seroit aussi réel que celui qu’il leur laisseroit après sa vie, s’ils avoient obéï à ses ordres ; on peut dire de même, que les biens que Dieu communique aux hommes, lors qu’ils n’obéïssent pas à sa volonté, sont aussi réels selon leur nature générique, que ceux qu’il leur communique un / jour s’ils étoient sages. Je dis selon leur nature générique : car je sai bien qu’un plaisir est bien autrement considérable qu’un autre[,] soit pour le degré, soit pour sa cause occasion[n]elle, soit pour ses effets. L’apôtre s[ain]t Paul paroît fort persuadé que les plaisirs des méchans sont un bien, puis qu’il dit que s’il n’y avoit point d’autre vie que celle-ci, les bons Chretiens seroient les plus malheureux de tous les hommes. Il sont donc plus malheureux sur la terre que les méchans ; il faut donc qu’ils n’y ayent pas quelque chose qui les tireroit du malheur, s’ils la possedoient. Or quelle est cette chose, si ce n’est les plaisirs du monde ? S[ain]t Paul croïoit donc qu’ils ap[p]ortent quelque bonheur. On ne peut pas éluder la preuve, en disant que les gens de bien peuvent être plus malheureux sur la terre que les autres hommes, quoi que ceux-ci ne soient pas heureux ; et on ne peut pas se fonder sur ce que dans ce passage de s[ain]t Paul, nous esperons de vous des choses meilleures, le comparatif ne suppose aucune bonté dans l’autre membre de la comparaison : on ne peut pas, dis-je, recourir ici à cette figure, puis qu’outre bien d’autres raisons, il est certain que la conduite de Dieu envers la nation judaïque marque manifestement, que les plaisirs qui naissent de la prosperité temporelle sont un vrai bien positif ; car sans cela ils n’auroient pas été propres à faire la récompense du peuple de Dieu.
[Le plaisir est un bien fait de Dieu.] Il me semble que je vous entens me faire deux objections ; le I. que Dieu nous met assez à l’épreuve, et qu’il rend notre choix assez méritoire, puis que nous nous imaginons faussement que les plaisirs sont un bien. Mais prenez garde qu’on ne vous dise, que ce seroit à Dieu, vouloir profiter de nos illusions, et nous y confirmer davantage. Pour moi je ne vous dirai pas cela. J’aime mieux une réponse qui soit un peu moins mauvaise. La voici. C’est que les plaisirs naturels et legitimes que Dieu attache à l’action de certains corps sur nos sens, sont une espece de bien et de bonheur. Je ne vous saurois croire capable de le nier. Car n’est-il pas évident que la loi générale de la nature, par laquelle Dieu nous fait sentir du plaisir, quand nous nous chauf[f]ons durant le froid, ou quand nous nous mettons à l’ombre durant le chaud, ou quand nous mangeons et beuvons pour nous delivrer de la faim et de la soif qui nous pressent, ou en général lors qu’il nous arrive une grande et innocente prosperité ; n’est-il pas évident, dis-je, que cette loi est une grace et un présent de liberalité de Dieu ? N’est-ce pas sa bonté pour ses créatures, qui lui a inspiré de gratifier la nature humaine de ces agréables sentimens ? Ils sont donc un bien à notre ame, et par consequent ils la font heureuse.
[C’est toûjours un bonheur, et lorsqu’il est légitime, et lorsqu’il est défendu.] Or comme il [est] très-certain que les mêmes sensations qui s’excitent dans une ame, lors que les objets agissent sur elle légitimement, s’y excitent aussi lors qu’elle jouït de ces objets d’une façon criminelle, il s’ensuit qu’en l’un et en l’autre cas ces sensations rendent l’ame heureuse : car il est impossible, physiquement parlant, qu’un être qui est aujourd’hui notre bonheur, ne le soit pas aussi demain, s’il demeure précisement ce qu’il étoit. Vous ne doutez pas, Monsieur, vous qui croïez que c’est un peché que de manger de la viande en certain temps, que la chair qu’on mange durant le carême, n’ait le même goût que celle qu’on mange le mardi gras ; et il n’y a point de debauché qui ne sache, que la nature fait sentir les mêmes choses dans le commerce criminel des deux sexes, et dans le commerce légitime. Il faut donc que jamais les plaisirs des sens ne soient un bien, (ce qui est absurde) ou qu’ils le soient lors même qu’ils sont defendus ; sauf à celui qui les defend à chatier, quand il lui plaira, ceux qui n’auront pas obeï à sa defense. Remarquez bien, je vous prie, que Dieu ne punira pas les voluptueux à cause des plaisirs qu’ils auront goûtez, mais à cause de la volonté qu’ils auront euë de jouïr de ces plaisirs, dans des circonstances où Dieu leur avoit defendu de les souhaiter. Il n’y a que cette volonté qui soit criminelle, et ce sera pour elle seule que Dieu châtira le pecheur. Pour ce qui est du plaisir que Dieu accorde à cette volonté criminelle, il n’est mauvais ni moralement, ni physiquement, et il n’est pas destiné à punir l’ame qui le desire d’une façon criminelle ; Dieu l’accorde comme un bien présent, en conséquence des loix générales de l’union de l’ame avec le corps.
[C’est un bonheur solide, et comment.] L’autre objection est, que je vais beaucoup plus loin que le P[ère] Malebranche, puis que j’avouë que le plaisir des sens est un solide bonheur. Pure équivoque. On a raison de le dire et de le nier à divers égards. Ce plaisir n’est pas un bonheur solide, si par solide vous entendez ce qui est dans le souverain degré de perfection, et qui doit durer constamment et invariablement. Mais si vous entendez par solide ce qui est réel, ou ce qui est opposé à une apparence creuse et imaginaire, ce plaisir est un solide bonheur. Dites moi, s’il vous plaît, Monsieur ; la grace que vous croyez que l’on peut perdre n’est-elle pas un bonheur solide, pour le temps qu’on l’a, quoi qu’on ne doive point la garder longtemps ? Elle n’est pas un bonheur solide, je l’avouë, si vous entendez par ce mot ce qui est durable ; mais ce n’est point la seule signification propre de ce mot. Tout ce qui est opposé à une vaine apparence se peut appeller solide, soit qu’il doive durer, soit qu’il ne doive pas durer. Puis donc que cette grace n’est pas selon vous une illusion, mais une qualité très-réelle produite par le S[ain]t Esprit, elle est un bien très-solide. On ne peut disconvenir que toutes choses étant égales quant au reste, l’embonpoint d’un soldat qui doit être tué dans une bataille au premier jour, ne soit aussi solide que celui d’un autre soldat qui vivra encore 60 ans. Une pension viagere et independante de tous les caprices du donateur, est plus solide à la vérité, toutes choses étant égales quant au reste, que celle qu’on peut revoquer à la premiere fantaisie qui nous pique. Mais celle-ci ne laisse pas d’avoir sa solidité, par opposition à un présent qu’on ne vous feroit qu’en peinture, qu’en songe, et duquel nous ne joüirions qu’en vertu des rêveries d’une fievre chaude. Vous savez comment on se moque des péripateticiens, sur ce qu’ils disent qu’il y a des couleurs vraies et des couleurs fausses, et qu’ils donnent aux premieres, entre autres proprietez, celle de durer long-temps. On leur montre qu’ils se contredisent, puis qu’ils reconnoissent que la couleur verte d’un brin d’herbe qui se doit flêtrir dans un quart d’heure, est aussi véritable que celle d’une émeraude qui durera deux cens ans. L’application de tout ceci au plaisir des sens n’est pas mal-aisée.
Je finis ma réponse à votre premiere plainte, en vous priant de considerer, que comme la douleur est un mal réel, et ne mérite le nom de bien que par accident, lors qu’elle nous met en / état d’obeïr à Dieu ; il est juste aussi de dire que le plaisir est un bien réel, et qu’il n’est un mal que par accident, lors qu’il nous degoûte des choses célestes.
II. Plainte.
[II.PLAINTE. Sur ce que l’auteur a dit que M. Arnaud ne croit ni la science moyenne, ni la liberté d’indifférence.] Passons à votre seconde plainte. Elle a deux parties. Vous trouvez mauvais que j’aye dit, I. Que Monsieur Arnauld ne croit pas la science moïenne. 2. Qu’il ne croit pas la liberté d’indifference. Et sur le premier chef vous dites, que vous ne savez pas qu’il se soit jamais expliqué sur ce qu’il croit de la science moïenne, s’étant toûjours contenté de montrer que l’efficace de la grace ne depend point de cette science, mais du souverain empire que Dieu a sur les volontez des hommes, leur faisant vouloir tout ce qu’il veut, pour les porter à lui sans blesser leur liberté. Je m’en vais vous répondre, Monsieur, avant que de rapporter ce que vous dites sur le second membre de cette plainte.
Réponse touchant la science moïenne.
[Raisons qu’on a eu de dire qu’il ne croit pas la science moyenne.] D’abord je vous avouerai la surprise qui me saisit, en voïant que votre ami fait difficulté d’avoüer qu’il rejette la science moïenne, vision aussi chimérique qu’aucune qui soit jamais montée dans l’esprit des scolastiques espagnols. Et pour vous dire ingenûment ma pensée, je croïois faire plaisir à Monsieur Arnauld, en disant de lui ce que j’en ai dit, parce que c’étoit donner à connoître à mes lecteurs, qu’il avoit si sagement pris ses mesures, qu’on ne pourroit pas retorquer sur lui la force de ses argumens. Je m’imaginois qu’un si habile homme n’avoit pas manqué de reconnoître, que plusieurs de ses objections frappoient ceux qui disent que Dieu prévoit les actions de la volonté humaine comme futures, avant que de faire des decrets ; et que quand il fait des decrets, ce n’est que pour s’engager à fournir aux causes libres un concours indifferent. Et ainsi je n’avois garde de soupçonner, qu’il approuvât une hypothese si peu conforme à ses objections. Et comme je voyois d’un autre côte, qu’un de ses amis dont il a inseré les remarques dans sa préface, semble traiter assez cavalierement la science moyenne, je ne crus pas qu’il y eût à balancer sur cette question. Ainsi je prononçai sans scrupule qu’il ne croïoit pas la science moïenne.
Tout autre que moi en eût fait autant. Car vous avouez vous-même, Monsieur, vous qui sans doute avez lû tous ses écrits, que vous ne savez pas qu’il se soit jamais expliqué sur ce qu’il croit de cette science, et qu’il s’est contenté de montrer que l’efficace de la grace n’en depend point. C’est-à-dire, qu’ayant eu mille occasions pendant ses disputes avec les jesuites d’expliquer l’efficace de la grace, et son accord avec notre libre-arbitre, il n’a jamais recouru à cette prétenduë science divine, pour se tirer d’embarras. Or je demande à tout homme raisonnable, si cela ne suffit point pour croire que M. Arnauld rejette la science moïenne ? Quoi ! si je voyois un philosophe qui fit plusieurs livres contre les péripateticiens, et qui expliquât les proprietez de chaque corps par les modifications des particules, sans recourir jamais à la forme substantielle, n’aurois-je pas raison de dire qu’il ne croit pas cette prétenduë et chimerique substance ? On me l’avouera sans doute. Et ainsi j’ai eu raison, quand même il se trouveroit que M. Arnauld n’a jamais nié nettement et précisément la science moyenne.
Réponse touchant la liberté d’indifference.
Pour ce qui est de la liberté d’indifference, le 2. article de cette plainte, vous me condamnez plus hardiment ; parce que selon vous le livre même dont je faisois alors un extrait, prouve tout le contraire de ce que j’impute à M. Arnauld.
Plus j’y songe, plus j’admire la condition des choses humaines. Car il me semble reconnoître que ce seul endroit, chetif et miserable mal-entendu, a donné naissance à votre petit écrit, et à ma réponse, et qu’il pourroit produire une longue guerre de plume, si nous étions d’autre humeur. Mais je vous croi trop raisonnable pour n’acquiescer pas à mes éclaircissemens ; et pour moi, je suis résolu d’en demeurer où j’en suis, quand même vous repliqueriez.
[En quel sens on a dit qu’il ne croit pas la liberté d’indifference.] Je dis que cet endroit de mes Nouvelles est un miserable mal-entendu. Car je vous proteste, que quand j’ai dit que Monsieur Arnauld ne croit point la liberté d’indifference, je n’ai eu nullement en vuë la fameuse proposition de Jansenius, contre laquelle les jésuites ont tant crié, Pour mériter et demériter dans l’état de la nature corrompuë, il suffit d’agir sans contrainte. Si Jansenius avoit enseigné cela, il s’ensuivroit clairement qu’il mettroit l’essence de la liberté dans le volontaire, et non pas dans l’indifference. Mais encore un coup, je proteste que je n’ai eu aucun égard à ce demêlé. J’ai eu seulement en vuë la doctrine des thomistes, qu’il est très-probable que M. Arnauld préfere pour toutes les actions libres en général, à celle des sectateurs de Molina, comme il est certain qu’il lui donne la préference à l’égard de la conversion. On sait avec quel attachement il a combattu pour l’efficace de la grace. On sait qu’il a enseigné, que quand cette grace est une fois accordée à l’homme, elle obtient toûjours et infailliblement son effet, en sorte qu’on ne peut voir qu’à la présence de cette grace l’homme produise un acte de rebellion. M. Arnauld soutient néanmoins que l’homme se convertit librement, et qu’il execute librement ce à quoi la grace le porte. Il semble donc qu’il se contente de l’exemption de contrainte, pour l’établissement de la liberté à l’égard des actions surnaturelles. Il est donc probable que par tout ailleurs il explique les actions des causes secondes, par la prédetermination physique des thomistes, et qu’ainsi l’idée qu’il se forme de la liberté, n’est pas celle que s’en forment les jesuites.
[Ce n’est qu’une dispute de mots.] Cela est d’autant plus probable, qu’il n’a jamais paru ap[p]rouver la non-invincibilité que le P[ère] Malebranche regarde comme le caractere du libre-arbitre. Or comme en mon particulier je suis fort persuadé qu’il n’y a point d’autre liberté d’indifference, que celle qui est conforme au systême de Molina, il a été tout-à-fait dans l’ordre, que j’aye cru et que j’aye dit que M. Arnauld ne croit pas la liberté d’indifference. Vous voïez, Monsieur, que j’ai eu raison d’appeller ceci un chetif et miserable mal-entendu, car ce n’est qu’une dispute de mots. M. Arnauld ne nie point la liberté de la créature, et je n’ai jamais prétendu l’accuser de / ne la point croire. Mais il veut que la liberté qu’il croit, soit appellée liberté d’indifference ; et moi je trouve qu’il ne faut pas lui donner ce nom. C’est donc une dispute de mots. Et par conséquent voilà notre procès fini, puis que je declare que je n’ai voulu dire autre chose, sinon qu’il étoit thomiste, et qu’il expliquoit la liberté de telle maniere, qu’on ne pouvoit pas retorquer sur lui les objections qu’il a faites à l’auteur du nouveau systême de la nature et de la grace, comme on pourroit les retorquer contre un moliniste.
Je prévoi qu’il vous restera encore quelque petit grief. Car enfin, me direz-vous, pourquoi fait-on aux thomistes l’injustice de ne leur pas avouer qu’ils tiennent la liberté d’indifference ? J’aurois bien des choses à vous dire sur cette question : mais comme je n’ai pas dessein d’examiner cette controverse, je me contenterai de quelques remarques.
[Pourquoi les thomistes ruïnent l’indifference de la volonté.] Premierement, j’admire que ces Messieurs qui disputent pour la prédestination physique tanquam pro aris et focis [11], trouvent étrange qu’on les accuse de ruïner l’indifference de la volonté. Car puis qu’il y a une opposition essentielle entre la determination et l’indifference, il est clair que dès qu’on pose qu’une créature n’agit jamais sans être prédeterminée d’ailleurs, on pose qu’elle n’est jamais indifferente dans le moment qui précede l’exercice de ses facultez. Or les thomistes posent la premiere de ces deux choses. Donc ils posent aussi la seconde, ou bien ils ne s’entendent pas. Où sera donc la liberté d’indifference, puis que la créature n’agit jamais sans l’avoir perduë, par la prédetermination physique que Dieu lui imprime, pour l’exciter de telle sorte à faire ceci plûtôt que cela, qu’il est impossible qu’avec la prédetermination à croire, on voye jamais dans une ame un acte d’infidelité ?
[S’il y a de la difference entre la liberté qu’ils admettent et celle des réformés.] Je dis en 2. lieu, qu’il n’est pas fort surprenant que je ne veuille pas appeller liberté d’indifference, celle que les thomistes admettent. Car vous n’ignorez pas qu’on leur soutient tous les jours, au milieu de votre Eglise, dans des livres et dans des theses, que leur prédetermination physique renverse la liberté. Avez-vous jamais lû le livre que le P[ère] Theophile Raynaud a intitulé Religio bestiarum [12], où il introduit un thomiste qui suë sang et eau, pour trouver quelque difference entre la liberté des calvinistes, et celle de son parti, et qui gagne enfin son procès par cette mysterieuse raison, que puis que l’Eglise condamne les calvinistes, et ne condamne pas les thomistes, il faut bien qu’il y ait entre eux de la difference ? Quelles distinctions, bon Dieu, n’allegue-t-on pas pour concilier, s’il étoit possible, l’indifference avec la prédetermination ! Elles sont pires que les faux-fuyans de la grace suffisante, que M. Pascal a si agréablement réfutez [13].
[Difference qu’il y a entre celle des thomistes et celle des ismaëlites.] Disons un mot en 3. lieu sur le passage du dernier livre de M. Arnauld. Ces ismaëlites dont il parle ne different des thomistes qu’en ce qu’ils avouent, qu’il ne faut point nommer puissance d’agir et liberté, ce que les thomistes soutiennent être une véritable puissance et une vraie liberté. De sorte que j’ai pû croire assez raisonnablement, que votre ami ne blâme les ismaëlites, qu’en ce qu’ils admettent les conséquences qu’on tiroit de leur opinion. On leur reprochoit qu’il s’ensuivoit de leur doctrine, que les hommes n’avoient point de liberté, et qu’il ne servoit de rien de leur établir des loix. Ils avouoient la dette fort bonnement, et soutenoient que cela n’étoit point absurde. M. Arnauld les blâme d’avoir reconnu cette conséquence : car du reste il louë le fonds de leur opinion. Ai-je dû inferer de là qu’il admet la liberté d’indifference ? Nullement : puis qu’il est certain que ceux d’entre les réformez qui nient cette liberté, ne laissent pas de se moquer des conséquences qu’on reprochoit aux ismaëlites, et de soutenir que l’homme agit librement, et que c’est avec une grande sagesse, et une merveilleuse utilité que Dieu lui defend et lui commande certaines choses, et lui fait des promesses et des menaces. Comment donc, Monsieur, avez-vous pû dire, que ce seul passage de M. Arnauld me devoit convaincre qu’il reconnoissoit la liberté d’indifference ? Vous n’y avez pas songé assûrément.
Qu’on reconnoît une véritable liberté sans indifference, dans l’une et dans l’autre communion.
[L’auteur n’a pû attribuer à M. Arnauld ce qu’on prétend.] Je dis en 4. et dernier lieu, que si on prend la chose au sens que vous l’avez prise, j’aurois attribué à M. Arnauld une opinion condamnée, non seulement par tout ce qu’il y a dans l’Eglise de théologiens catholiques, comme vous l’avez remarqué dans votre Préface, mais aussi par tous les théologiens protestans. En effet, Monsieur, votre pensée n’étoit pas que j’attribuois à M. Arnauld, de soutenir que Dieu determine tellement les créatures, qu’elles sont toûjours l’acte auquel il les porte par sa determination, et ne peuvent joindre ni la negation de cet acte, ni l’acte contraire, avec cette determination. Car si vous aviez cru que je n’attribuois que cela à M. Arnauld, vous n’auriez pas eu sujet de vous plaindre ; puis qu’il est de notorieté publique, que c’est là son sentiment sur la grace, et qu’il a hautement et invinciblement prouvé à M. Le Moine, docteur de Sorbonne, que selon s[ain]t Augustin la grace nous fait vouloir, et produit en nous l’acte de vouloir [14]. Il n’est pas moins évident, que tous les dominicains expliquent ainsi le dogme de la prédetermination physique. Il faut donc que vous ayez cru que j’attribuois quelque autre chose à votre ami, par exemple, d’enseigner que l’homme ne se convertit pas à Dieu librement, et qu’il n’y a point de liberté proprement dite, à moins que Dieu ne nous laisse faire tout ce qu’il nous plaït. Je vous ai déjà dit que ce n’a point été ma pensée : mais je dis de plus, qu’en lui attribuant cela, je lui eusse attribué un dogme rejetté par l’une et par l’autre communion.
[Les catholiques reconnoissent une véritable liberté sans indifference.] Vous avez ouï parler sans doute de M. Regis, célebre philosophe cartésien [15]. Il a présidé à une these soutenuë publiquement en françois, dans une ville où il ne s’en faut gueres que l’Inquisition ne soit sur le trône. Cependant voici les propres termes de sa derniere position ; Les anges et les bien-heureux aiment Dieu librement dans le ciel : mais leur liberté ne consiste pas comme la nôtre, dans une faculté positive de se determiner à l’un ou à l’autre des deux contraires, mais seulement en ce que voïant Dieu souverainement bon, ils l’aiment de telle sorte, qu’ils ne sentent point qu’il y ait aucune force exterieure qui les y contraigne. On ne se formalisa point / de cette doctrine, quoi qu’elle porte clairement qu’il y a une liberté proprement ainsi nommée, qui consiste, non pas dans l’indifference de la volonté, mais dans une determination qui sans nulle violence nous attache uniquement à l’un des contraires. D’où il s’ensuit que l’indifference n’est point essencielle à la liberté, et qu’on peut fort bien soutenir, qu’un homme parfaitement determiné à une seule espece d’action, ne laisse pas d’agir très-librement. Or si quelqu’un soutenoit, que la grace du S[ain]t Esprit nous fait tellement connoître que Dieu est notre souverain bien, que nous l’aimons sans sentir qu’aucune force exterieure nous y contraigne, n’auroit-il pas raison de prétendre, aussi bien que M. Regis, qu’alors nous aimons Dieu librement, quoi que nous n’ayons plus pour ce moment-là notre liberté d’indifference ? Il me semble que si cela est, le titre de bon catholique n’exige pas qu’on soutienne cette sorte de liberté. Mais comme je ne veux pas entrer dans cette dispute, me contentant de la pure question de fait qu’il faut achever d’éclaircir, je laisse la chose-là. Je souhaite que M. Regis publie bien-tôt son cours de philosophie. Il nous donnera peut-être dans sa Morale, quelques éclaircissemens sur la nature de la liberté [16].
[Et les protestans encore plus.] Vous venez de voir qu’on condamne impunément dans le sein de votre Eglise, ceux qui feroient difficulté d’admettre une vraye liberté sans indifference. Mais c’est bien pis parmi nous ; car la plûpart des réformez ne tiennent point d’autre liberté que celle qui exclut l’indifference. Allez moi dire à présent à nos docteurs, que les disciples de Calvin rejettent le franc-arbitre ; vous verrez comment on criera que c’est une calomnie. On ne vous avouera pas même que Luther l’ait rejetté, encore qu’il ait composé un livre De servo arbitrio. Et en effet, il ne faut pas une grande pénetration d’esprit, pour connoître que Luther n’a combatu que le sentiment de Molina. De sorte que puis que les thomistes soutiennent à cor et à cri, qu’ils reconnoissent une véritable liberté, et un véritable franc-arbitre dans l’homme, nos docteurs ont fort bien fait de dire la même chose, et de l’attribuer même à Luther et à Calvin. Car ces deux réformateurs n’ont jamais nié cela, au sens que les thomistes donnent à ces termes. Je m’étonne qu’on ne suive les thomistes jusques dans la forteresse de la liberté d’indifference ; car ils n’ont pas plus de raison que nous de l’abandonner, ou de la garder. On éviteroit par là cette vaine dispute de mots qui est entre nous et eux, sur la nature de la liberté. Ils se fâchent, je le sai bien, lors que les jesuites leur font la guerre de cette fraternité avec nous ; et le P[ère] Gonet, auteur célebre du Clypeus Theologie Thomisticæ, accuse La Milletiere de n’avoir pas bien entendu les sentimens des uns et des autres [17], lors qu’il a dit dans son projet de l’accord des deux religions, que les calvinistes et les thomistes convenoient sur le point de la liberté. Mais qu’y ferions-nous ? Pourquoi n’enseignent-ils d’autres choses, s’ils ne veulent pas qu’on les accuse ? Quoi qu’il en soit, la doctrine commune des protestans porte que la predestination et la réprobation absoluë, n’empêchent pas que l’homme n’agisse avec une pleine liberté.
[Sentiment de M. Jurieu sur ce sujet.] Il n’y a point d’homme parmi nous qui s’éloigne davantage des hypotheses des pelagiens, des semipelagiens, des molinistes, etc. que M. Jurieu. Il traite de fausse l’idée de la liberté qui enferme l’indifference. Cependant il soutient que l’homme agit librement, et il condamne de toute sa force les conséquences que les ismaëlites reconnoissoient. Voyez la page 226. de son Apologie pour la Réformation [18] ; vous y trouverez ces paroles, La liberté consiste à vouloir ce qu’on fait, et à faire ce qu’on veut, en sorte que l’on pût faire le contraire si l’on vouloit ; et point du tout dans l’indifference. Sur ce pied-là il soutient que Luther a reconnu une vraye liberté dans l’homme, dans tous les états où on le peut concevoir ; et il ne le blâme que d’avoir confondu le terme d’indifference et celui de liberté. Au reste, vous verrez dans la même page, que M. Jurieu attribuë aux thomistes et à Messieurs de Port-Royal, de ne reconnoître pas la liberté d’indifference [19]. Tout cela, Monsieur, ne vient que des diverses idées que nous nous formons vous et nous de l’indifference. Ainsi c’est pure question de nom.
[Et du P[ère] Maimbourg aussi.] On ne dira pas apparemment, que M. Jurieu et M. Maimbourg se soient donné le mot, pour rendre la même justice à Luther. Cependant ce jesuite avouë dans le I. livre du Lutheranisme [20], que Luther dit en termes formels, que dès là même que Dieu opere le vouloir dans la volonté, il est certain que la volonté veut, et qu’elle veut sans contrainte. Et comme une boule, poursuit le P[ère] Maimbourg, ne peut recevoir le mouvement qu’on lui donne, qu’elle ne roule, et qu’il est impossible que le fer recoive la chaleur, qu’il ne devienne chaud : de même la volonté ne peut recevoir par la grace le vouloir, qu’elle ne veuille effectivement le bien que la grace lui fait vouloir. L’héresie de Luther ne consiste donc pas en ce qu’il nie que la volonté agisse, puis qu’il dit positivement qu’elle veut sans violence et sans contrainte ; mais elle consiste précisément en ce qu’il dit qu’elle agit et veut par une immuable nécessité, et sans qu’il lui soit libre de ne pas vouloir. Ainsi tout homme qui soutient avec opiniâtreté, que la grace de Jésus-Christ nécessite la volonté au bien qu’elle lui fait vouloir, sans qu’elle puisse ne le pas vouloir, est un franc-lutherien. Cet auteur dit cela pour le compte de vos Messieurs de Port-Royal, comme il est aisé de le comprendre : mais il n’est pas plus difficile de connoître, qu’il tombe d’accord que Luther n’auroit pas nié que l’homme fût libre, si par libre il eût entendu ce qui agit volontairement, et à qui on peut faire produire tantôt l’une, tantôt l’autre des deux actions contraires. Je ne conçois pas qu’il soit possible qu’en suivant une telle definition, on revoque en doute la liberté. Je ne vois pas que les stoïciens avec leur fatum, ni Spinoza même qui ne reconnoît point d’autre Dieu que l’Univers, et qui met une si grande nécessité dans toutes choses, qu’il croit que rien n’est possible que ce qui est arrivé, ou ce qui arrivera ; je ne vois pas, dis-je, que les stoiciens, ni Spinoza ayent pû nier, que l’homme n’ait une parfaite liberté, selon cette definition [21]. Les pierres même seroient des causes très-libres, selon cette idée, si elle étoient capables de sentiment : car ce qu’on leur feroit vouloir, il est certain qu’elles le voudroient sans sentir aucune contrainte ; et de plus il est certain qu’avec la même facilité qu’on leur feroit aimer aujourd’hui le blanc, on leur feroit aimer le noir un autre jour. Il faut donc nécessairement que tous ceux qui nient la liberté des causes secondes, attachent une autre idée au mot de libre. Luther et Calvin, quand ils l’ont niée, y attachoient le sens des pelagiens, ou celui qu’on a nommé depuis moliniste ; et c’est ce / lui que la plus grande partie du monde confond avec celui d’indifference : de là est venu que j’ai dit que M. Arnauld ne croïoit pas une telle liberté.
[Réflexions générales.] Quoi qu’il en soit, Monsieur, je vous réïtere ce que je vous ai déja écrit, que si M. Arnauld veut que je publie qu’il croit la science moyenne, et la liberté d’indifference que les jesuites enseignent, (car c’est celle-là seulement que j’ai entendu qu’il ne croïoit pas) je suis tout prêt à le publier. Je n’aurai aucune honte de cette rétractation.
Excusez ma
Je vous crois fort persuadé, que ce Pere est plus ennemi des plaisirs des sens qu’une infinité de personnes, qui feroient scrupule de publier que ces plaisirs sont un bonheur. Mais comme je n’ai pas l’honneur d’être connu de vous, j’ai peut-être sujet de craindre que vous ne me croyez en quelque façon interessé à faire l’apologie du plaisir des sens. C’est pourquoi, Monsieur, je vous avertis que tous ceux qui me connoissent, amis ou non, vous pourront rendre témoignage, que je ne fais pas l’apologie de ces plaisirs par reconnoissance de l’obligation que je leur aye. Mais il s’en faut bien que je ne fasse leur apologie, puis que j’avouë qu’ils sont le piege le plus funeste et le plus victorieux, dont on doive demander ardemment à Dieu la destruction.
Notes :
[1] Bayle répond à la Lettre 471 d’Antoine Arnauld, publiée dans les NRL, décembre 1685, art. I, et qui constituait une réponse au compte rendu par Bayle dans les NRL d’août 1685, art. III, de son ouvrage Réflexions philosophiques et théologiques sur le nouveau système de la nature et de la grâce. Livre touchant l’ordre de la nature (Cologne 1685, 12°), par lequel le théologien de Port-Royal s’attaquait au Traité de la nature et de la grâce (Amsterdam 1680, 12°) de Malebranche.
[2] Allusion à Jean-Patrocle Parisot, La Foi dévoilée par la raison dans la connoissance de Dieu, de ses mystères et de la nature (Paris 1681, 8°). Bayle a expliqué ( NRL, octobre 1685, art. VII, §II) de façon très sarcastique, dans un « Supplément aux Nouvelles du mois passé […] touchant les livres qu’on s’étonne qui ne soient pas défendus en France », comment Parisot, voulant améliorer son livre qui subissait une censure, « ayant fait marché avec un théologien, un médecin, et un chymiste, de leur donner à chacun un écu par heure, pour les obliger à écouter la lecture de son livre, et à lui en donner leurs avis, il a très-souvent et pendant un fort long-temps, payé cette taxe aux trois auditeurs ». Sur Parisot, voir A. Mothu, « Un joachimite à l’âge de raison : Jean Patrocle Parisot », in Materia actuosa. Antiquité, Age classique, Lumières. Mélanges en l’honneur d’Olivier Bloch, dir. M. Benitez, A. McKenna, G. Paganini et J. Salem (Paris 2000), p.427-452.
[3] Bayle désigne ici les différences entre la version manuscrite de la Lettre 471, qui parut, d’une part, dans les NRL, décembre 1685, art. I, et qui fit l’objet, d’autre part, d’une publication indépendante, due à Arnauld (Delft 1685, 12°). Cette différence porte sur la Préface ajoutée par Arnauld à sa lettre publiée, Préface datée du 10 octobre 1685 et rédigée donc après réception du « simple billet » de Bayle. Ce « simple billet » par lequel Bayle a répondu à la lettre d’ Arnauld ne nous est pas parvenu.
[4] Alcibiade (vers 450-404 av. J.-C.), brillant orateur, homme d’Etat et général, personnalité puissante. Les historiens qui ont écrit sur lui sont Thucydide, dans son Histoire de la guerre du Péloponnèse, surtout livre 6 ; Plutarque, Vies parallèles des hommes illustres ; Cornelius Nepos, Vies des hommes illustres. Aucun de ces historiens ne semble s’être exprimé exactement dans les mêmes termes que Bayle, mais Nepos s’exprime ainsi dans son « Alcibiade », 3.5 : « tous les yeux, quand il paraissait en public, se fixaient sur lui et personne ne jouissait d’un rang égal au sien dans Athènes ; il inspirait de grandes espérances, mais aussi de grandes craintes, car faire beaucoup de mal et beaucoup de bien était également en son pouvoir ».
[5] Voir ci-dessus, n.4.
[6] Sur l’erreur de Bayle concernant la création de l’Académie royale des inscriptions et des médailles, voir Lettres 356, p.157 et n.6, et 388, p.259 et n.2.
[7] Sur cette méprise de Malebranche concernant une citation de saint Augustin sur les animaux machines, voir Lettre 301, n.5. A noter que Bayle évite de nommer ce « grand homme » en s’adressant à Arnauld, ce qui charge ce paragraphe d’un sarcasme humoristique. L’erreur de Malebranche provenait de la compilation d’ André Martin (pseud. Ambrosius Victor), Philosophia christiana (Paris 1671, folio, 6 vol.), dont le sixième volume était consacré à la question des animaux-machines. Voir Dictionary of 17th century French philosophers, dir. L. Foisneau, art. « Martin, André », par M.-F. Pellegrin.
[8] Voir Horace, Épîtres, II, 2, 126-128 (avec « vel » au lieu de « aut »). Bayle traduit avant de citer.
[9] On reconnaît ici la source du célèbre dialogue entre Des Grieux et Tiberge dans le roman de l’abbé Prévost, Manon Lescaut : voir Prévost, Œuvres, dir. Jean Sgard (Grenoble 1978-1986, 8 vol.), i.395-396, et A. McKenna, « La réalité des plaisirs, la plénitude du sentiment. Prévost, lecteur de Malebranche, de Bayle et de Pascal », in Philosophie des Lumières et valeurs chrétiennes. Hommage à Marie-Hélène Cotoni, dir. C. Mermaud et J.-M. Seillan (Paris 2008), p.105-124.
[10] Bayle songe sans doute à l’exemple de David, « l’homme selon le cœur de Dieu » dont les actions criminelles et licencieuses feront l’objet d’un long commentaire dans le DHC.
[11] « comme pour ses autels et ses foyers », formule devenue presque proverbiale, voir par exemple Tite-Live, Histoire romaine, X.44.8, Cicéron, De la nature des dieux, III.94, etc.
[12] Théophile Raynaud (1583-1663), Calvinismus bestiarum religio et appellatio pro Dominico Banne calvinismi damnato a Petro Paulo de Bellis (Lugduni 1630, 12°). Antoine Rivière est le pseudonyme de Théophile Raynaud.
[13] Allusion aux premières Lettres provinciales, où Pascal s’en prend à la distinction subtile et sophistique que les casuistes molinistes cherchaient à imposer entre la grâce suffisante et la grâce efficace.
[14] Il s’agit ici, non pas de Pierre Le Moyne, S.J. (1602-1671), auteur, avec Claude Morel (1608-1672), docteur de Sorbonne, sous le pseudonyme de M. Claude François, d’un traité antijanséniste intitulé Les véritables sentiments de saint Augustin et de l’Eglise touchant la grâce (Paris 1650, 8°), mais du docteur de Sorbonne Alphonse Le Moyne (vers 1590-1659), dont la doctrine ambiguë sur le « pouvoir prochain », doctrine commune à tous les « nouveaux thomistes », est ridiculisée par Pascal dans la première des Lettres provinciales (éd. L. Cognet et G. Ferreyrolles, Paris 1992, p.13 ss.) et dont les distinctions subtiles sur la « suffisance » de la grâce font l’objet d’une analyse impitoyable dans la quatrième des Lettres pascaliennes ( ibid., p.58 ss.). Alphonse Le Moyne n’avait pas publié ses cours, mais Antoine Arnauld a disposé des cahiers de deux étudiants, Métayer et Girard, qui lui ont permis d’écraser la doctrine du professeur dans son Apologie pour les saincts Pères de l’Eglise, défenseurs de la grâce de Jésus-Christ, contre les erreurs qui leur sont imposées dans la traduction du « Traité de la vocation des gentils » attribué à saint Prosper ; dans le livre de M. Morel […] ; et dans les écrits de M. Le Moine, Docteur de Sorbonne. Par le sieur de La Motte, docteur en théologie (Paris 1651, 4°) : Bayle pense certainement au passage de l’ Apologie (in Œuvres, Paris, Lausanne 1775-1783, 4°, 43 vol., xviii.847) résumé par Pascal ( Lettres provinciales, IV, éd. citée, p.58 ss.).
[15] Sur Pierre-Sylvain Regis (forme latinisée de son patronyme Le Roy), philosophe cartésien, voir Lettre 322, n.11, et Dictionary of 17th century French philosophers, dir. L. Foisneau, s.v. (article de S. Charles). En 1665, il avait séjourné à Toulouse – qui est sans doute la « ville où il ne s’en faut gueres que l’Inquisition ne soit sur le trône » – où il tenait des conférences publiques afin de vulgariser les thèses cartésiennes. Ces conférences furent fortement appréciées pour leur accessibilité, malgré la difficulté du sujet abordé, et le succès fut tel que le marquis de Vardes, alors de passage à Toulouse, demanda à Regis de l’accompagner à Aigues-Mortes puis à Montpellier pour y propager la doctrine cartésienne, ce qu’il fit avec succès. Il ne revint à Paris qu’en 1680. Regis n’avait encore rien publié à cette époque. Bayle tire son information sans doute d’un ouvrage polémique émanant de Port-Royal où la doctrine professée par Regis est défendue contre les jésuites.
[16] Nouvelle allusion au projet de publication des conférences de Regis chez Reinier Leers à Rotterdam : le projet ne se réalisa pas et l’ouvrage ne devait paraître qu’en 1690, sous le titre Systéme de philosophie contenant la logique, la métaphysique, la physique, la logique et la morale (Paris 1690, 4°, 3 vol.) : voir Lettre 322, n.11.
[17] La défense de la théologie thomiste par le Père Jean-Baptiste Gonet, O. P., Clypeus theologiae thomisticae contra novos ejus impugnatores (Burdigalae 1659-1663, 12°, 5 vol. ; Lugduni 1681, folio, 6 vol.), connut plusieurs éditions augmentées ultérieures. Bayle se réfère à sa réfutation de Théophile Brachet de La Milletière sur la doctrine de la liberté : « Apologia thomistarum seu calvinismi et jansenismi depulsio » (2 e éd., i.537-570) : « Præter ea quæ hactenus, impugnatore P. Annato, argumenta objecta sunt, eoque defensore soluta, & quæ inter argumenta à priori, qualia adversariis suppetunt, reponere licet ; urget etiam Canonem Concilii Tridentini, & contendit Thomistis, non solùm cum Evangelicis, quo nomine Calvinistas designat, communem esse sententiam, sed utroque etiam habere in definitionibus Tridentini quod deleri cupiant. Cujus rei judicem facit Theophilum Brachetum, vulgò Milletierum. Sed eam accusationem idem Author depellit, eadem responsione ad Epist. 17 Montaltii, quâ Thomistis nihil timendum asserit à fulminibus & anathematismis Tridentini ; cùm modus defendendi gratiam per se efficacem, quem docent, orthodoxus sit, et sanctiis authoritate Conciliorum principiis suffultus. » ( ibid., i.541).
[18] Pierre Jurieu, Histoire du calvinisme et celle du papisme mises en parallèle, ou Apologie pour les Réformateurs, pour la Réformation et pour les réformés… contre un libelle intitulé l’“Histoire du calvinisme”, par M. Maimbourg, I re partie (Rotterdam 1683, 4°) : « Au reste il n’est pas estonnant que Luther ait confondu le terme d’indifference et celuy de liberté, ayant vescu dans un siecle et ayant esté élevé dans des escoles où l’on avoit par de fausses definitions si fort atteché l’idée d’indifference à celle de liberté qu’il sembloit que ce fust la mesme chose. Dans le fonds Luther a reconnu une vraye liberté dans l’homme dans tous les estats où on le peut concevoir. C’est ce qu’il appelle mera lubentia, pronitas, spontaneitas : l’homme, dit-il, agit volontairement et sans contrainte : qui agit volontairement agit librement ; car la liberté consiste à vouloir ce qu’on fait, et à faire ce qu’on veut, en sorte que l’on pust faire le contraire si l’on vouloit ; et point du tout dans l’indifference. » (p.226).
[19] Ibid., p.226 : « Messieurs de Port Royal au lieu du mot liberté mettroient celui d’indifference […]. Si les nouveaux thomistes veulent suivre leurs principes ils ne parleront pas autrement. »
[20] Louis Maimbourg, Histoire du luthéranisme (Paris 1680, 4°) : « Je sçay bien qu’il [ Luther] ajouste que la volonté de l’homme ne fait que recevoir le bien que Dieu opere en elle tout seul, sans qu’elle y contribuë rien de sa part : mais il ne veut dire par là que la mesme chose, à sçavoir que c’est Dieu seul qui détermine la volonté à vouloir, & qu’elle n’a point de liberté pour se déterminer, ou à vouloir, ou à ne pas vouloir. Car dés-là mesme que Dieu opere le vouloir dans la volonté, il est certain que la volonté veut, & qu’elle veut sans contrainte, ainsi que Luther le dit en termes formels. Et comme une boule ne peut recevoir le mouvement qu’on luy donne qu’elle ne roule, & qu’il est impossible que le fer reçoive la chaleur qu’il ne devienne chaud : de mesme la volonté ne peut recevoir par la grace le vouloir qu’elle ne veuïlle effectivement le bien que la grace luy fait vouloir. » (livre I, p.97).
[21] Bayle reviendra sur cette question dans le DHC, art. « Chrysippe », rem. H, et « Spinoza », rem. A et M. La question de la liberté humaine compatible avec la grâce allait devenir une question brûlante, car Bayle l’érige en objection à la doctrine du petit nombre des élus : en effet, si, au moyen de la grâce, Dieu peut infléchir la volonté des hommes vers le bien sans les priver de leur liberté (entendue, par les augustiniens ainsi que par Bayle, comme absence de contrainte), il pouvait donc accorder sa grâce à tous les hommes, sans les priver de leur liberté et conformément aux exigences de Sa bonté infinie. La doctrine du « petit nombre des élus » auxquels Dieu aurait accordé Sa grâce est donc une doctrine incompatible avec notre conception des qualités divines, ce qui achève de ruiner la théologie rationaliste.
[22] Bayle applique la formule célèbre de Pascal dans la XVI e Lettre provinciale : « Mes Révérends Pères, mes lettres n’avaient pas accoutumé de se suivre de si près, ni d’être si étendues. Le peu de temps que j’ai eu a été cause de l’un et de l’autre. Je n’ai fait celle-ci plus longue que parce que je n’ai pas eu le loisir de la faire plus courte. » (éd. L. Cognet et G. Ferreyrolles, Paris 1992, p.325-326).
[23] Allusion à la réponse de Malebranche à Arnauld : Lettres du P. Malebranche à un de ses amis, dans lesquelles il répond aux Réflexions de M. Arnauld sur le « Traité de la nature et de la grâce » (Rotterdam 1686, 12°) : voir Lettre 471, n.1.