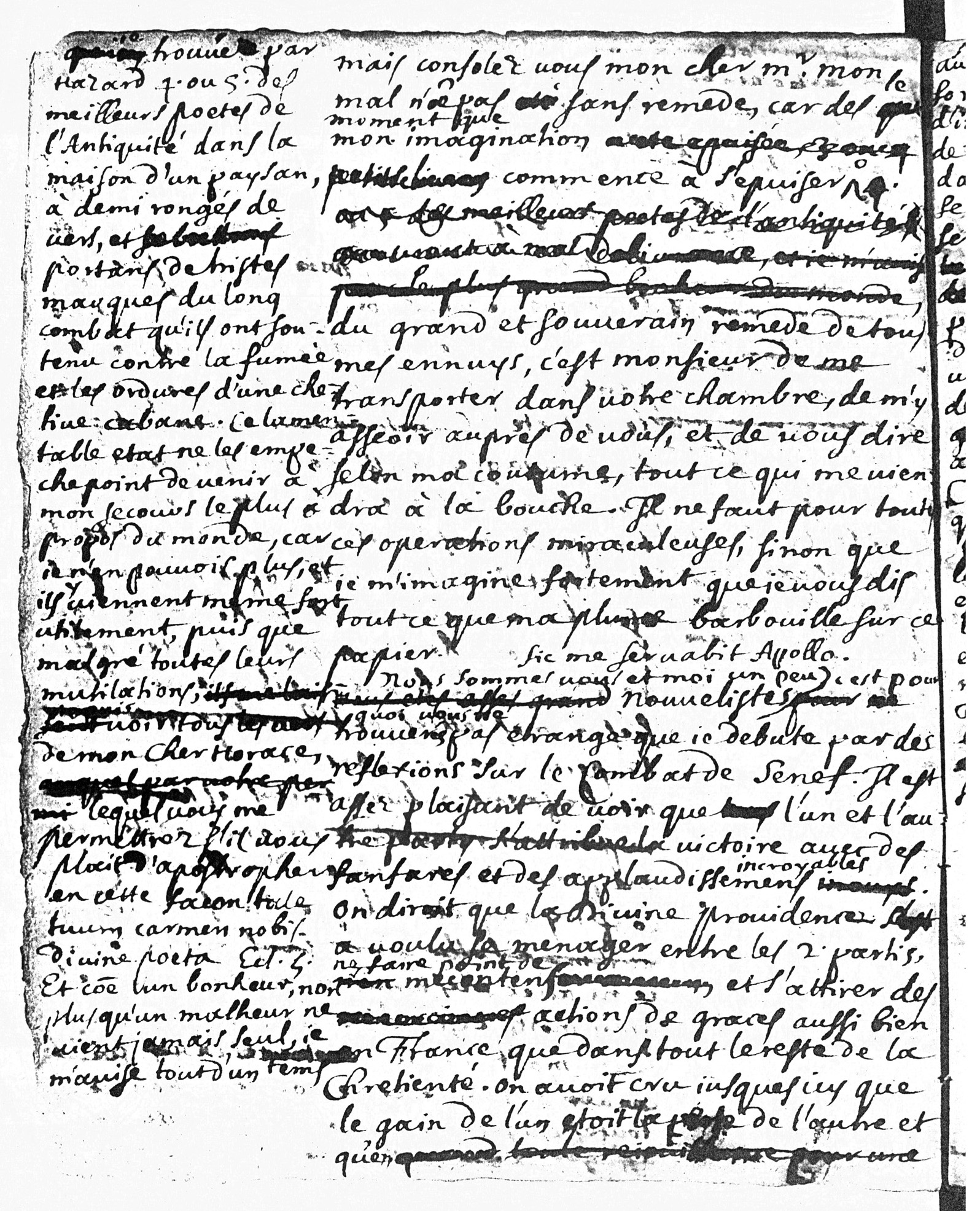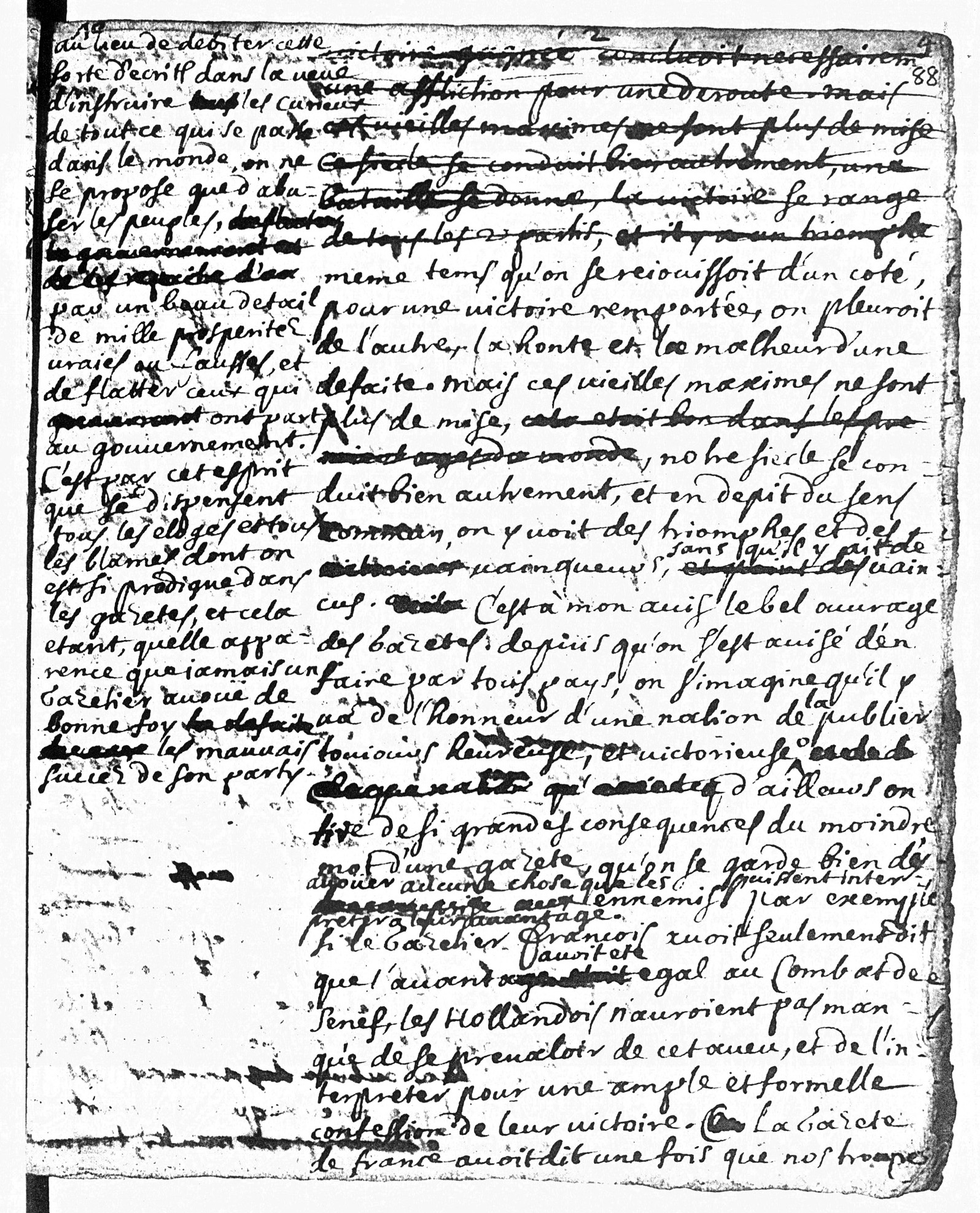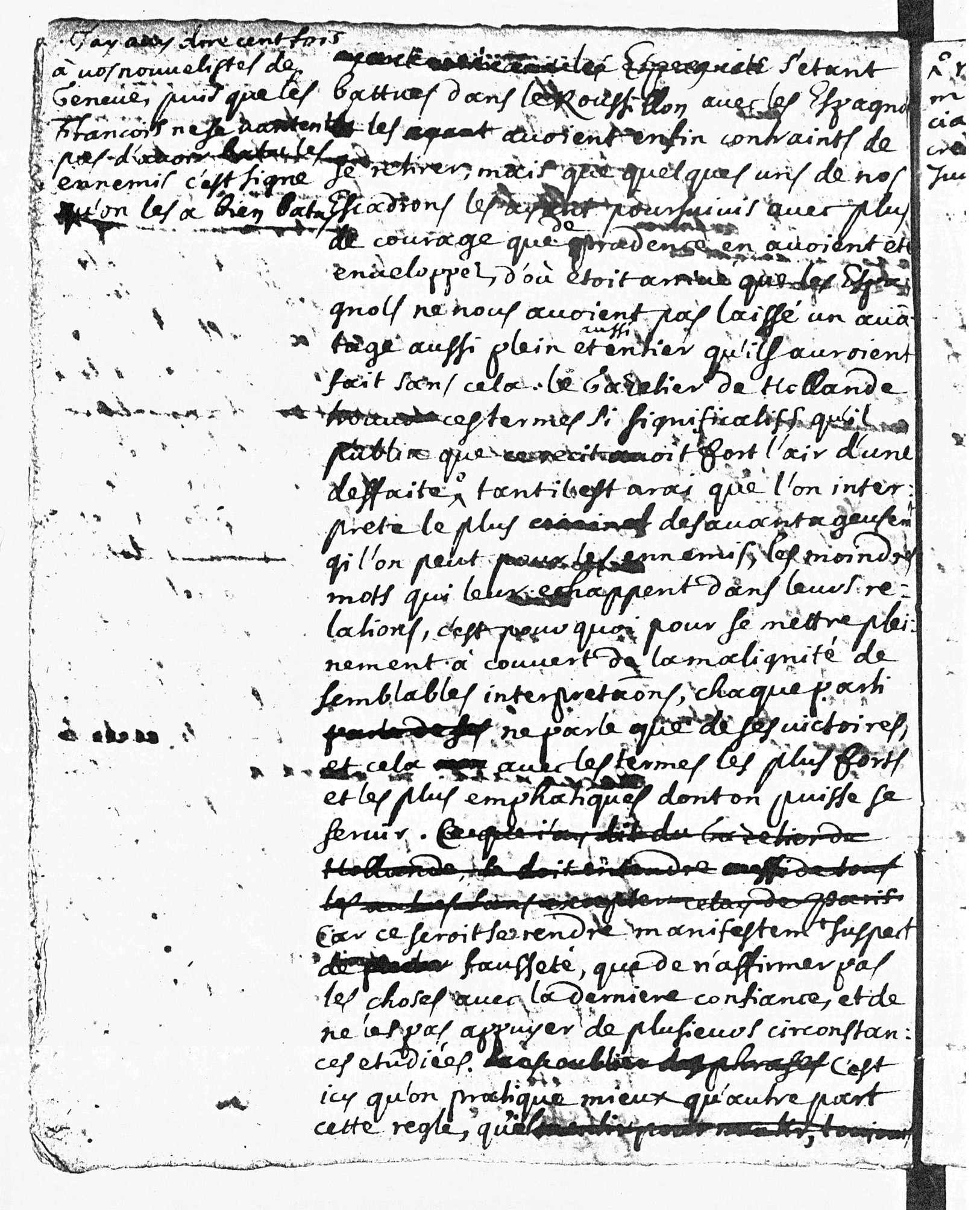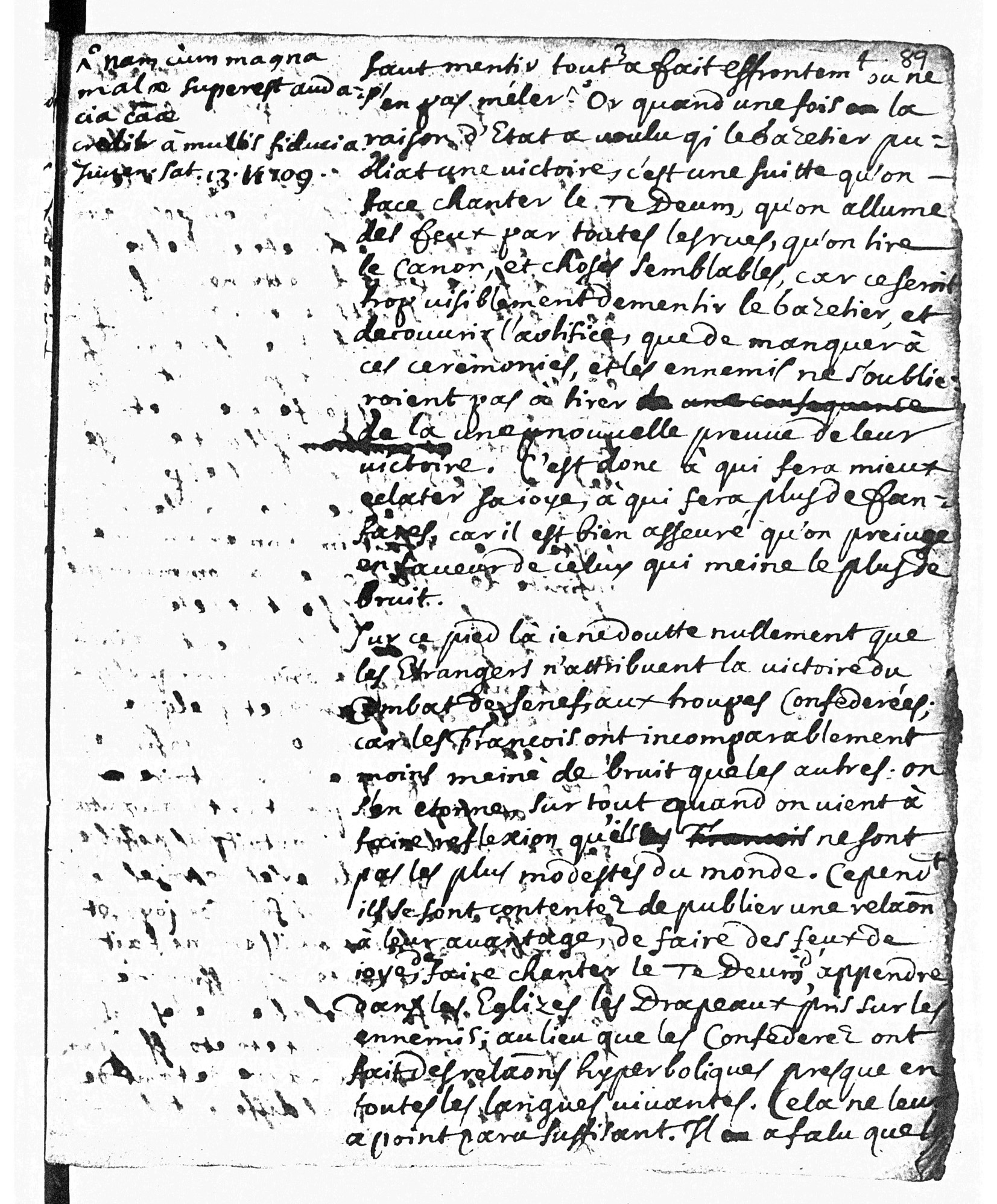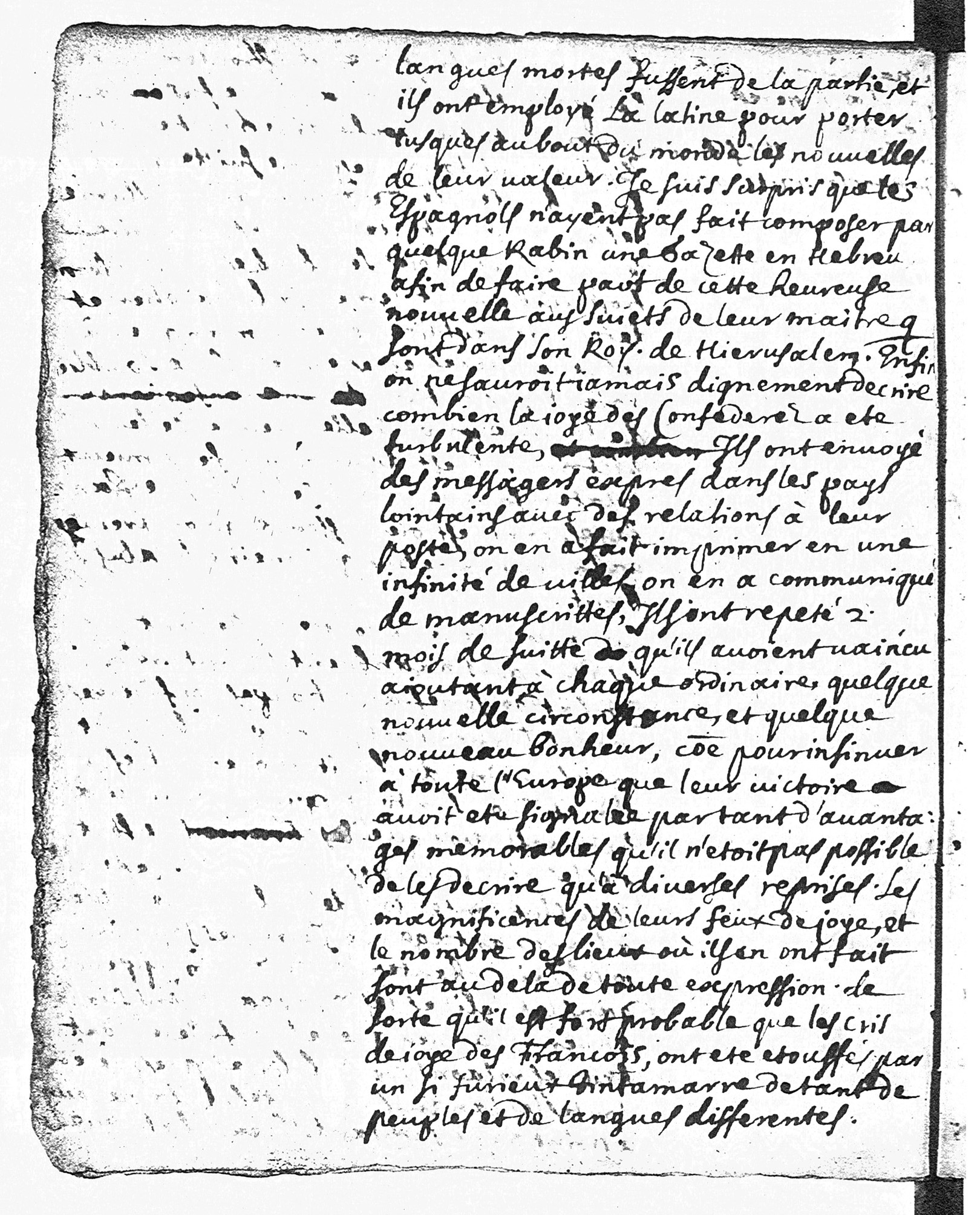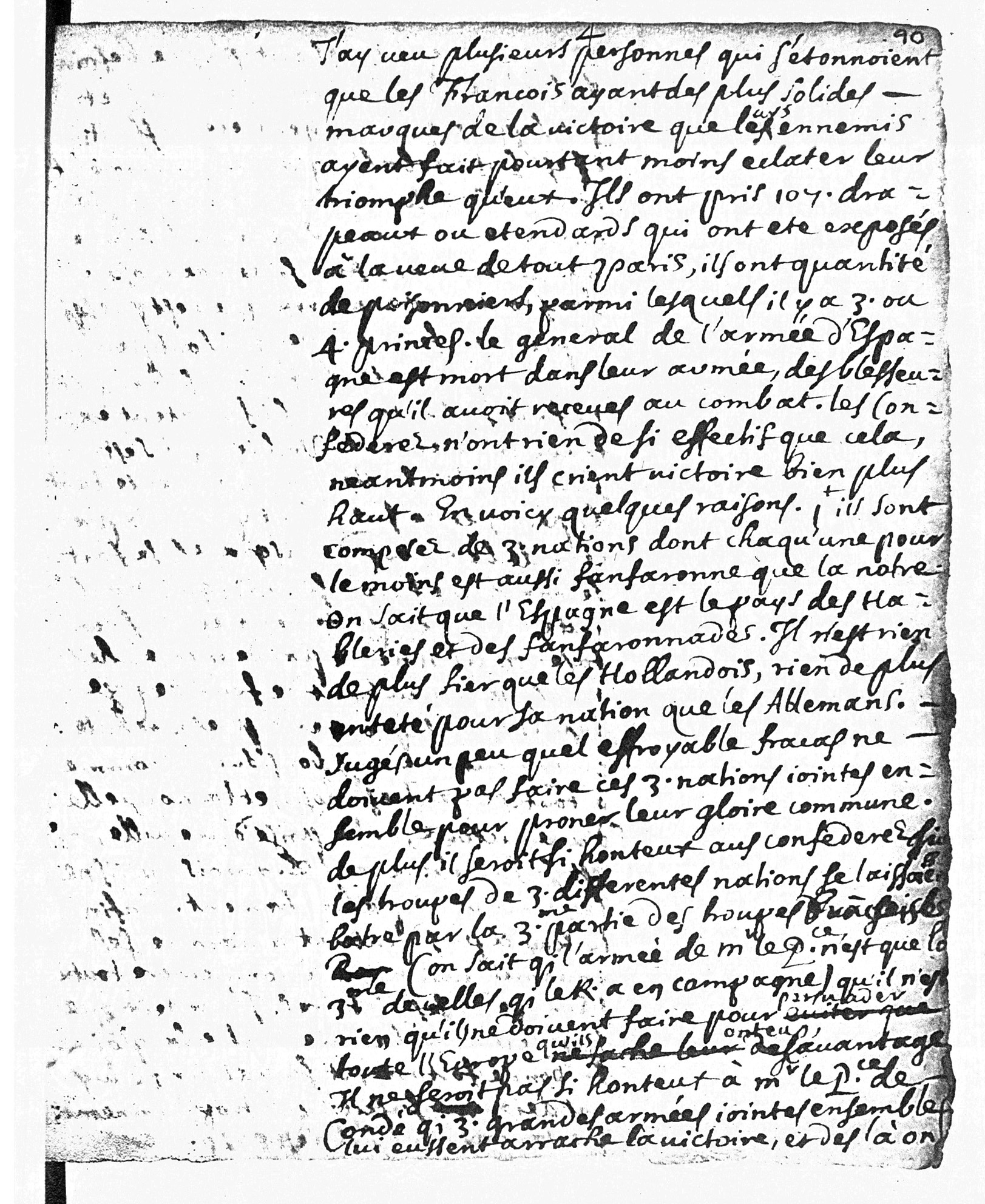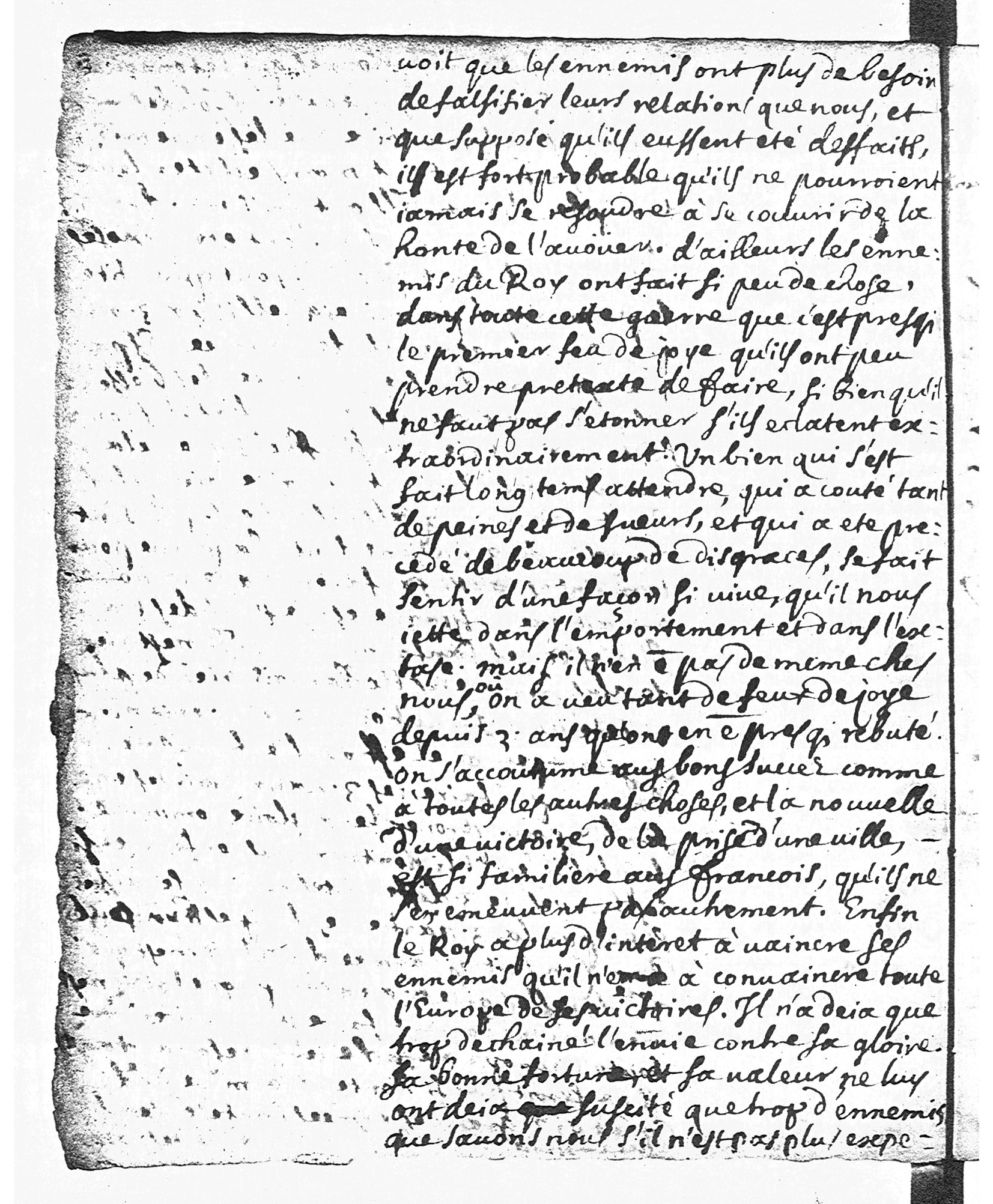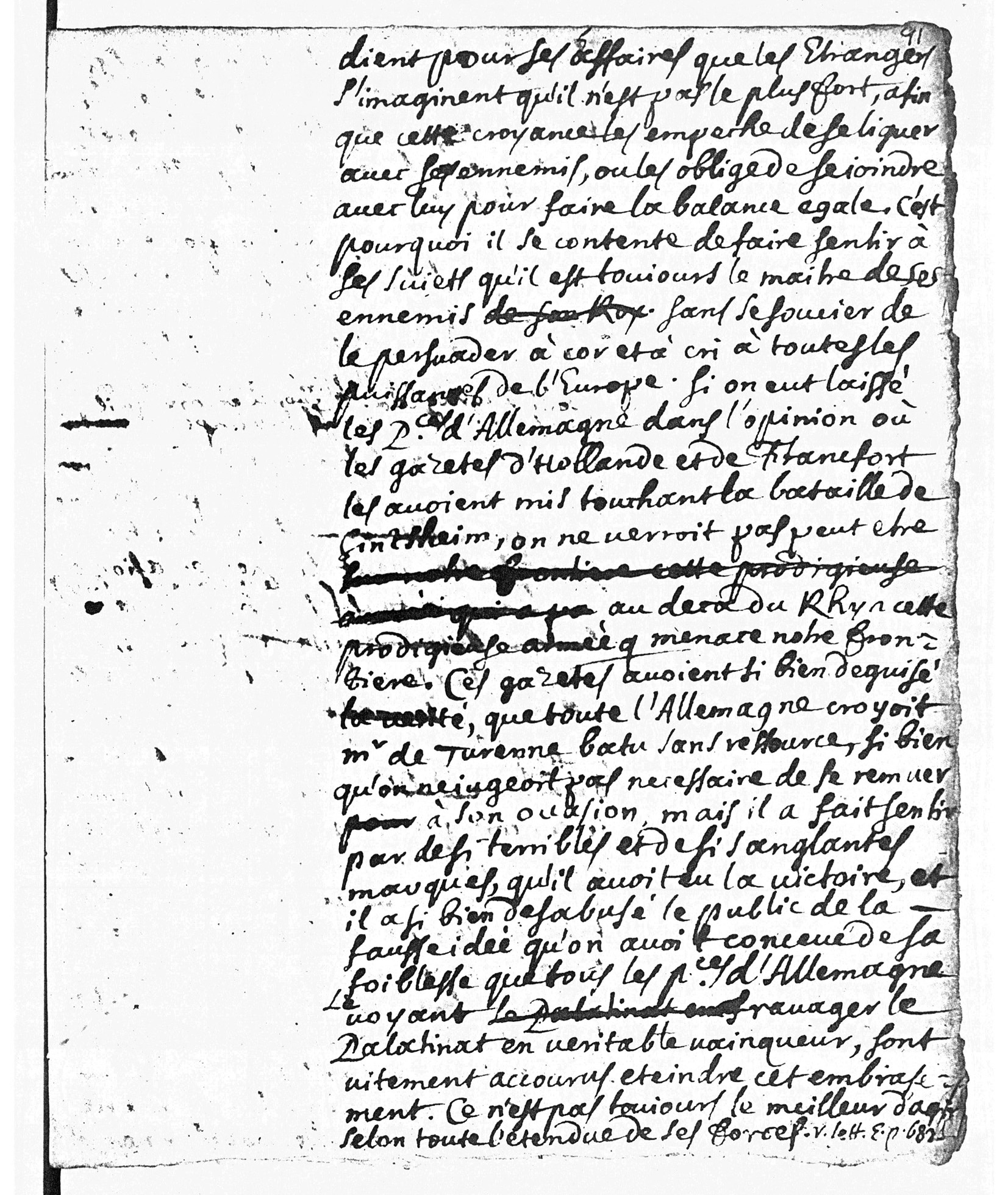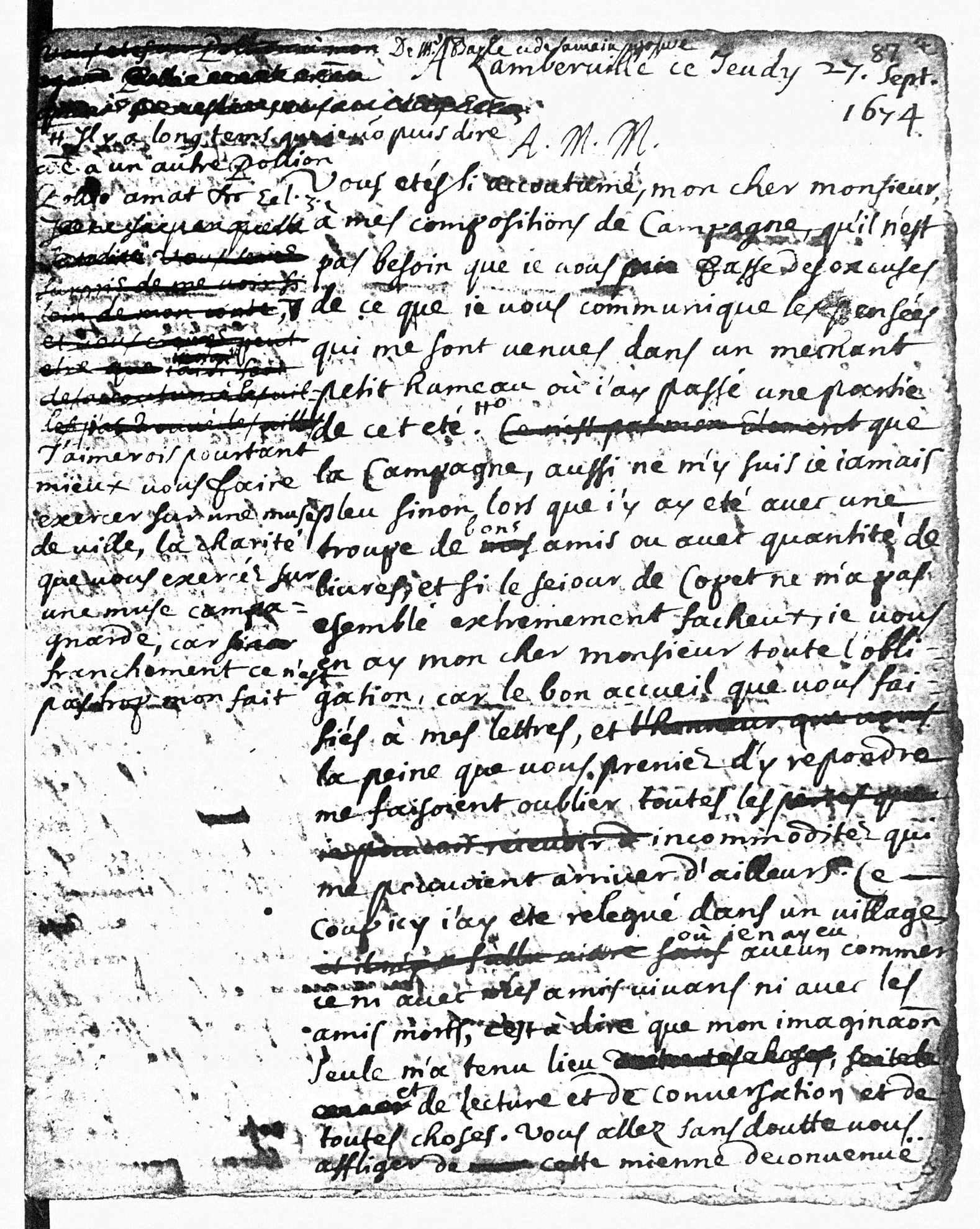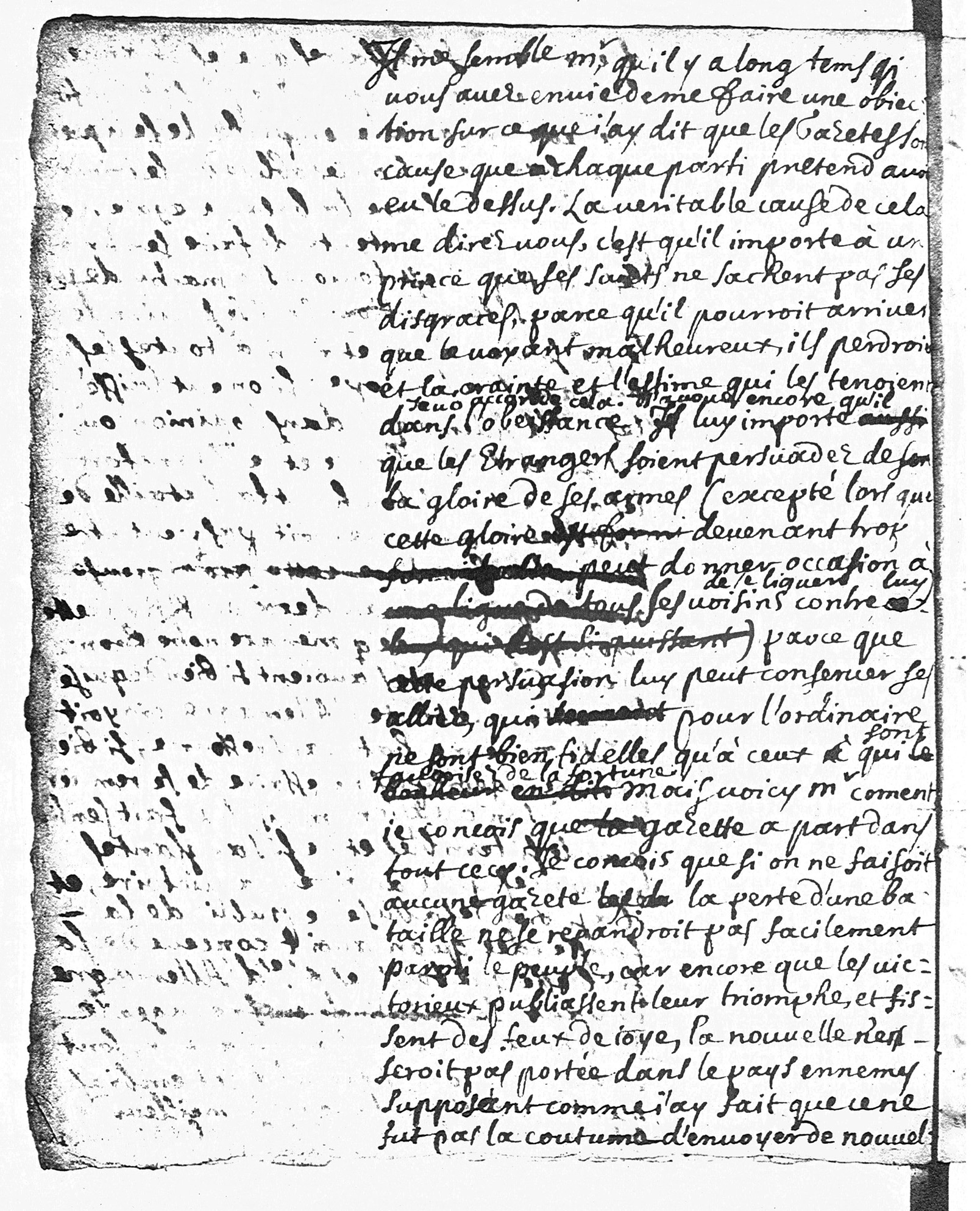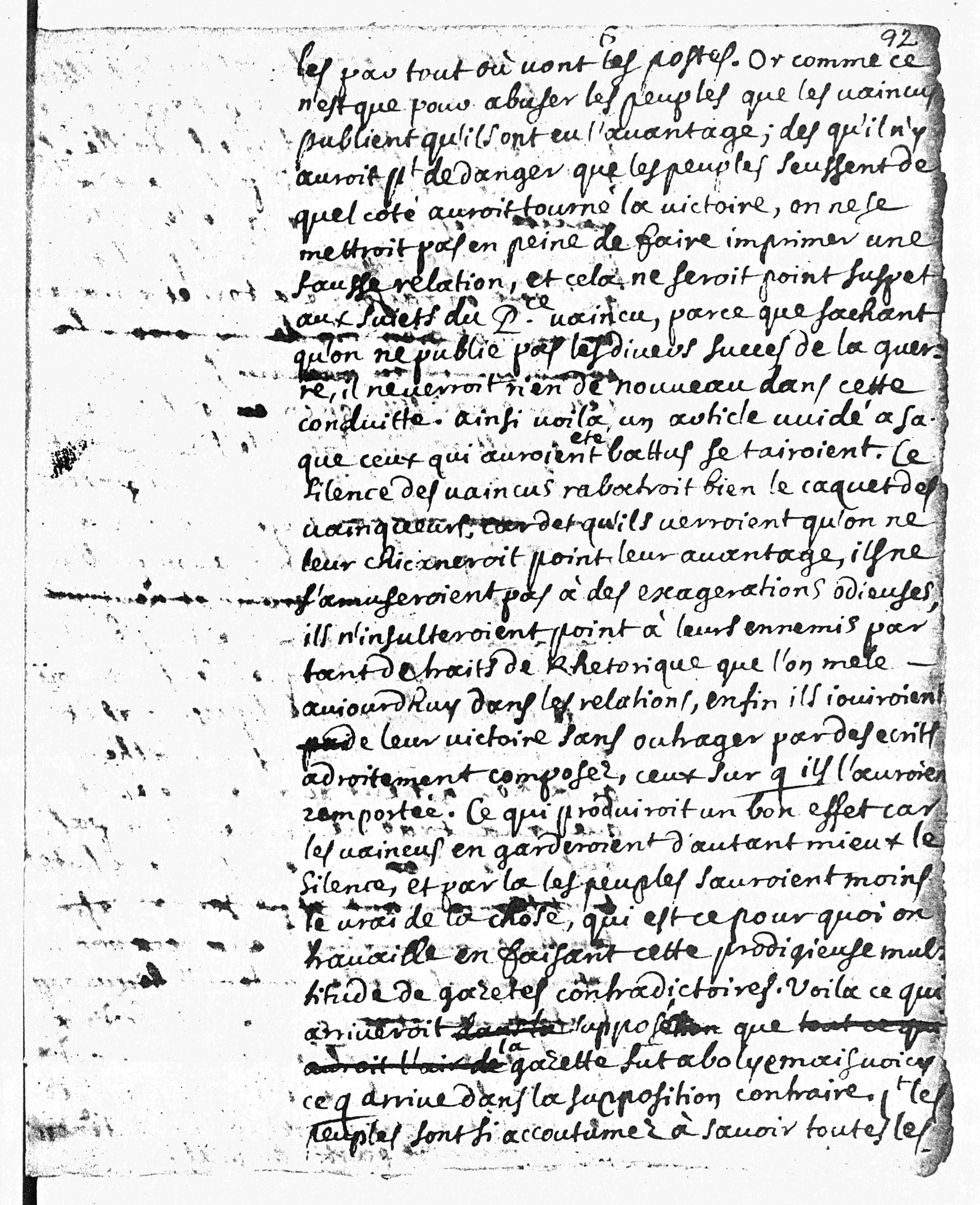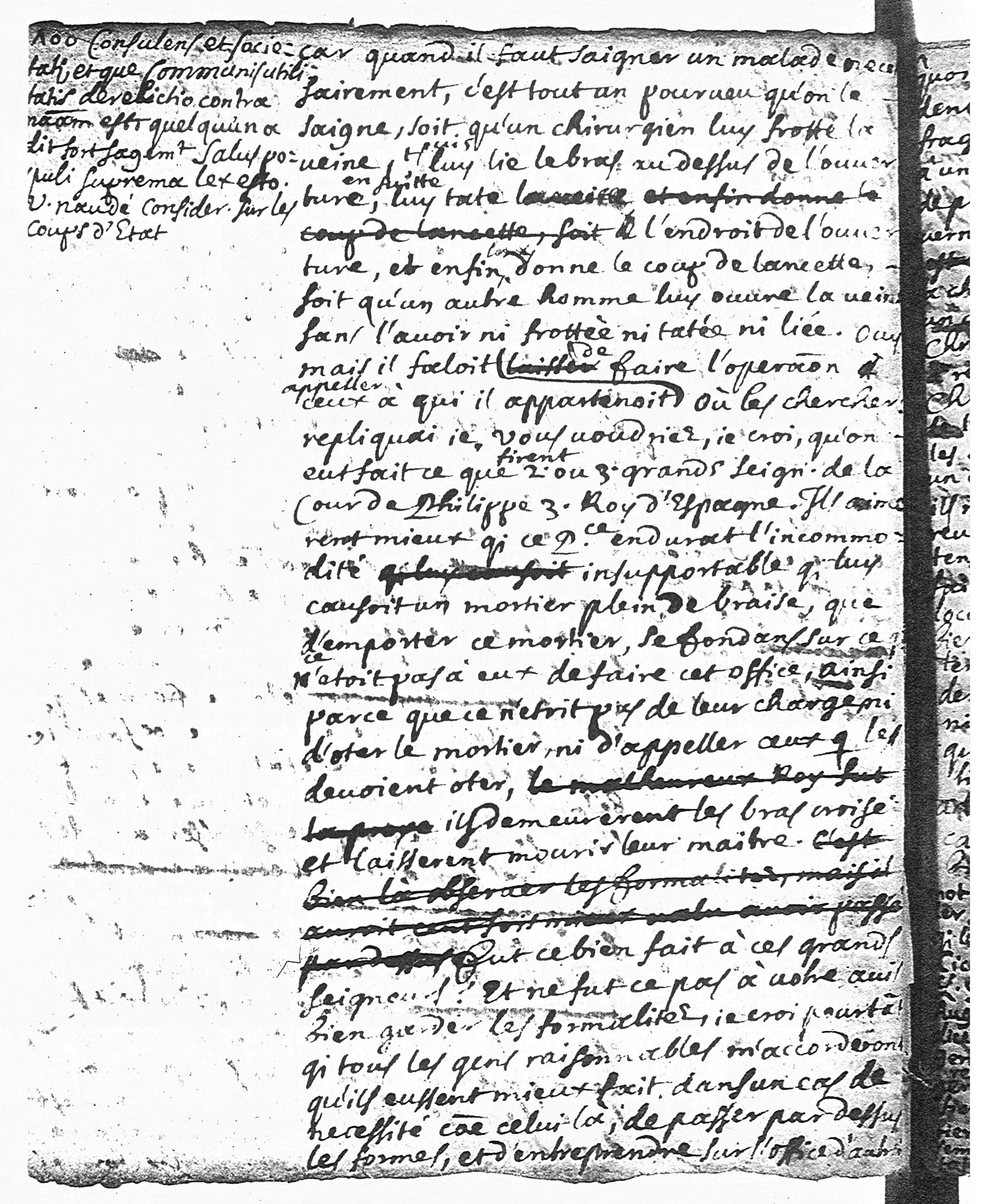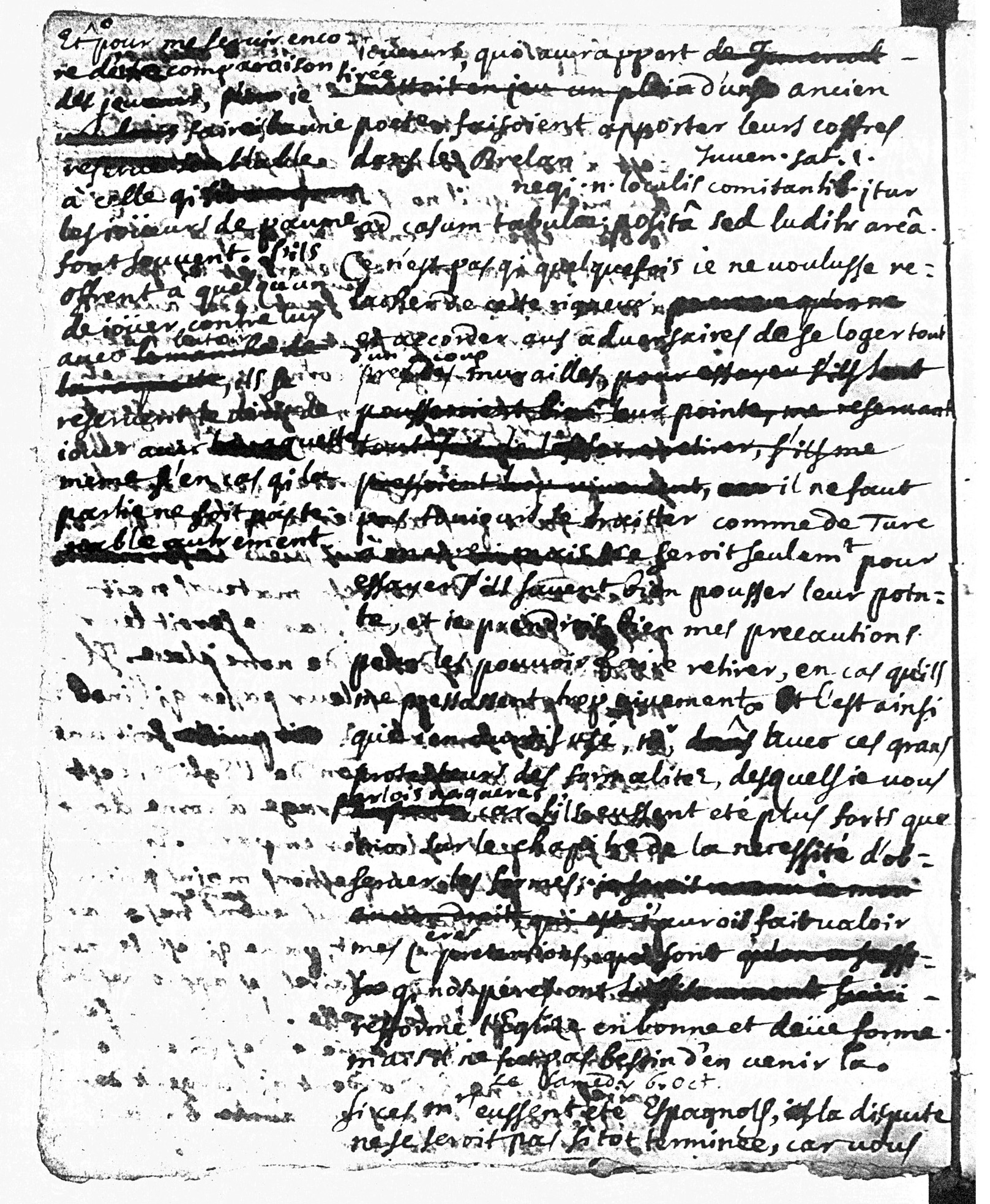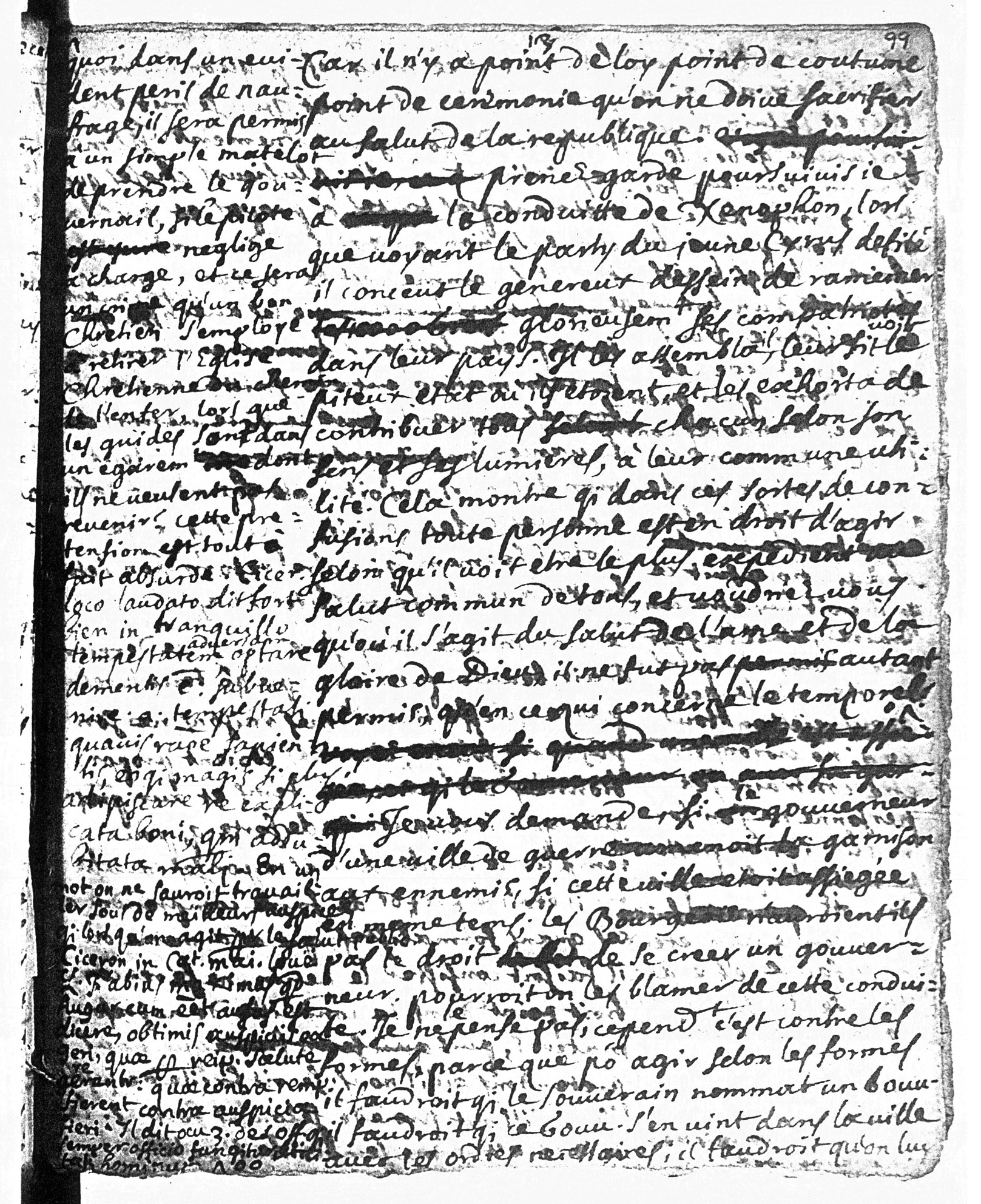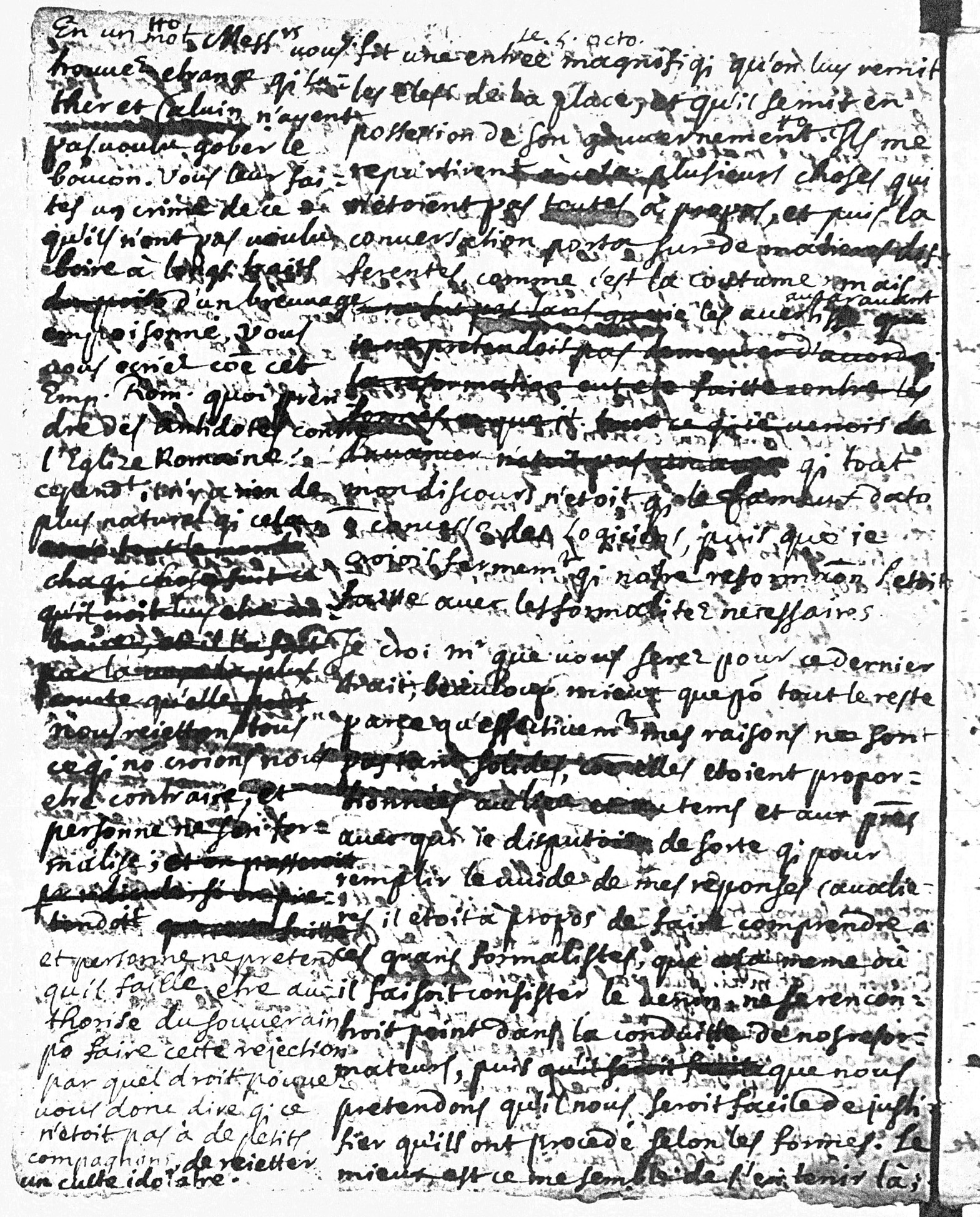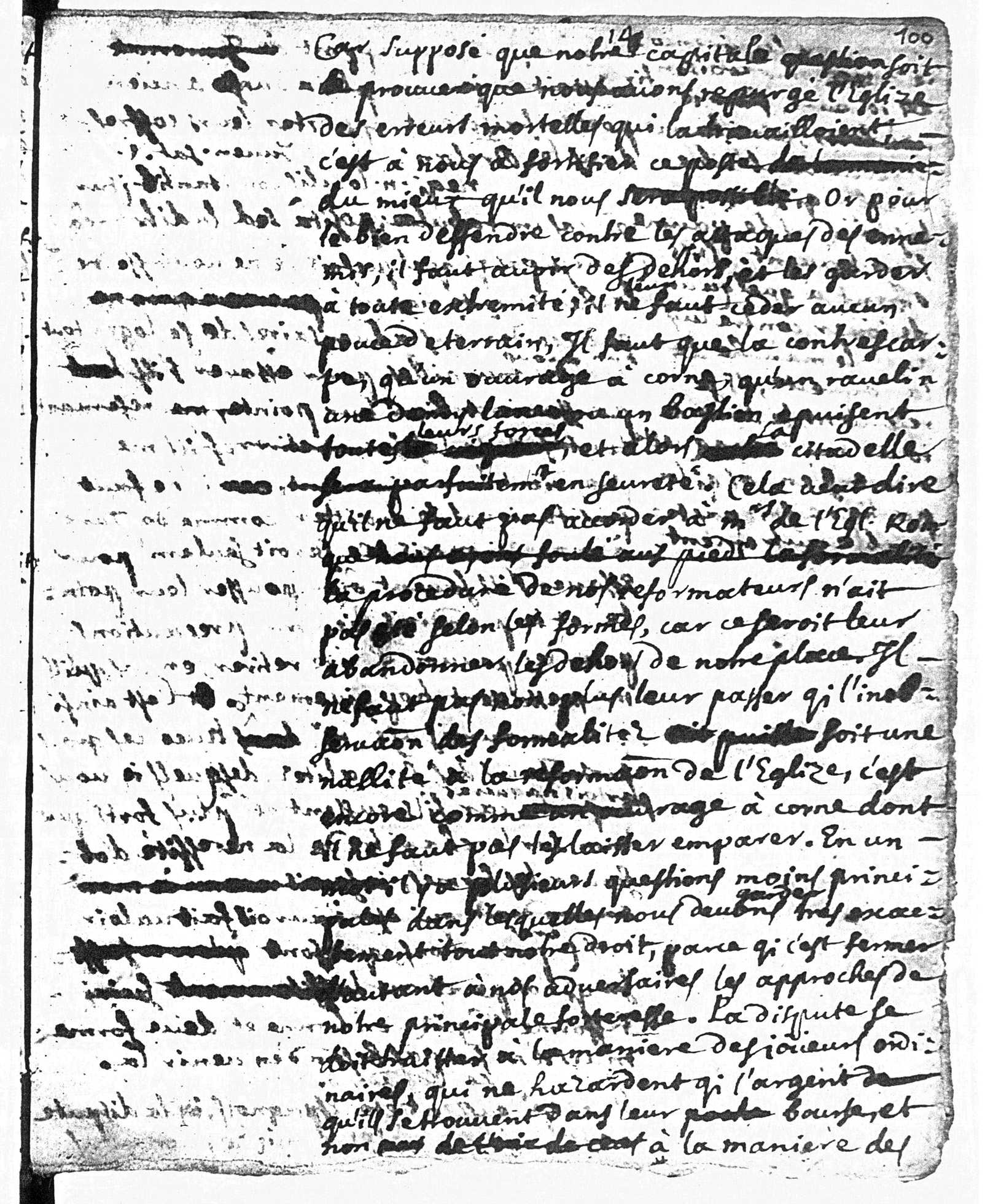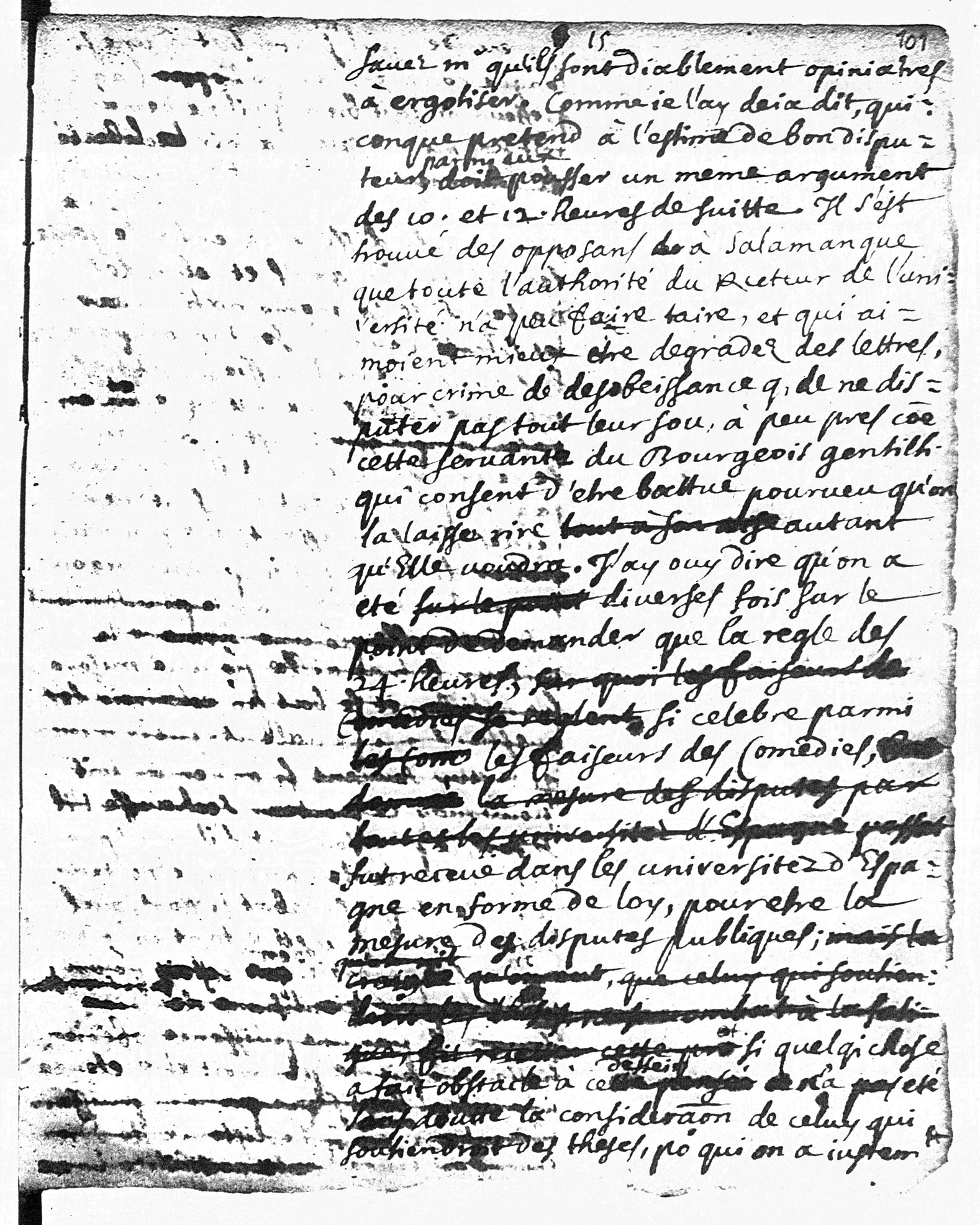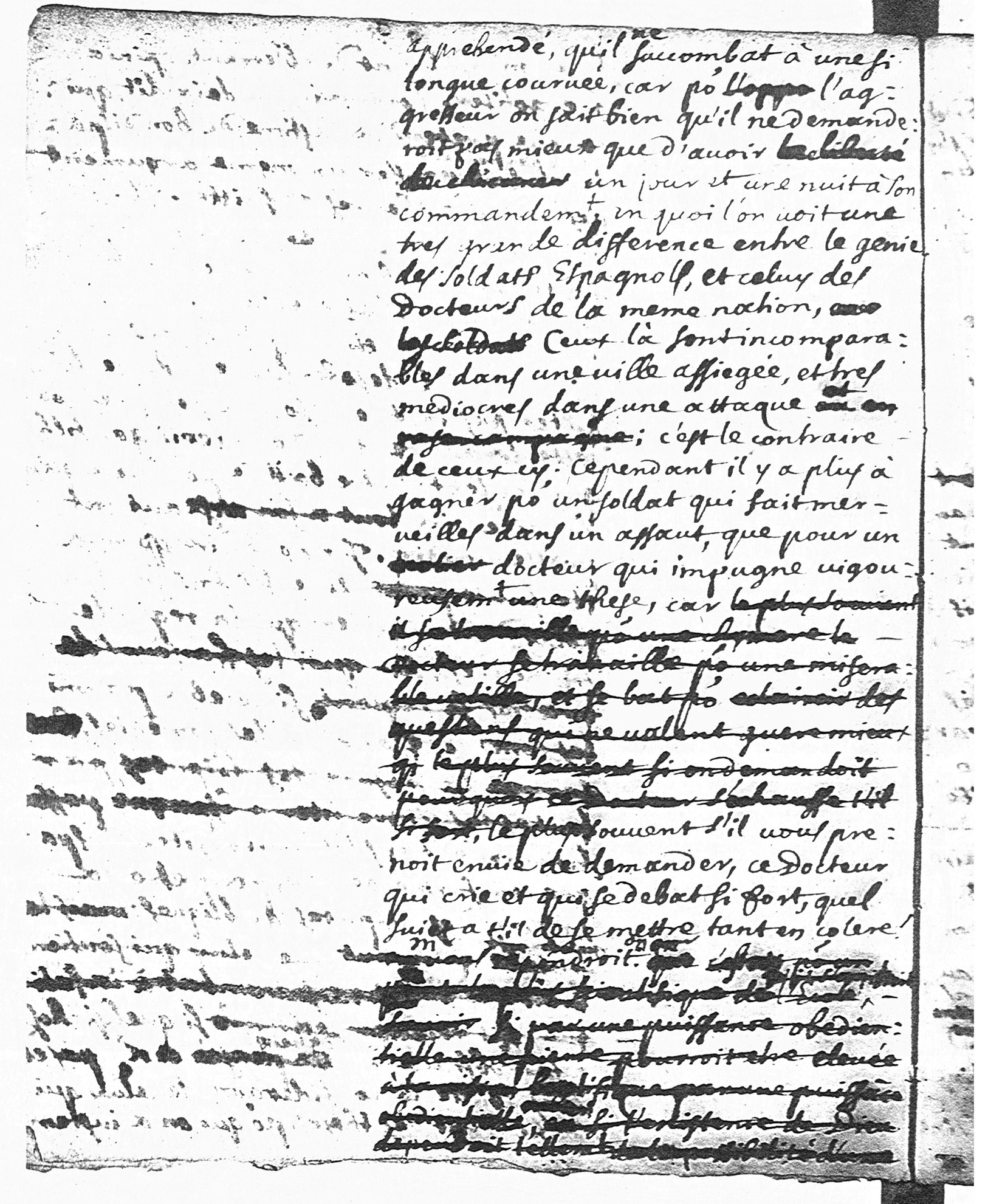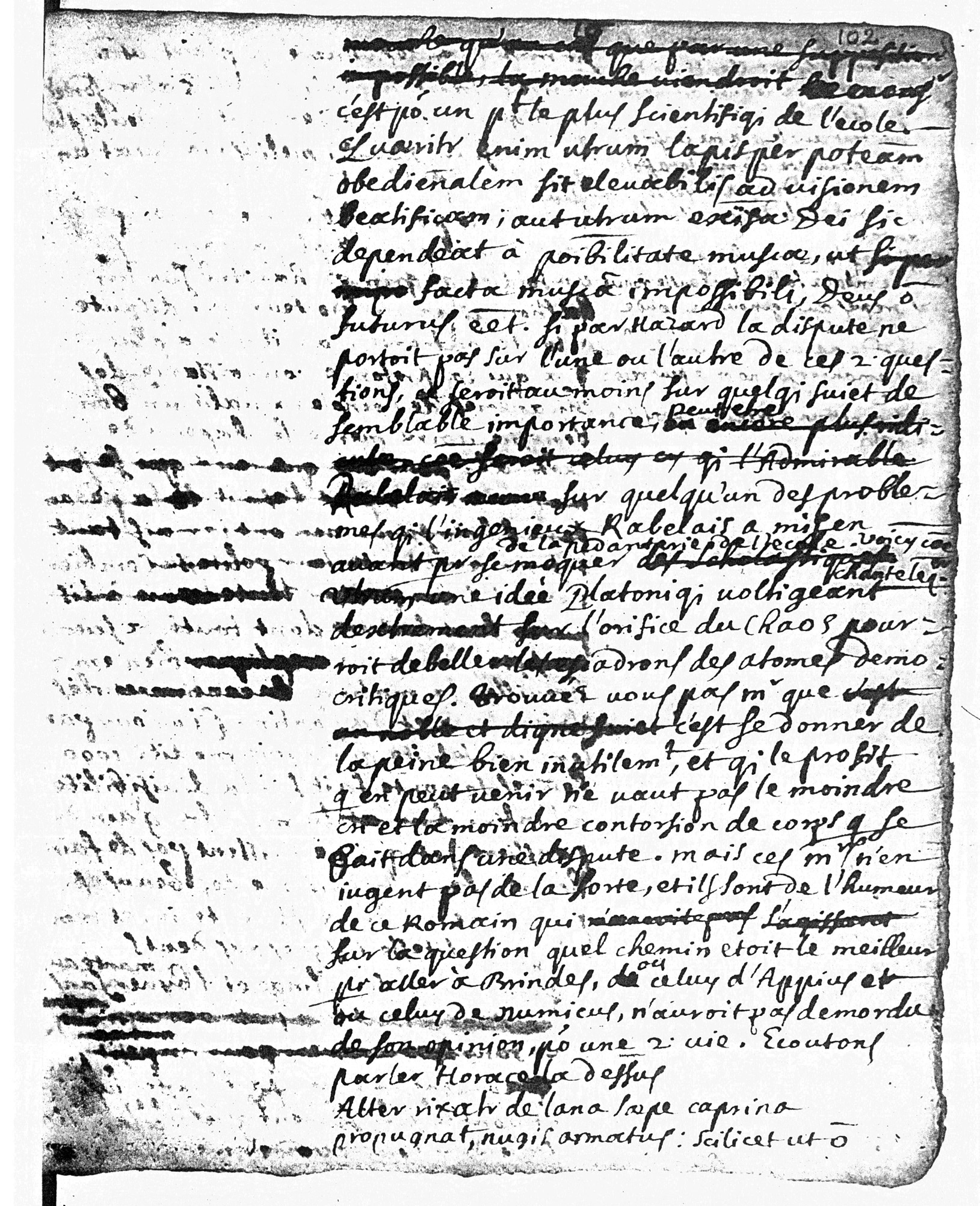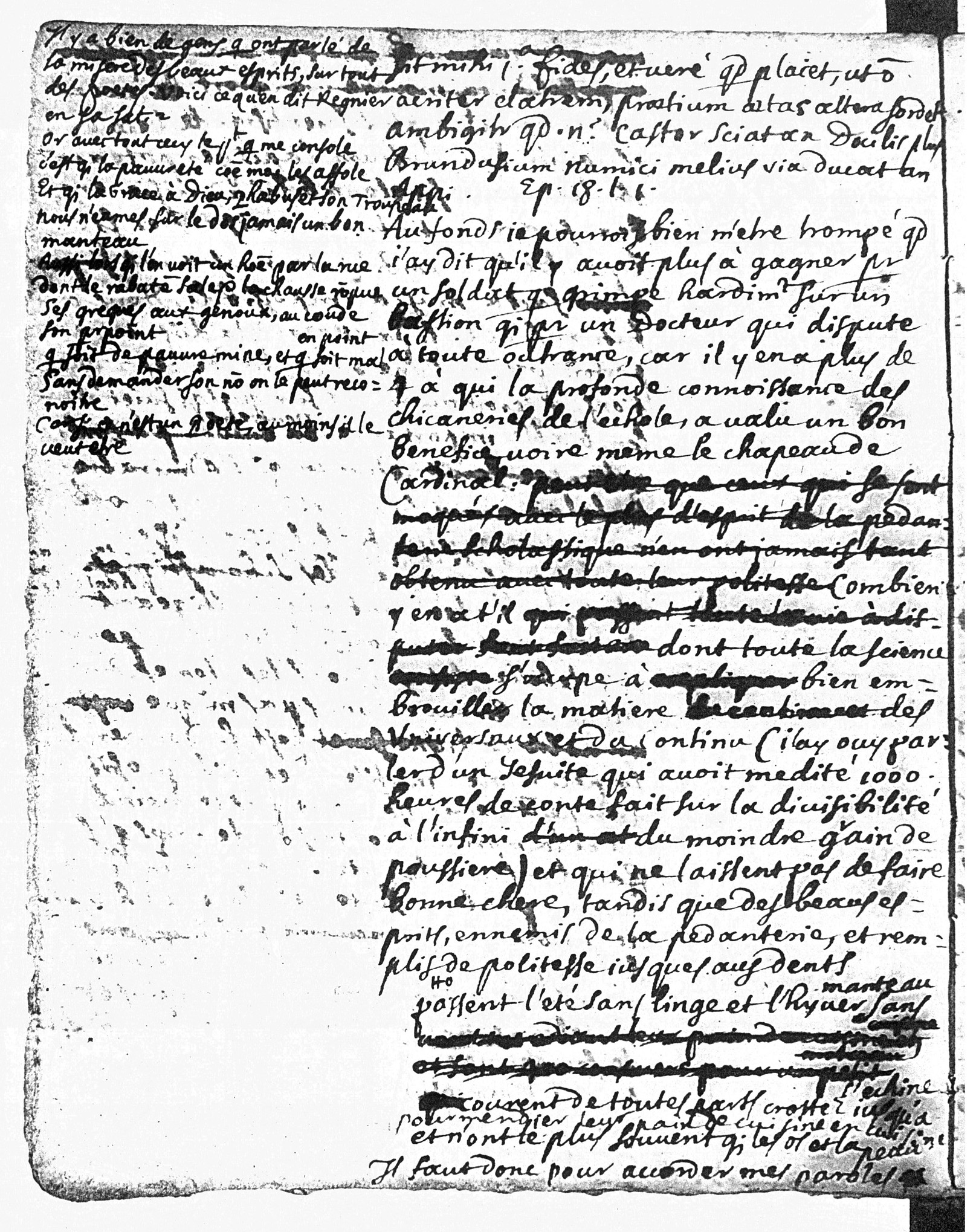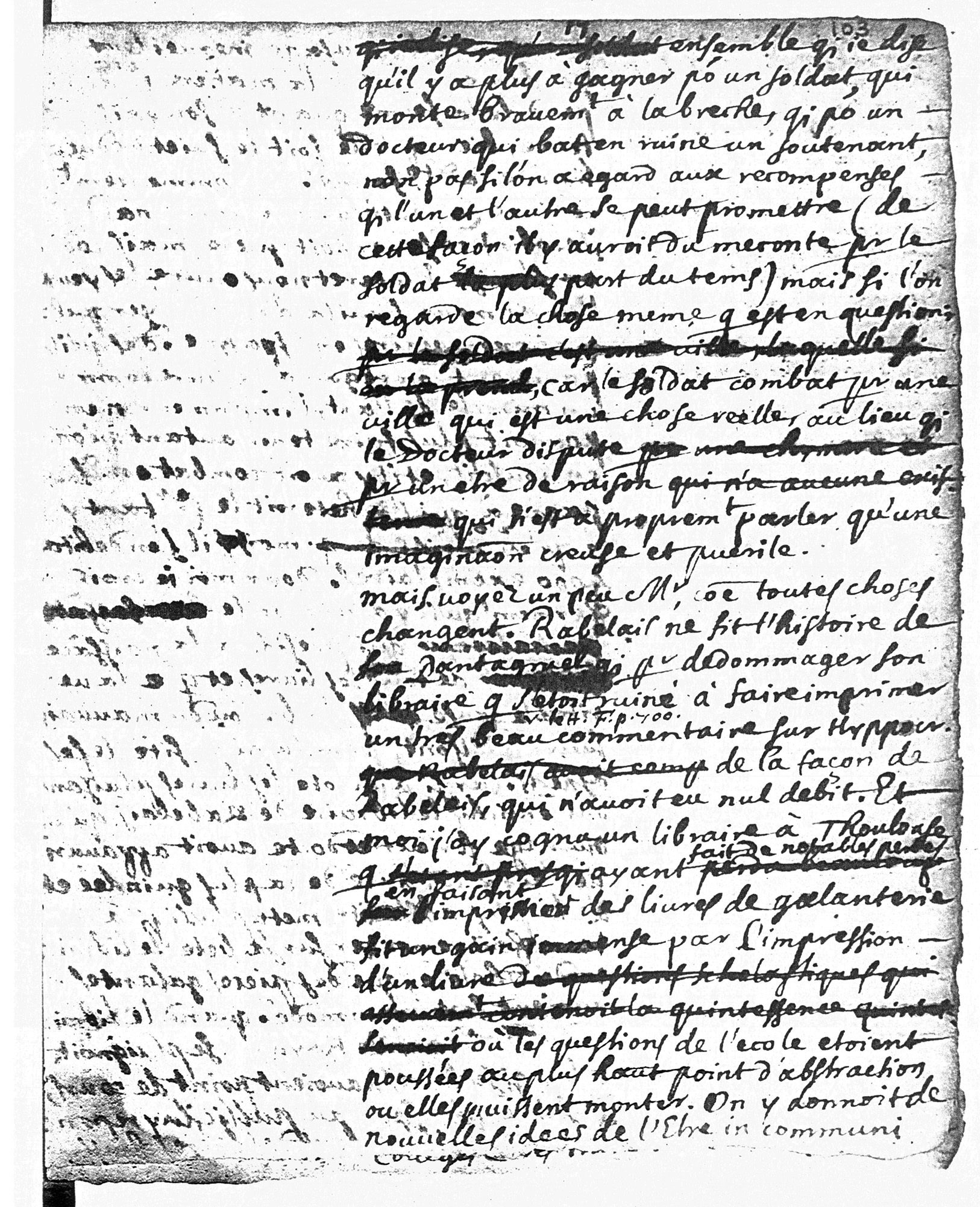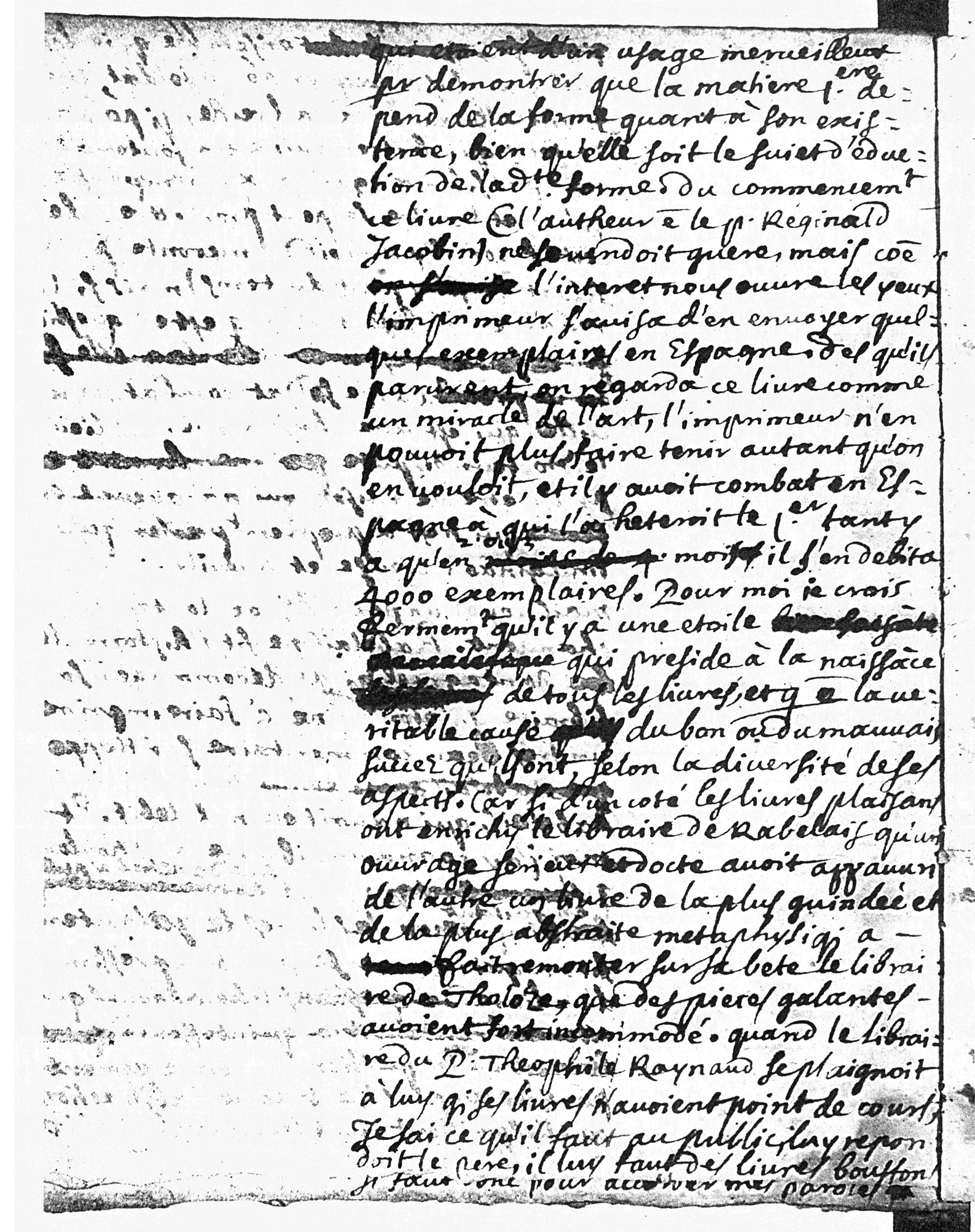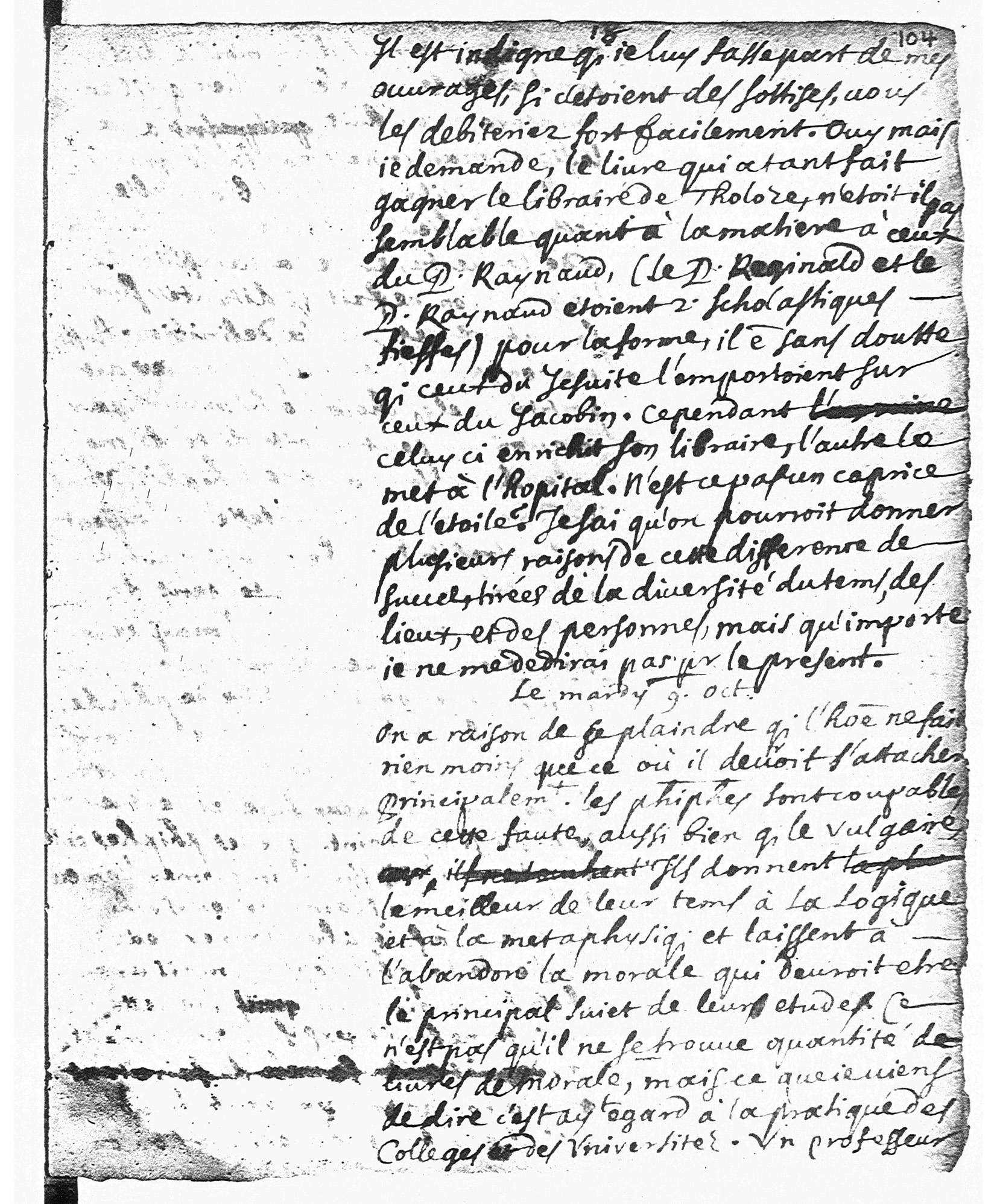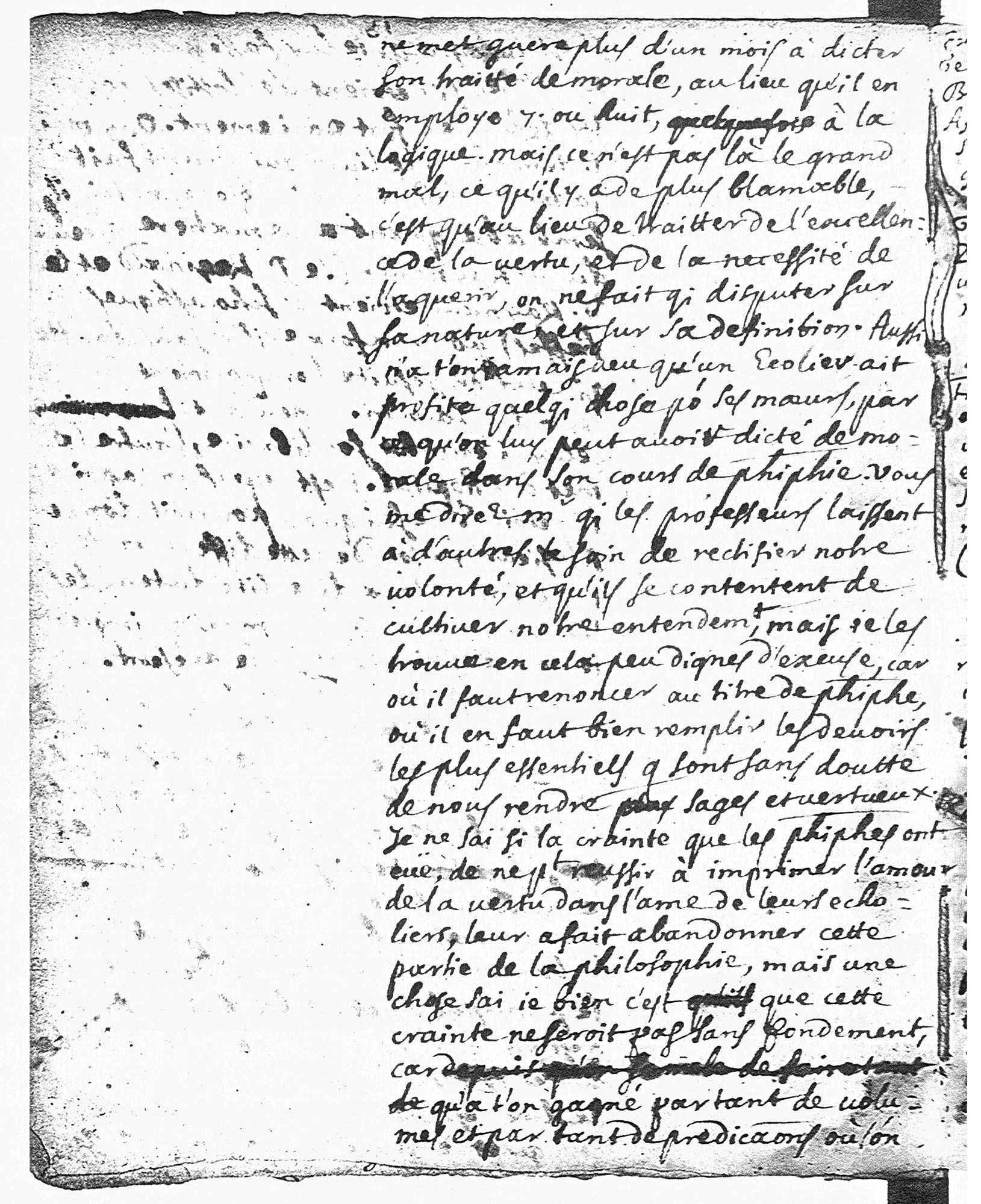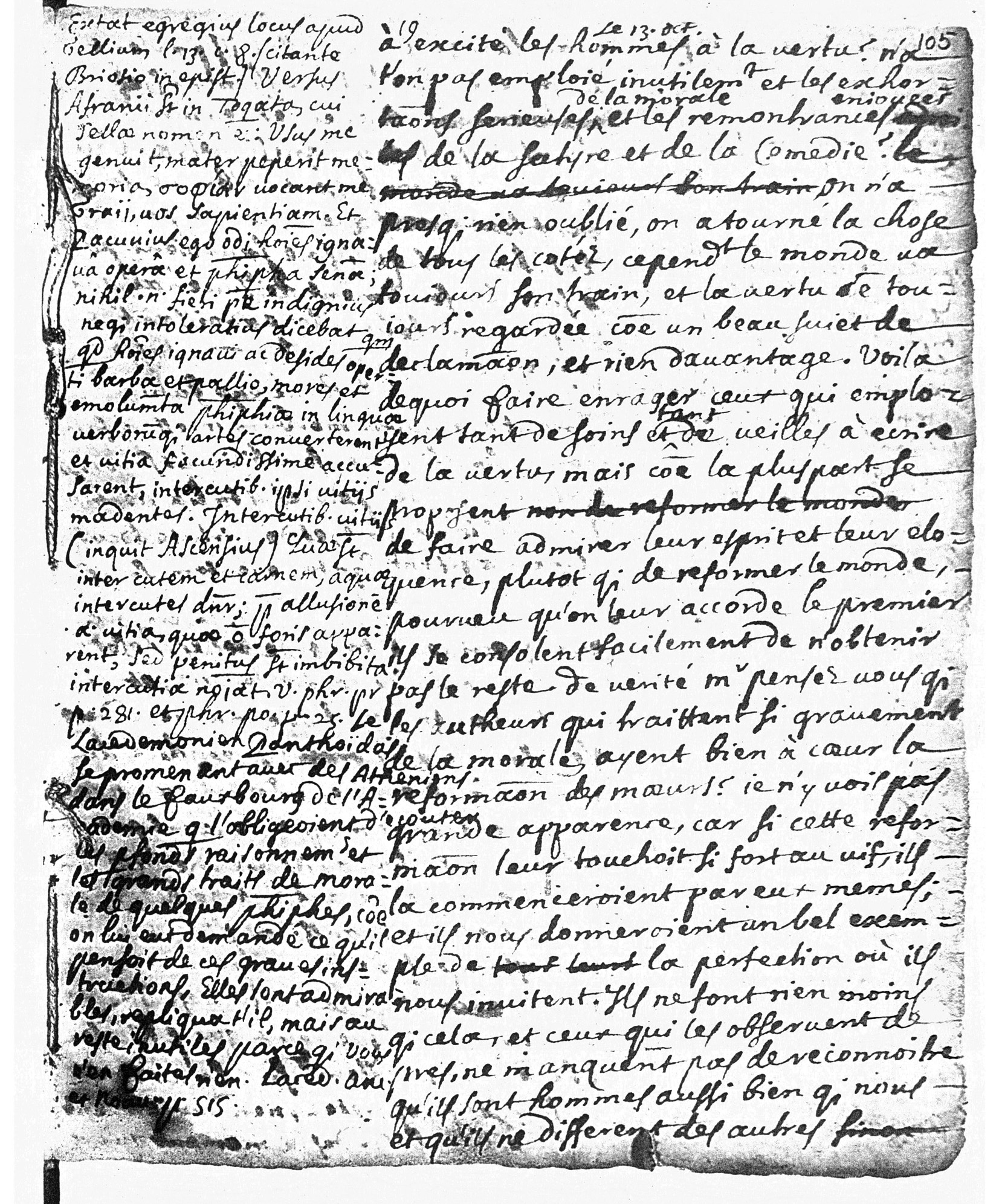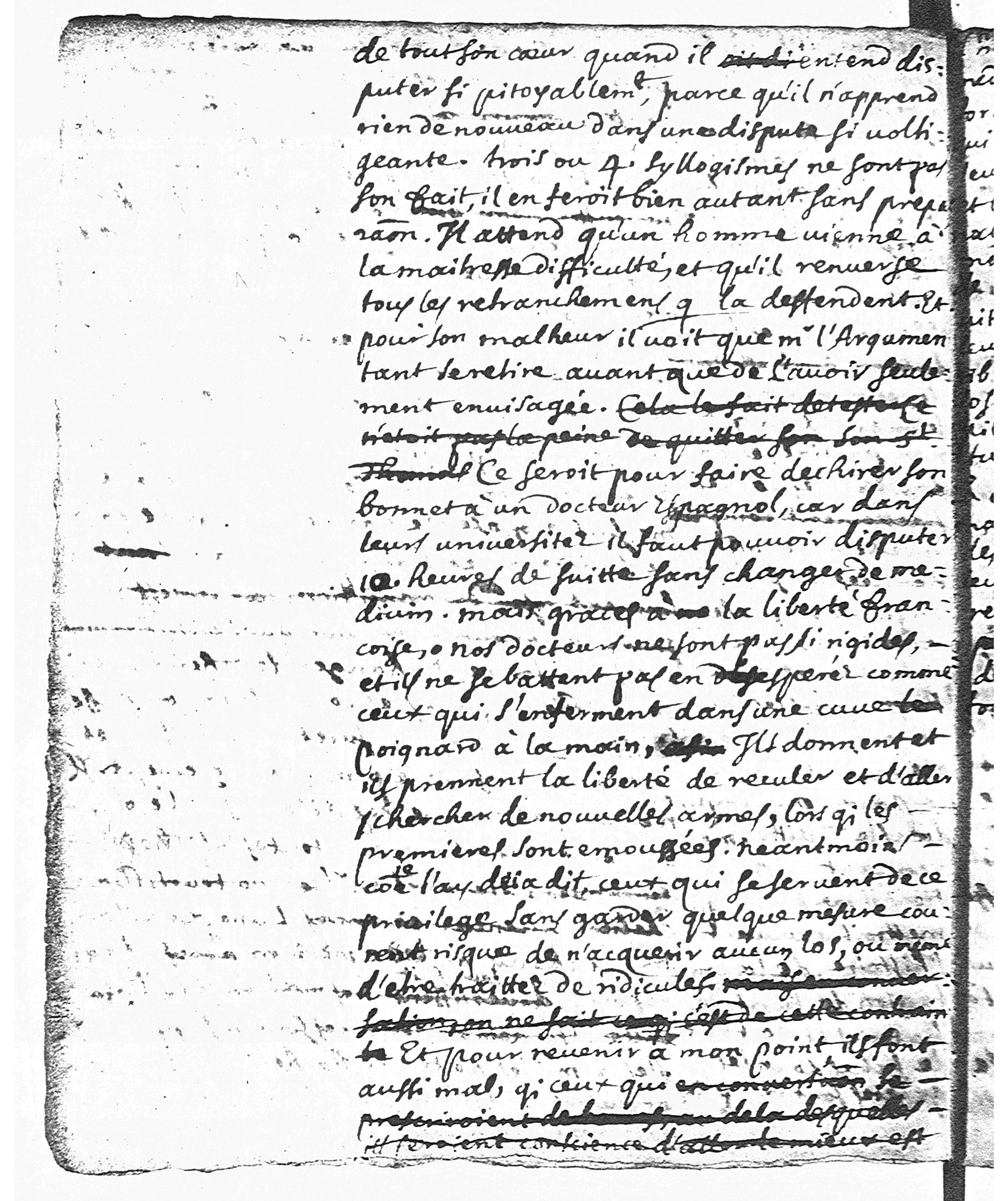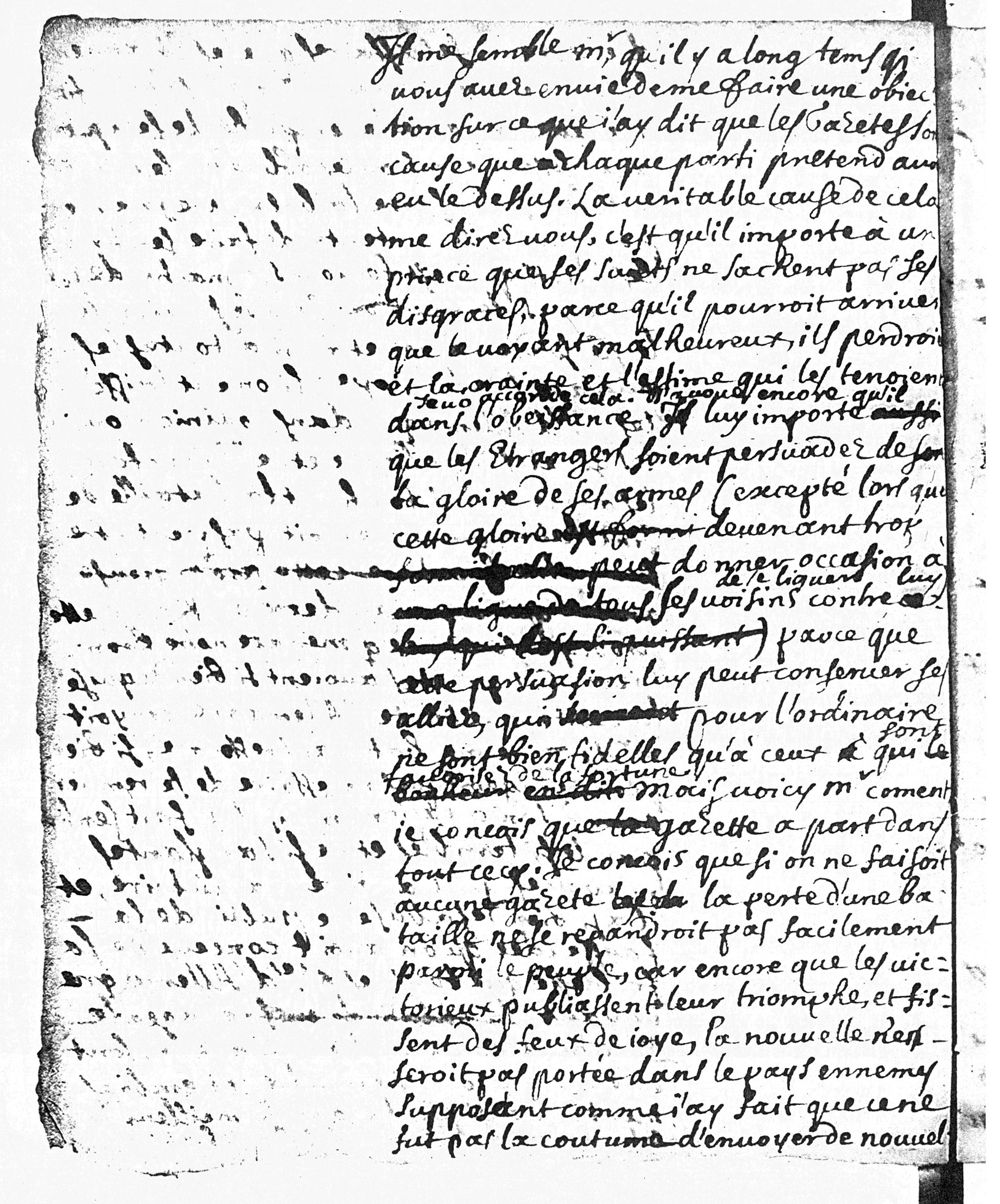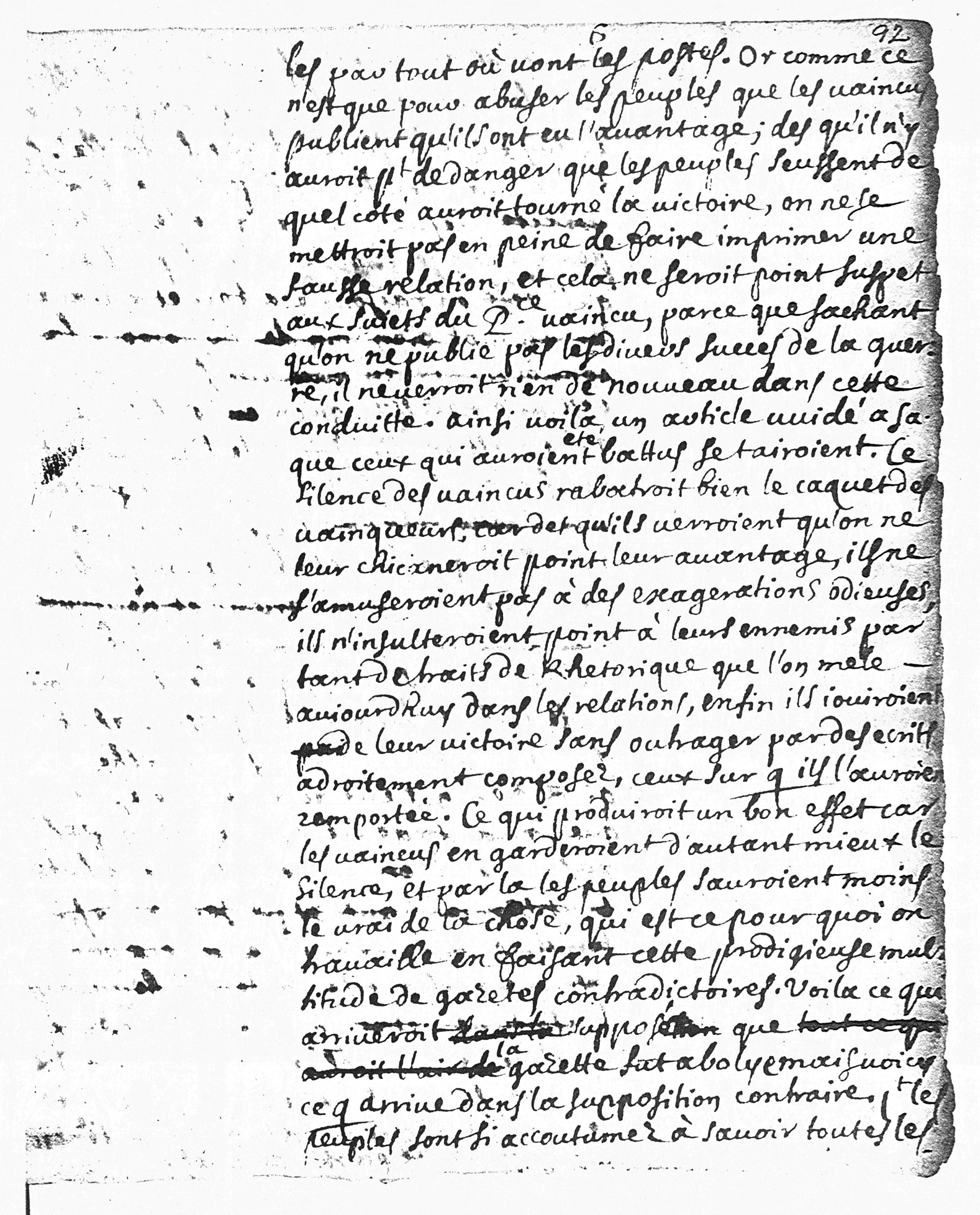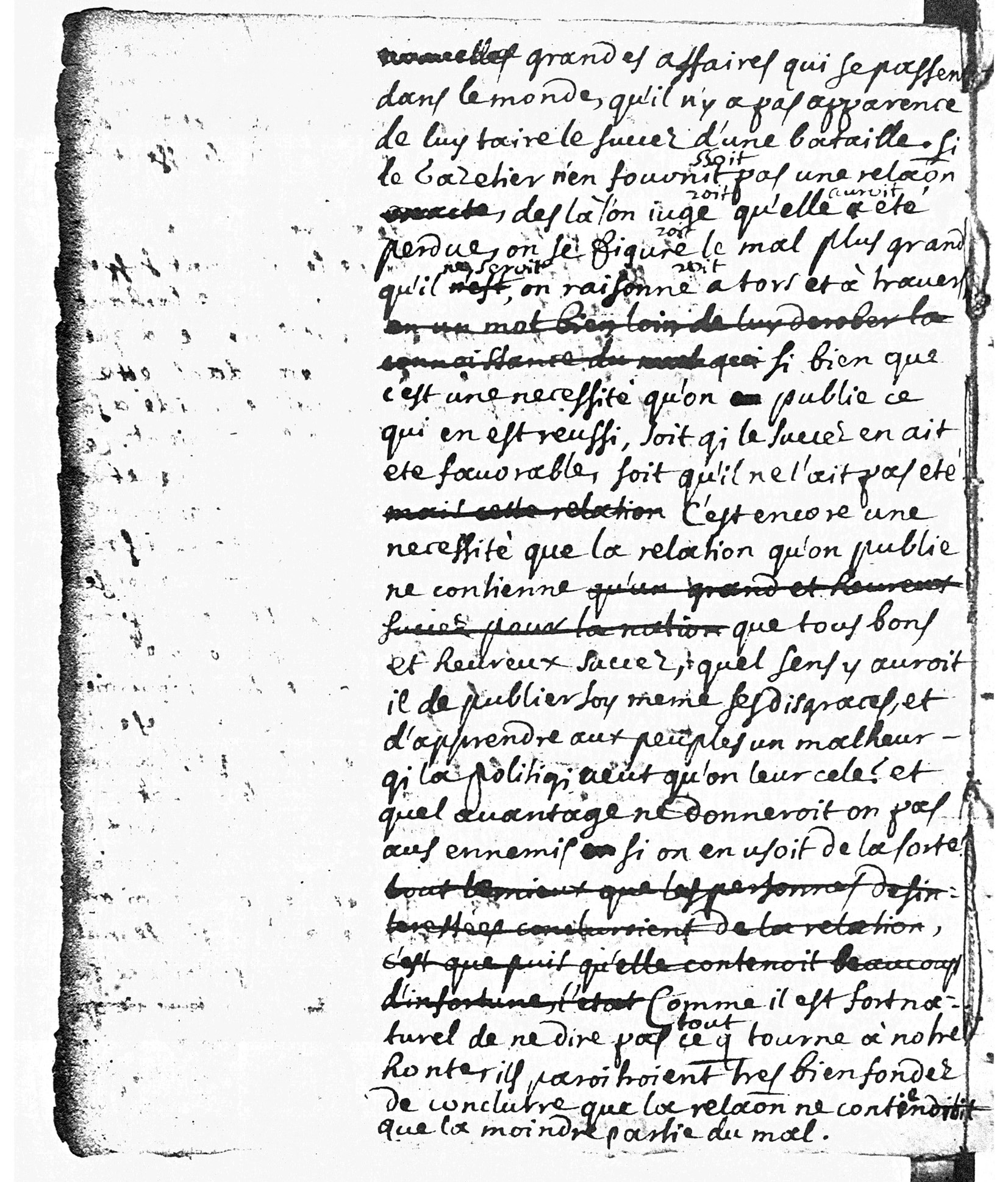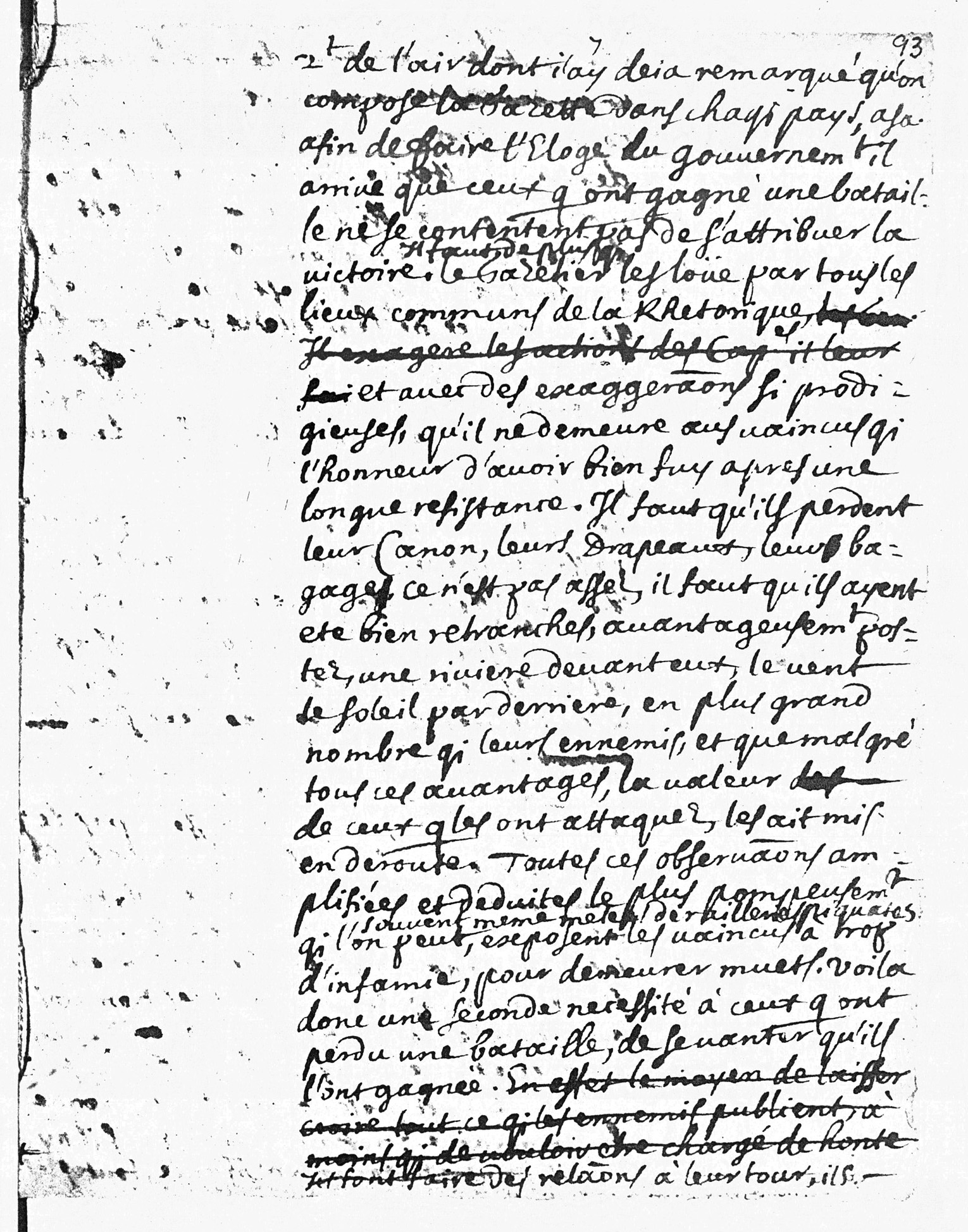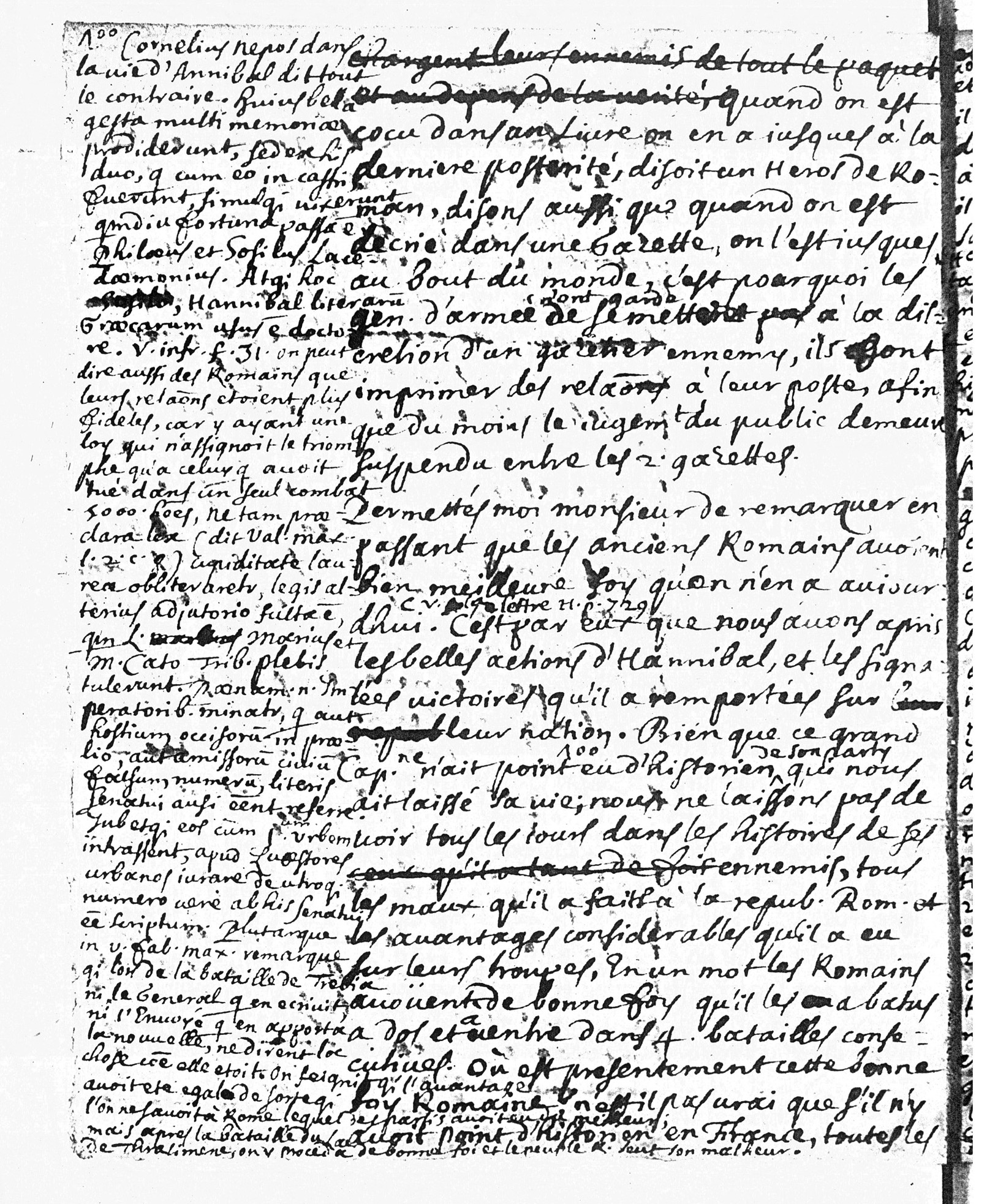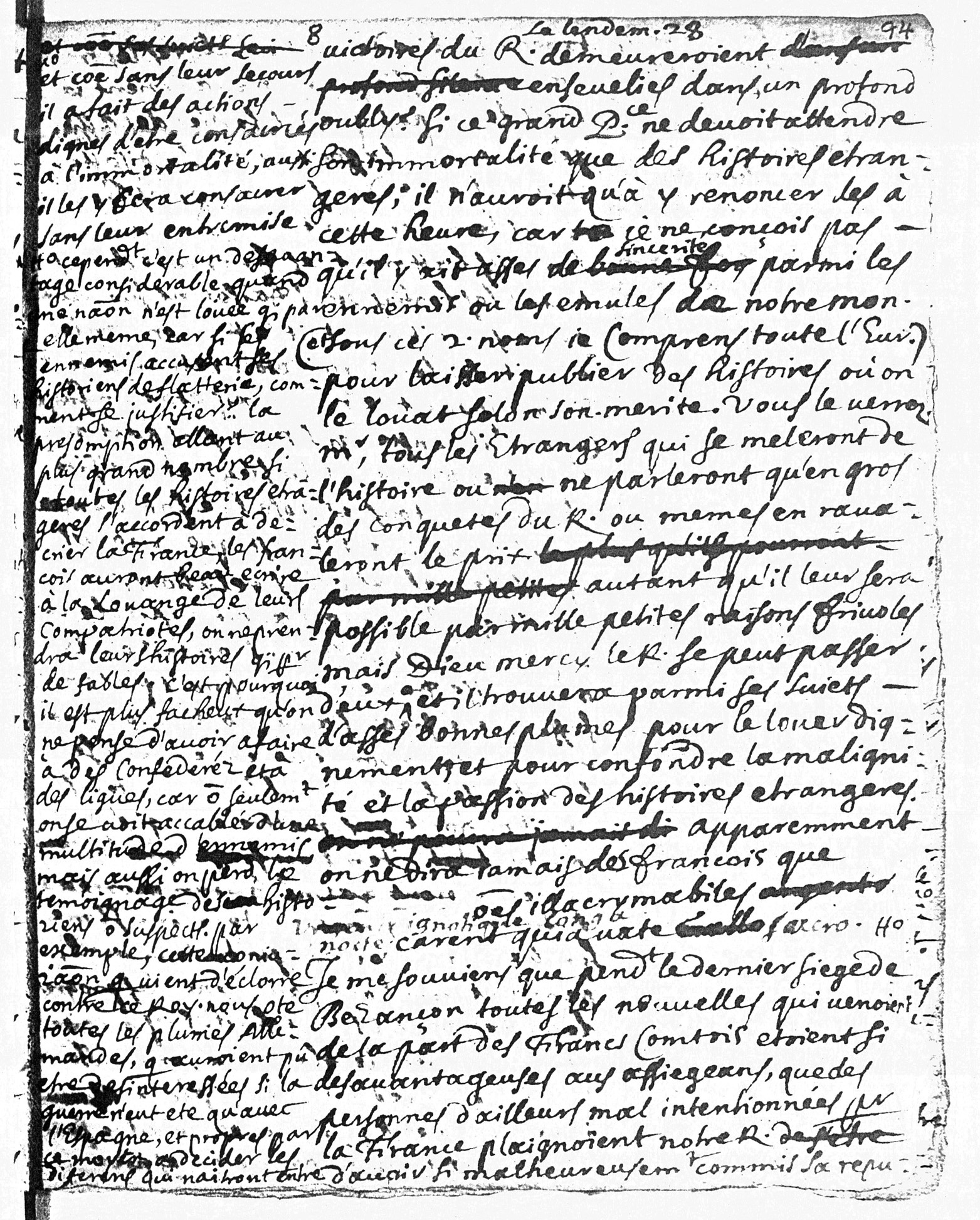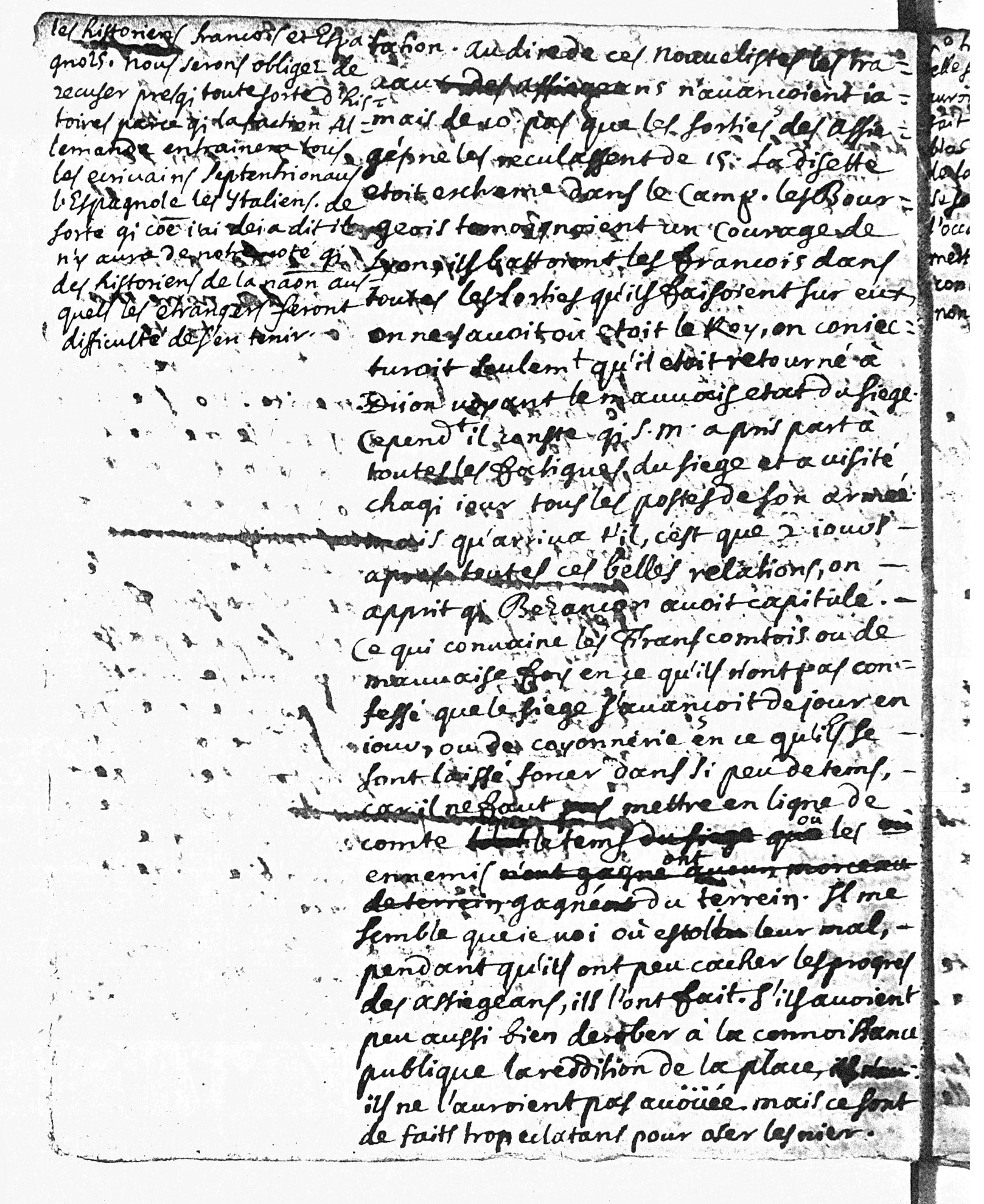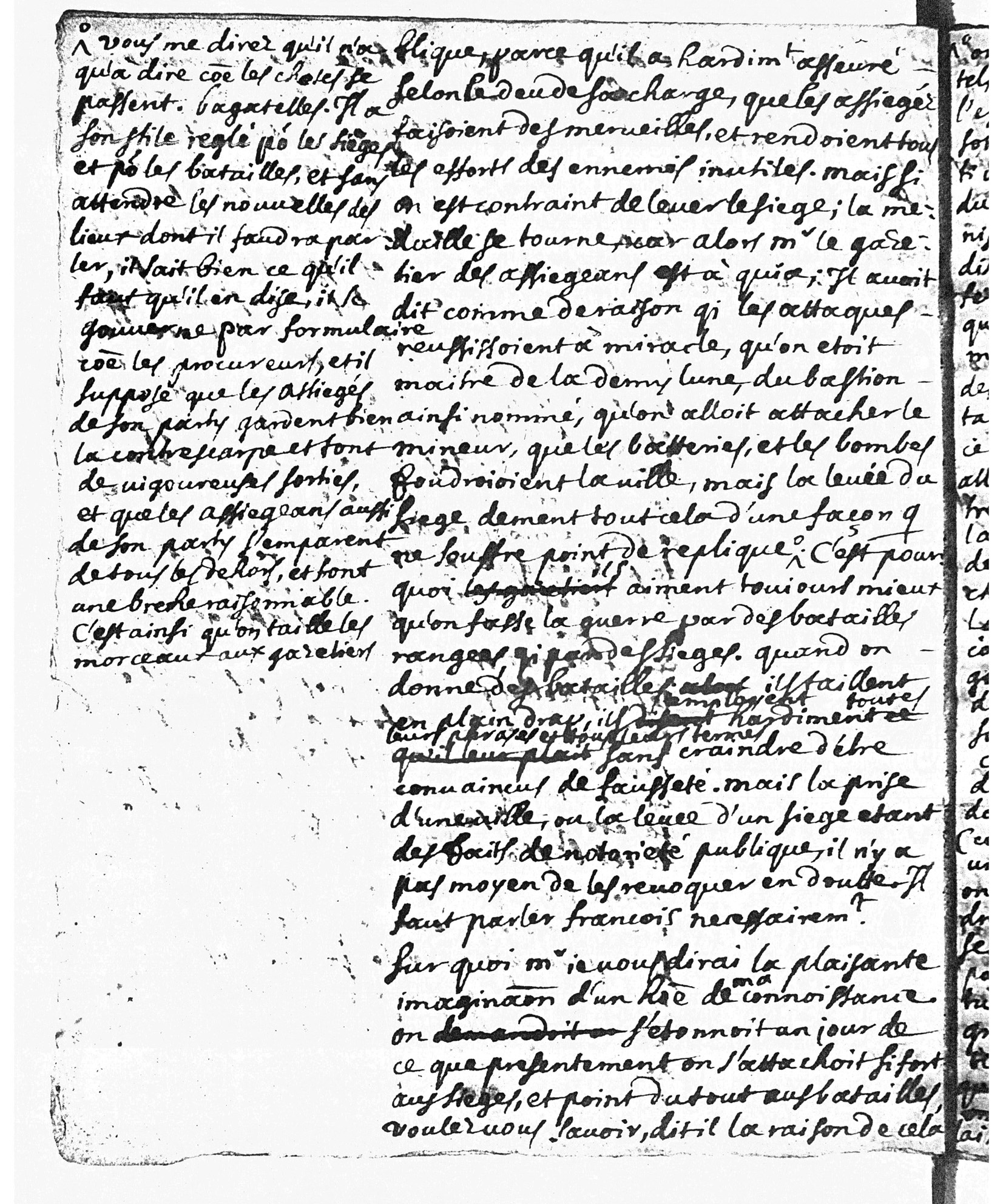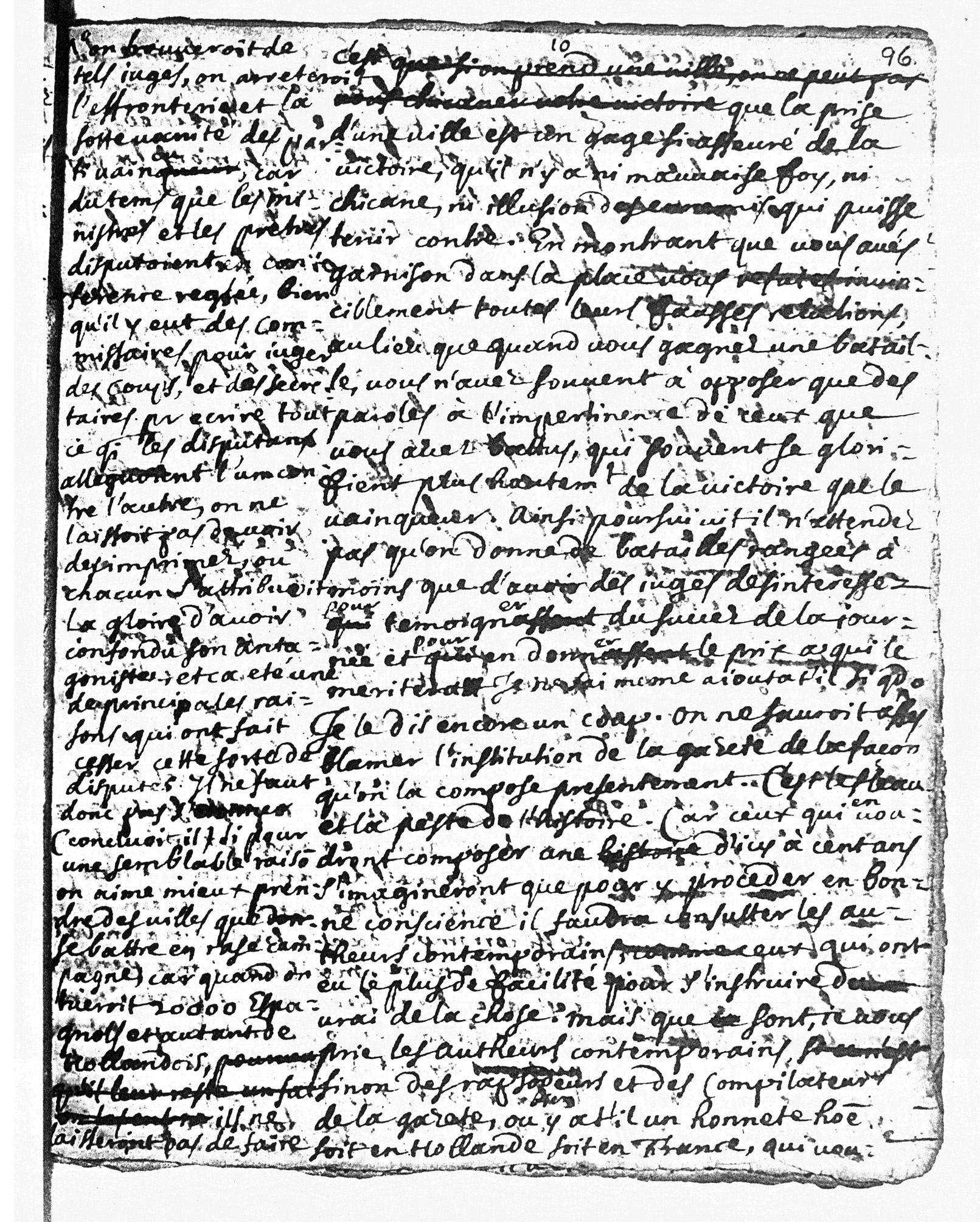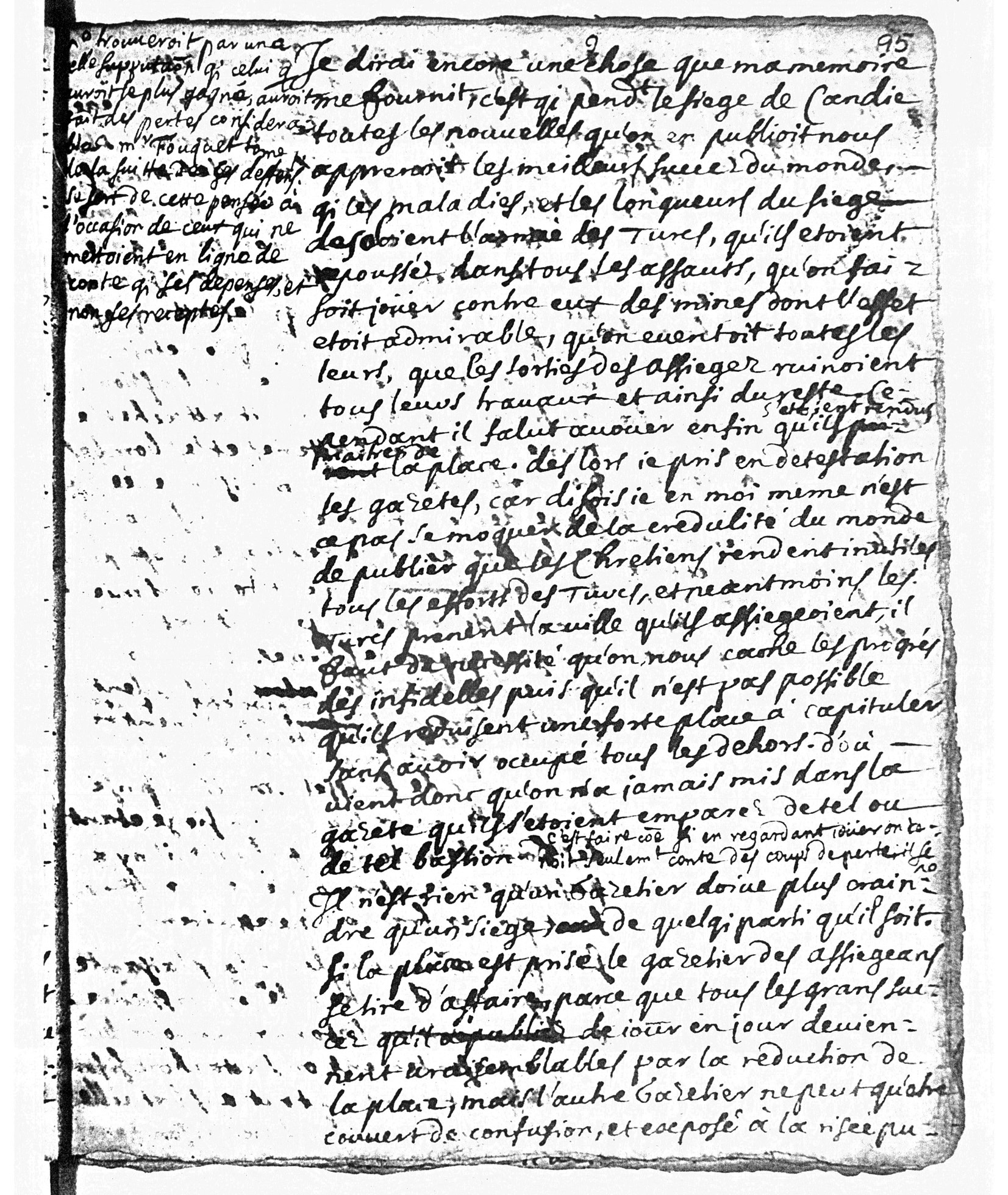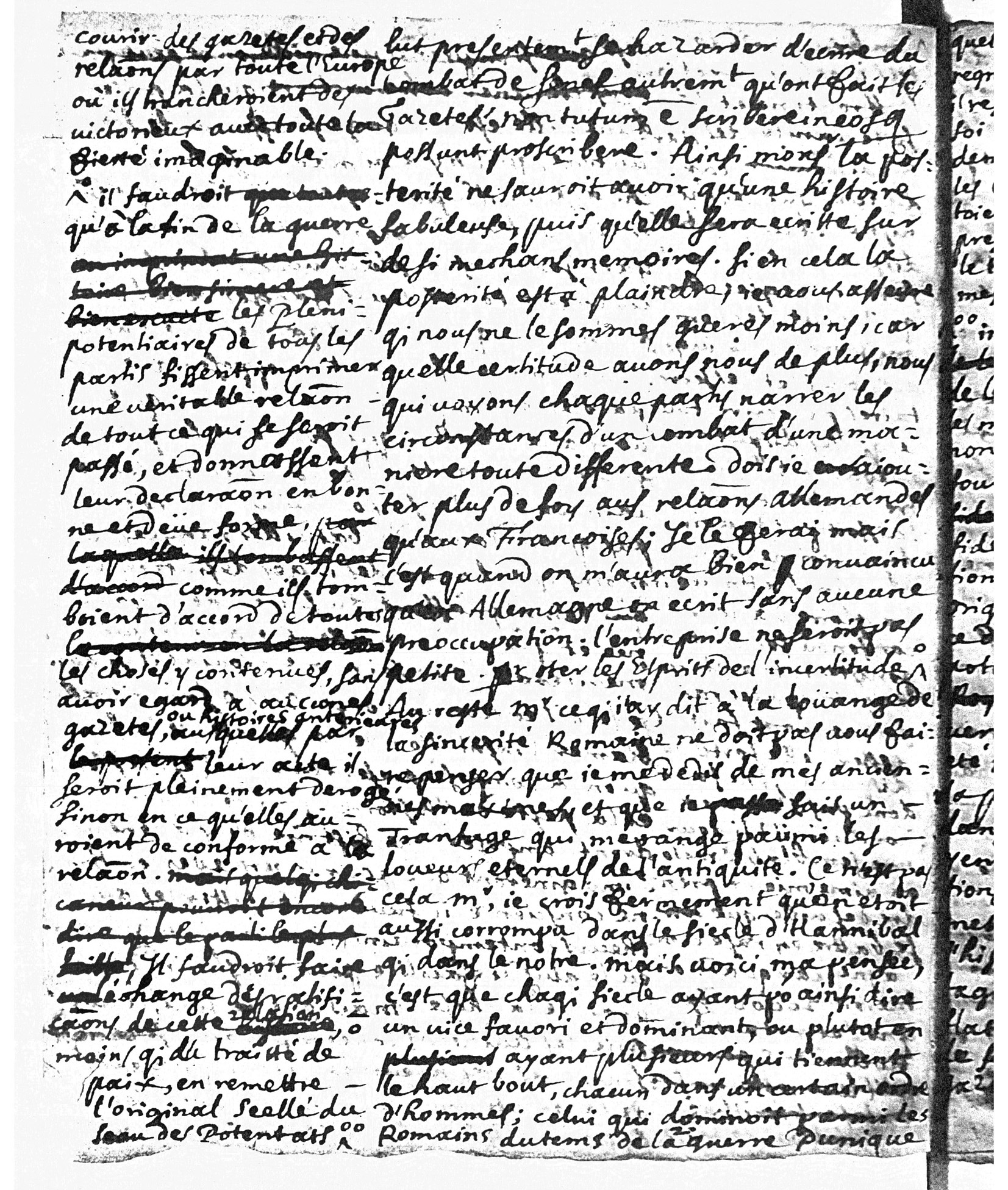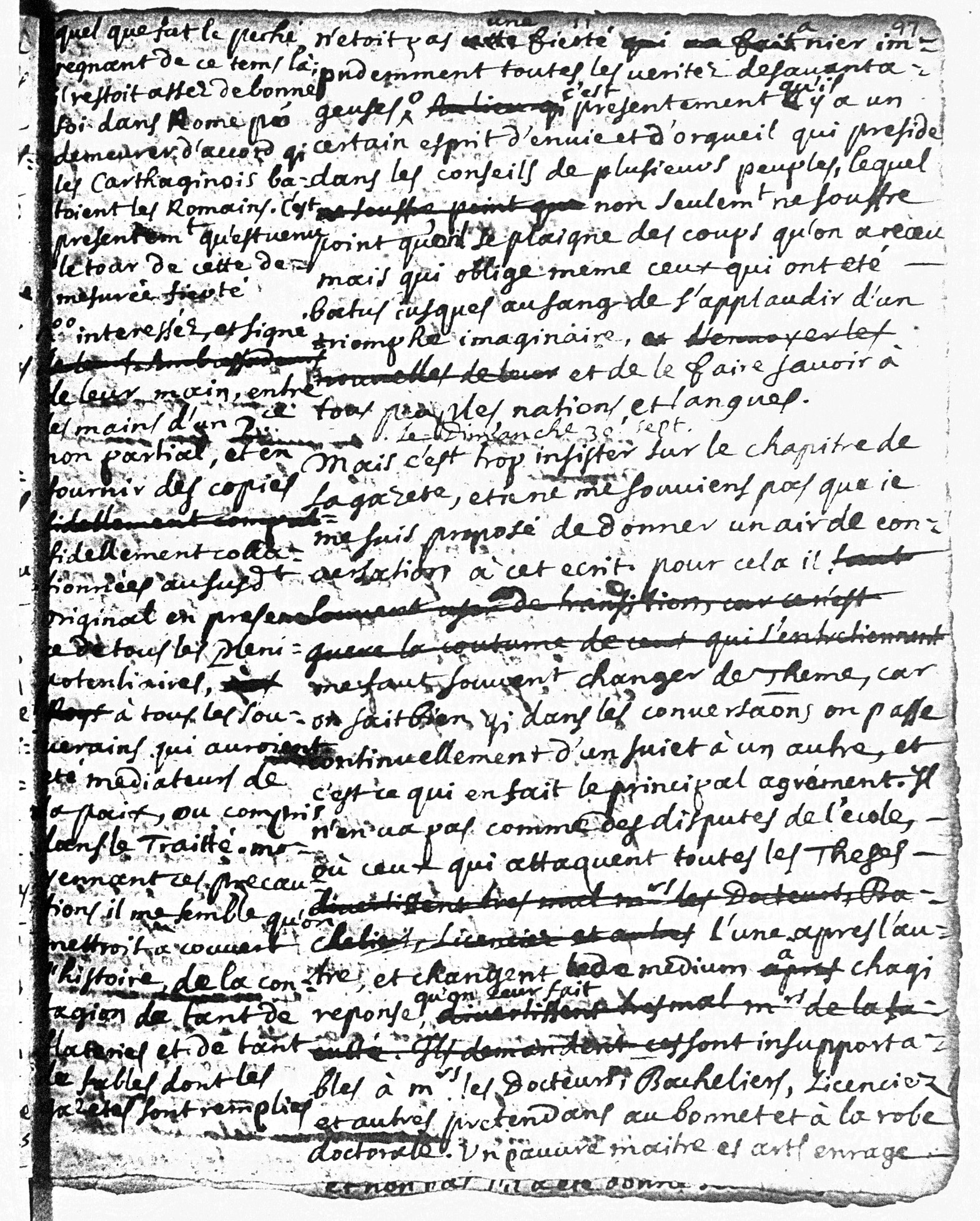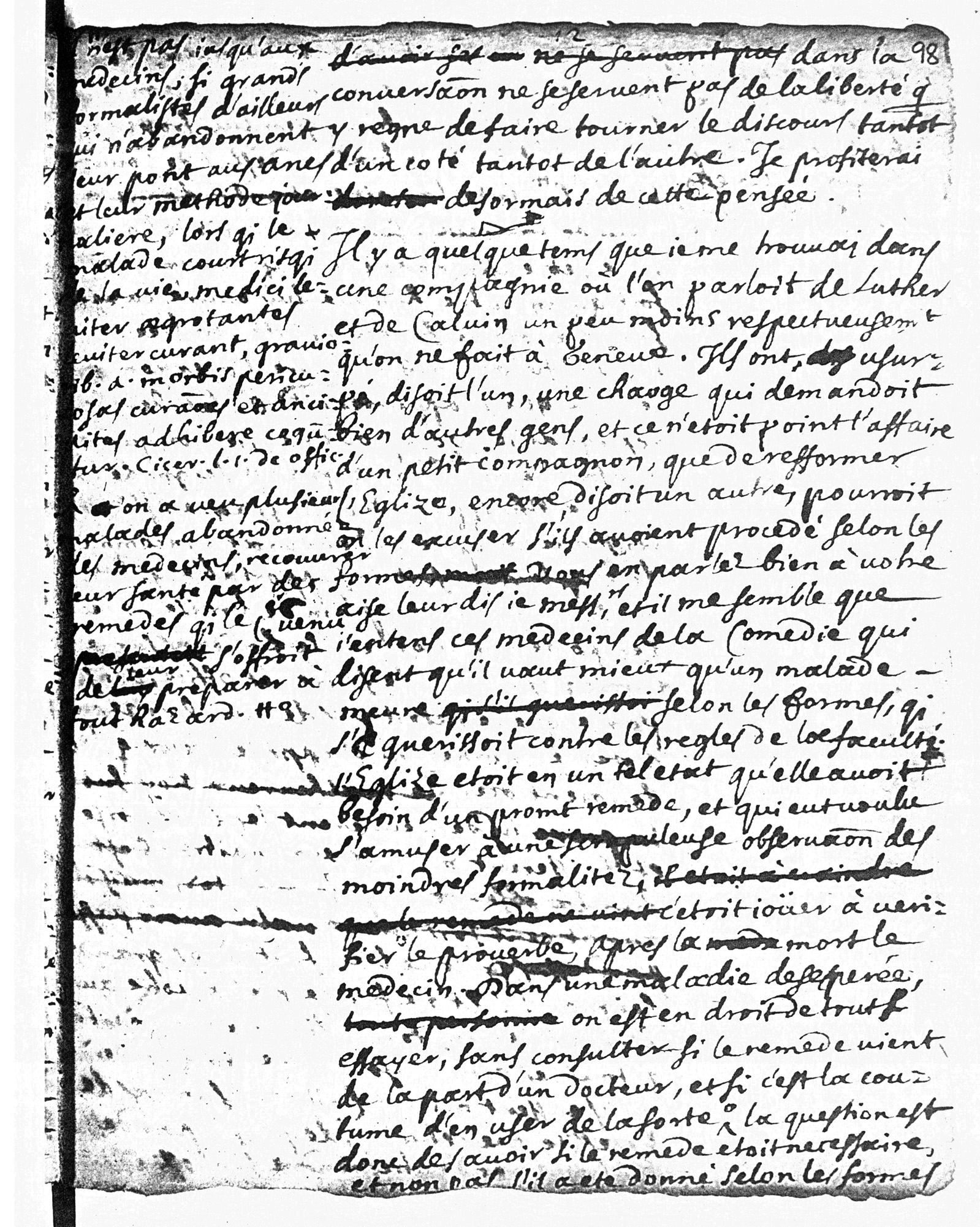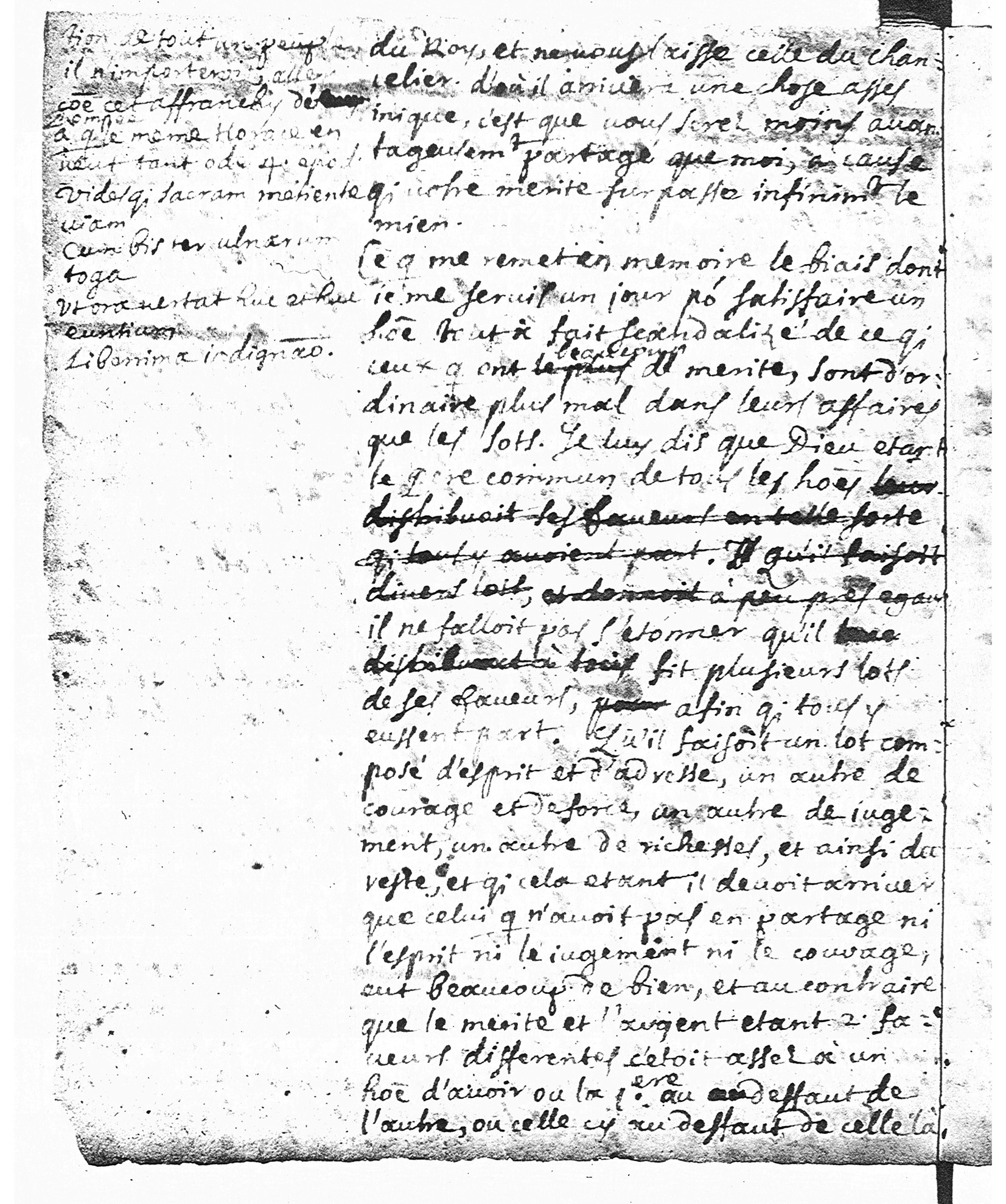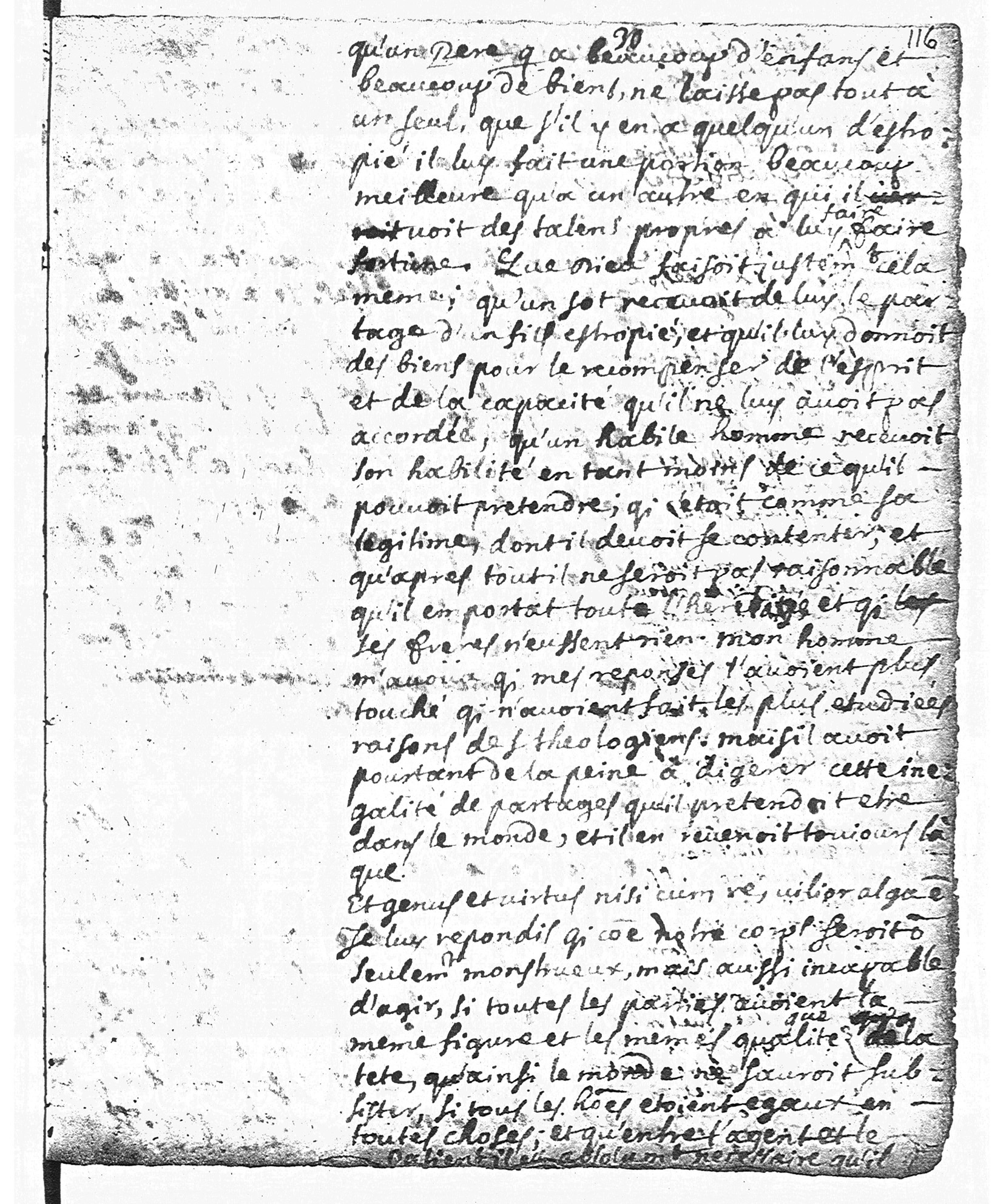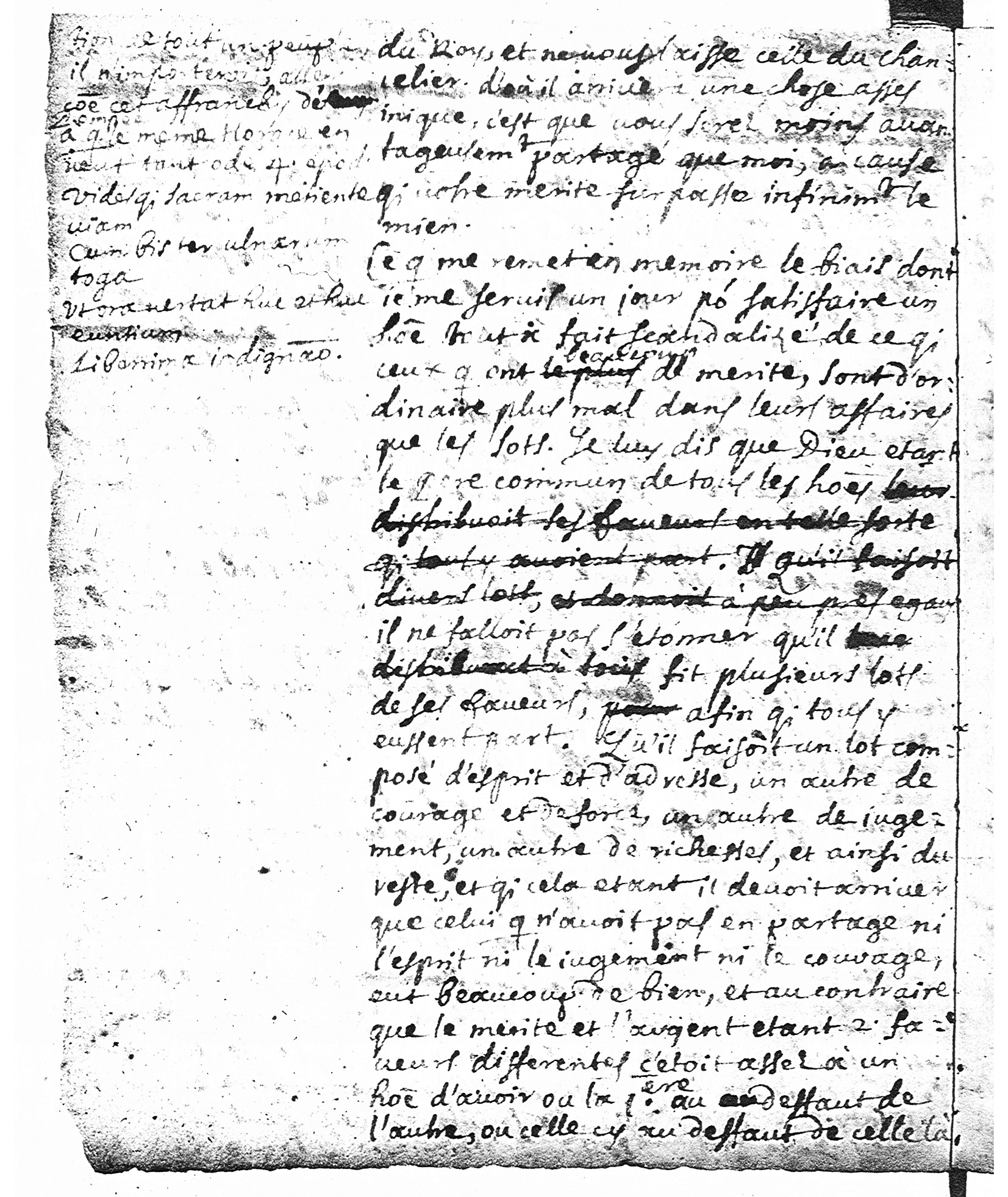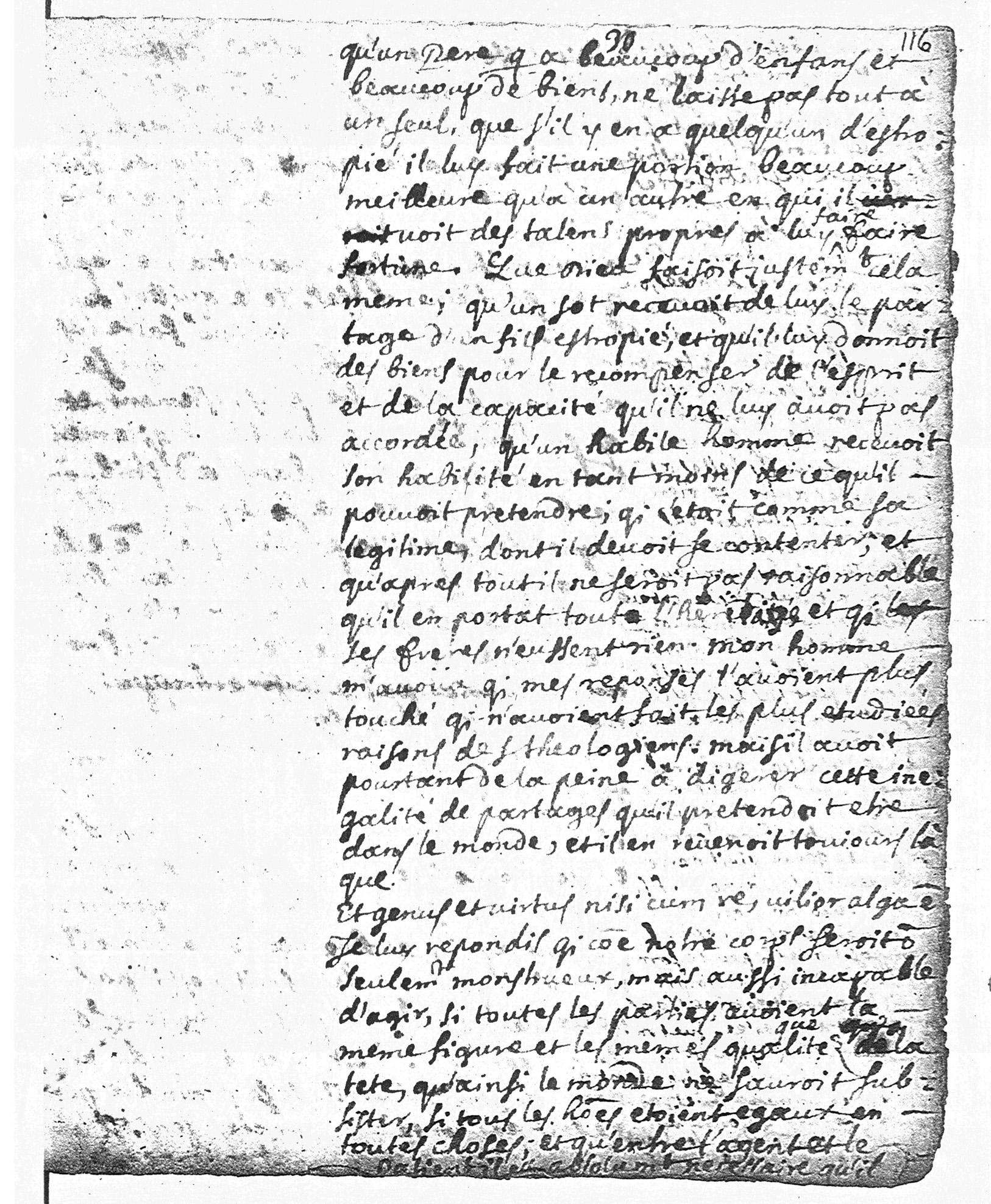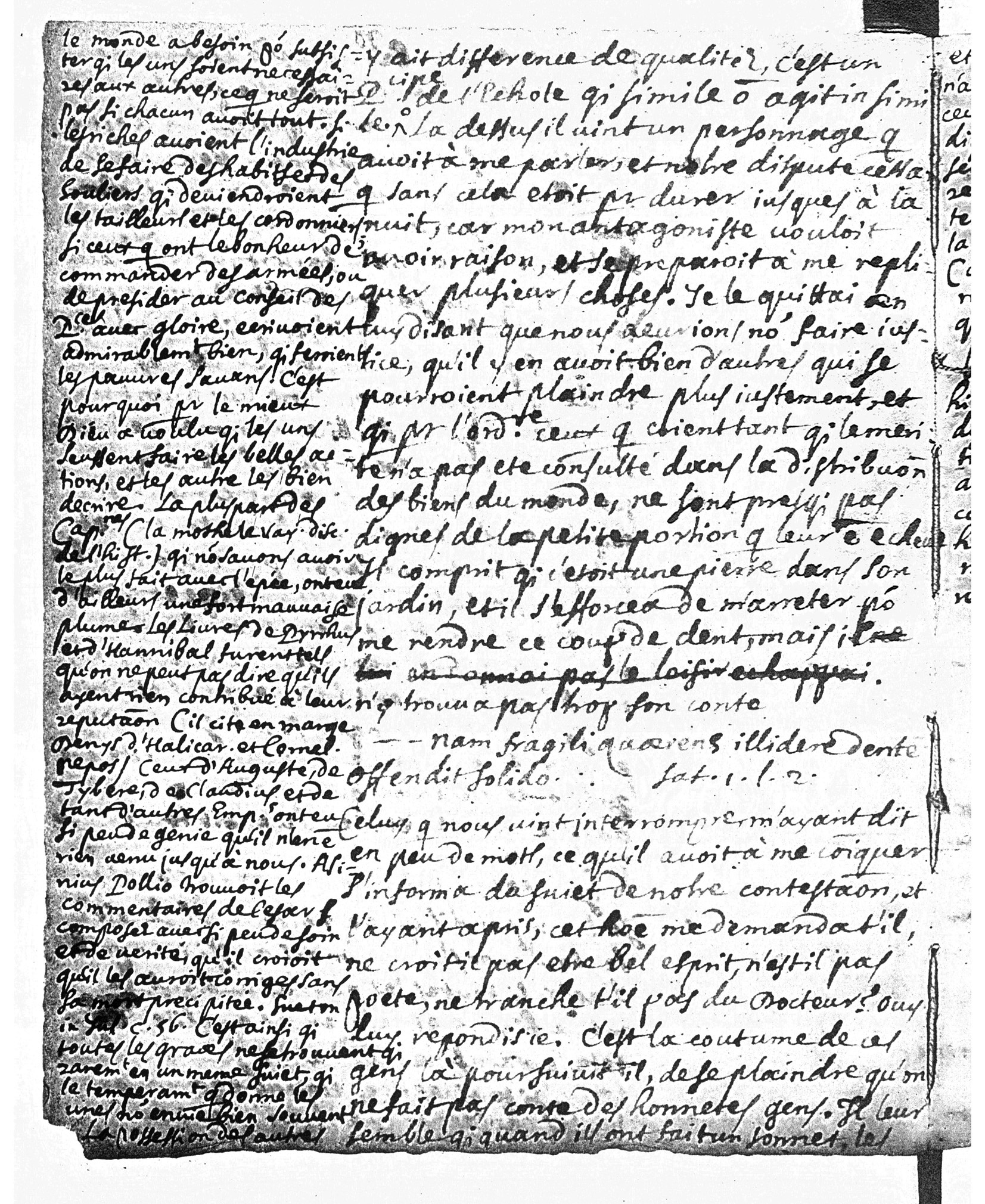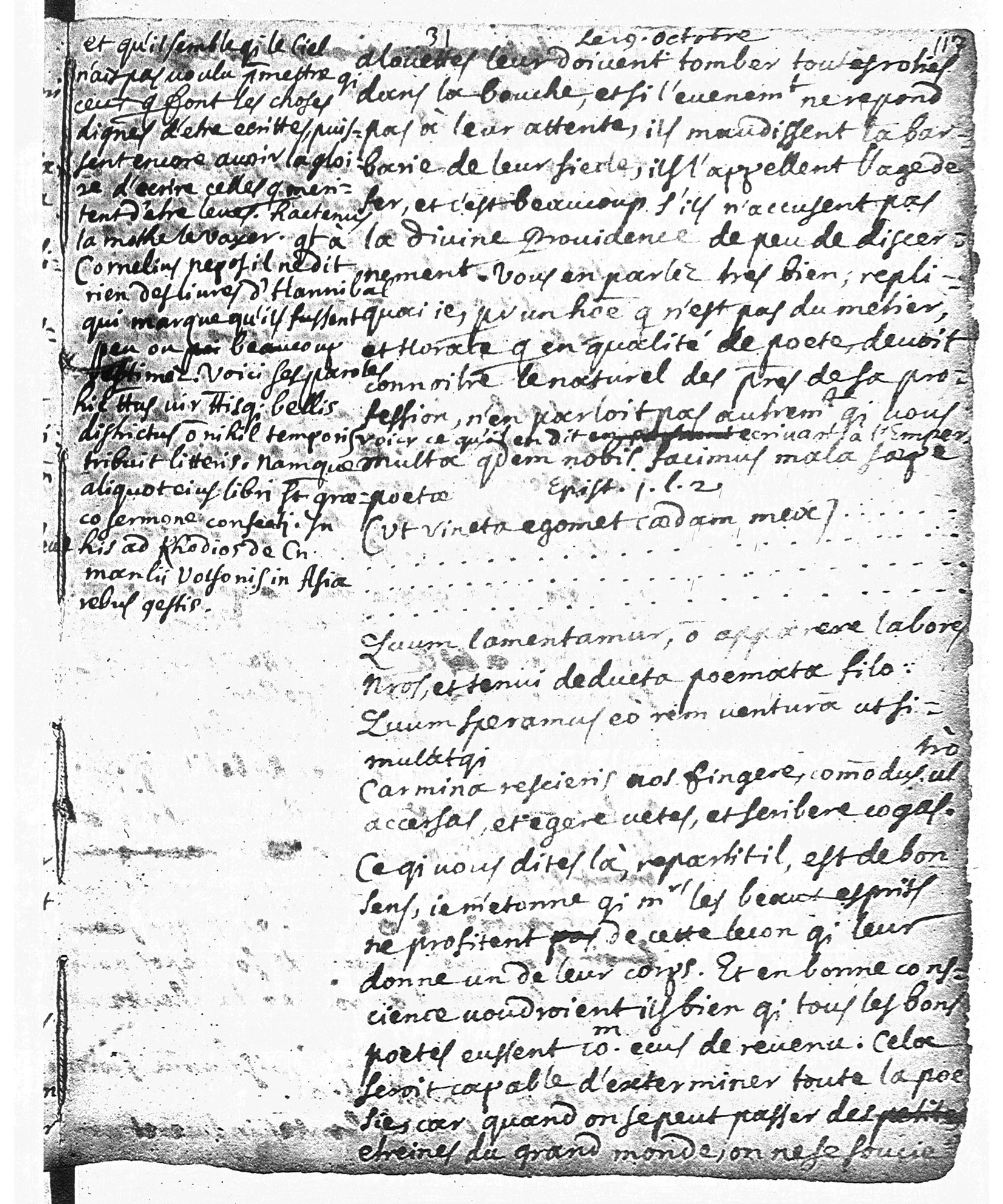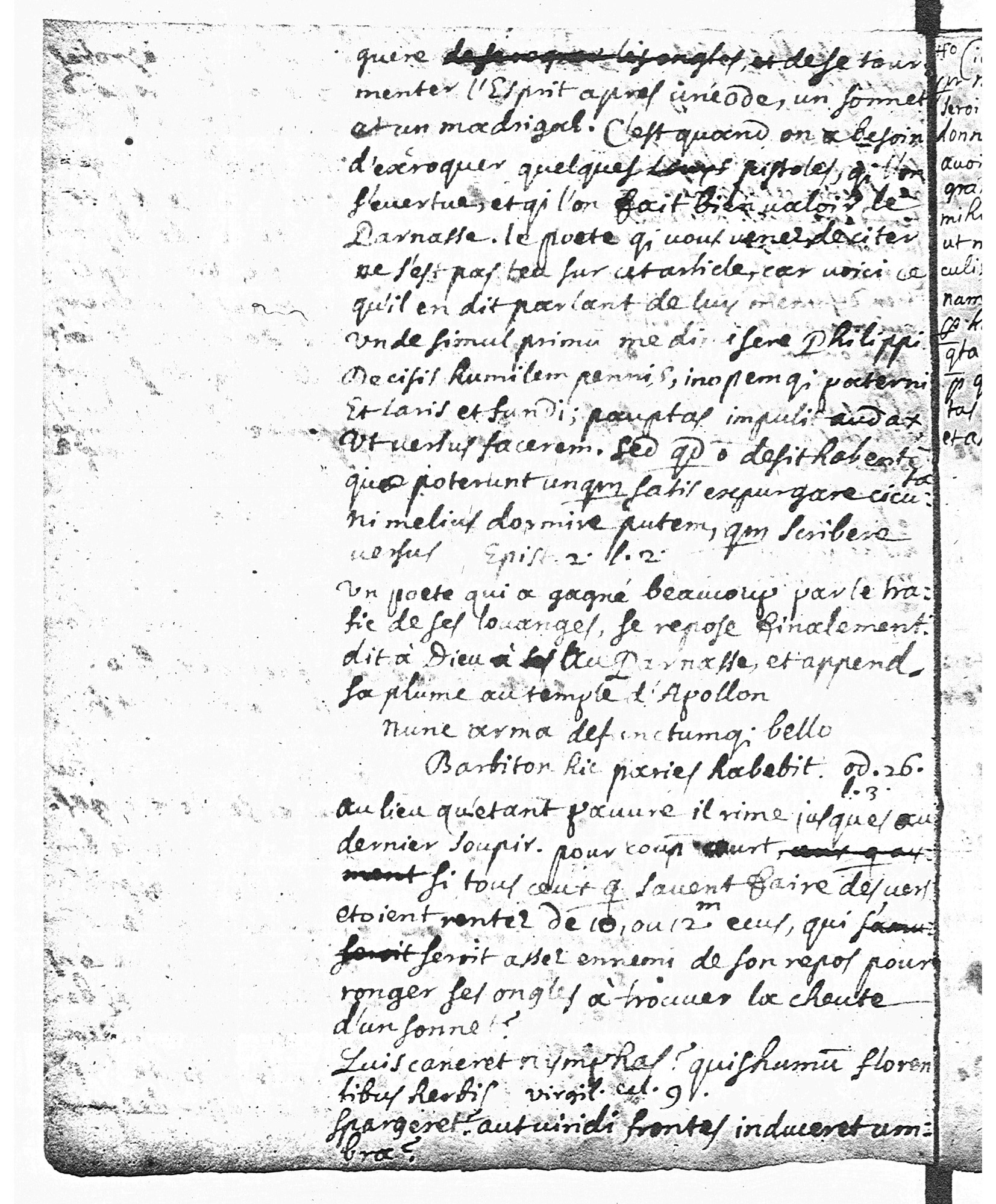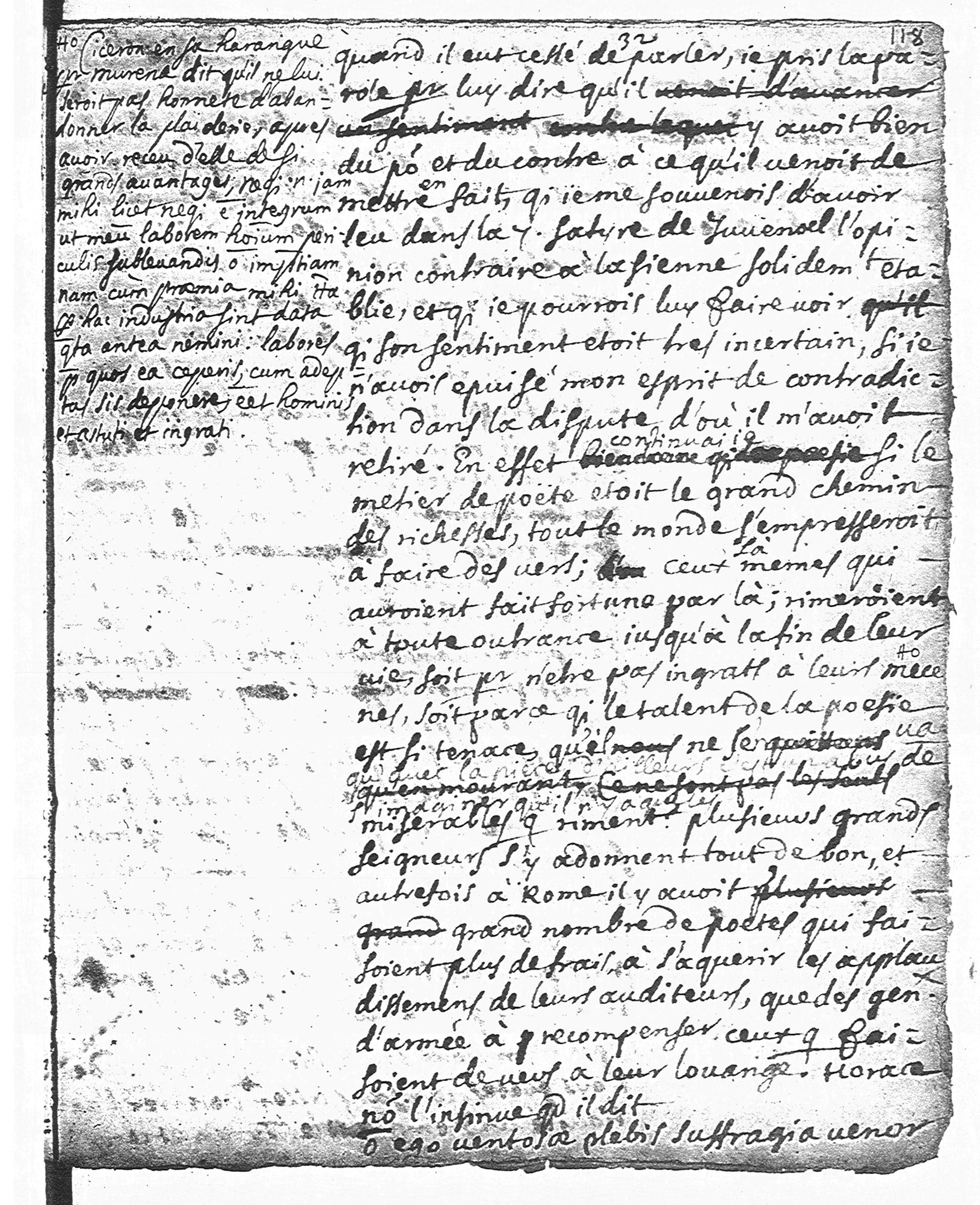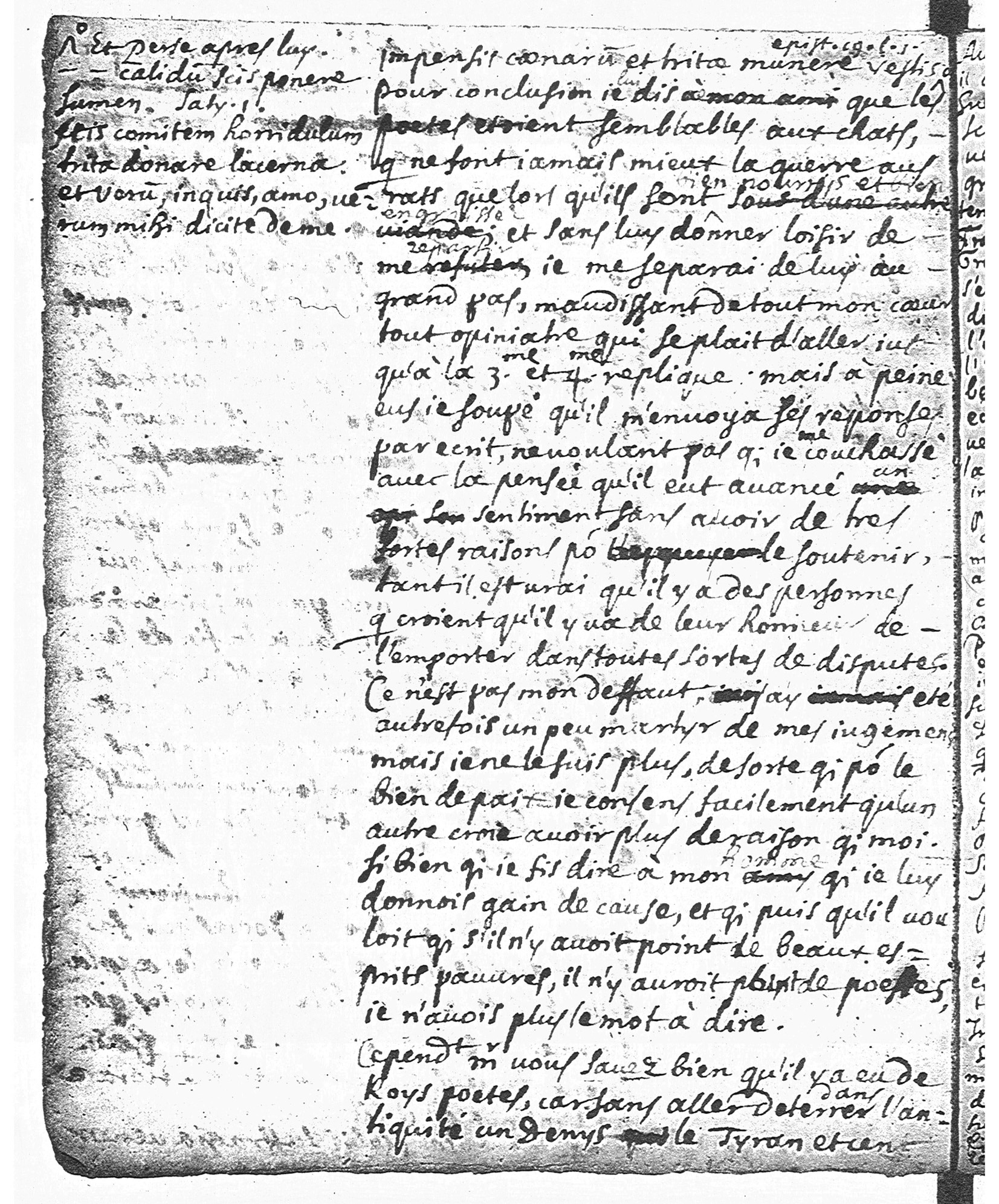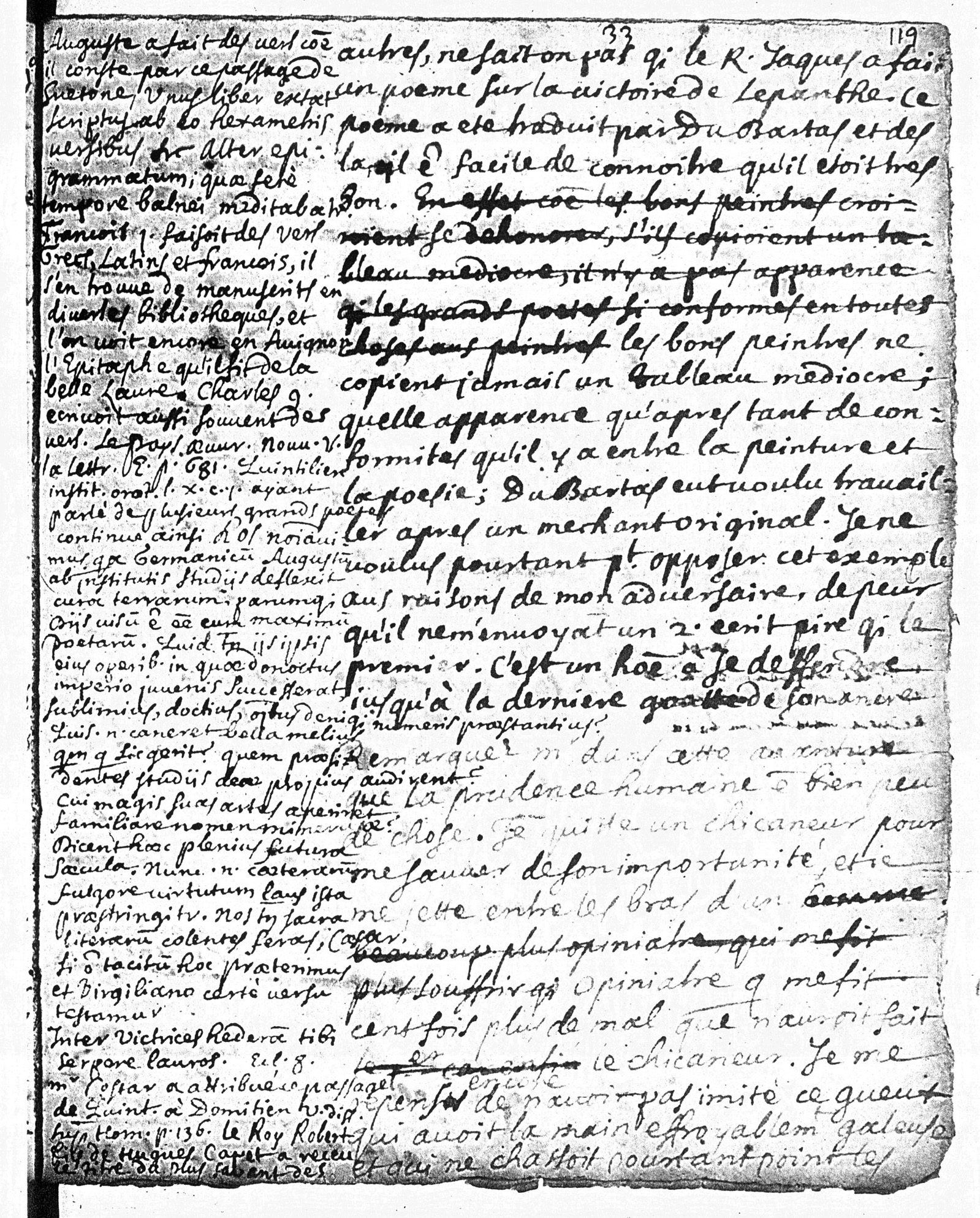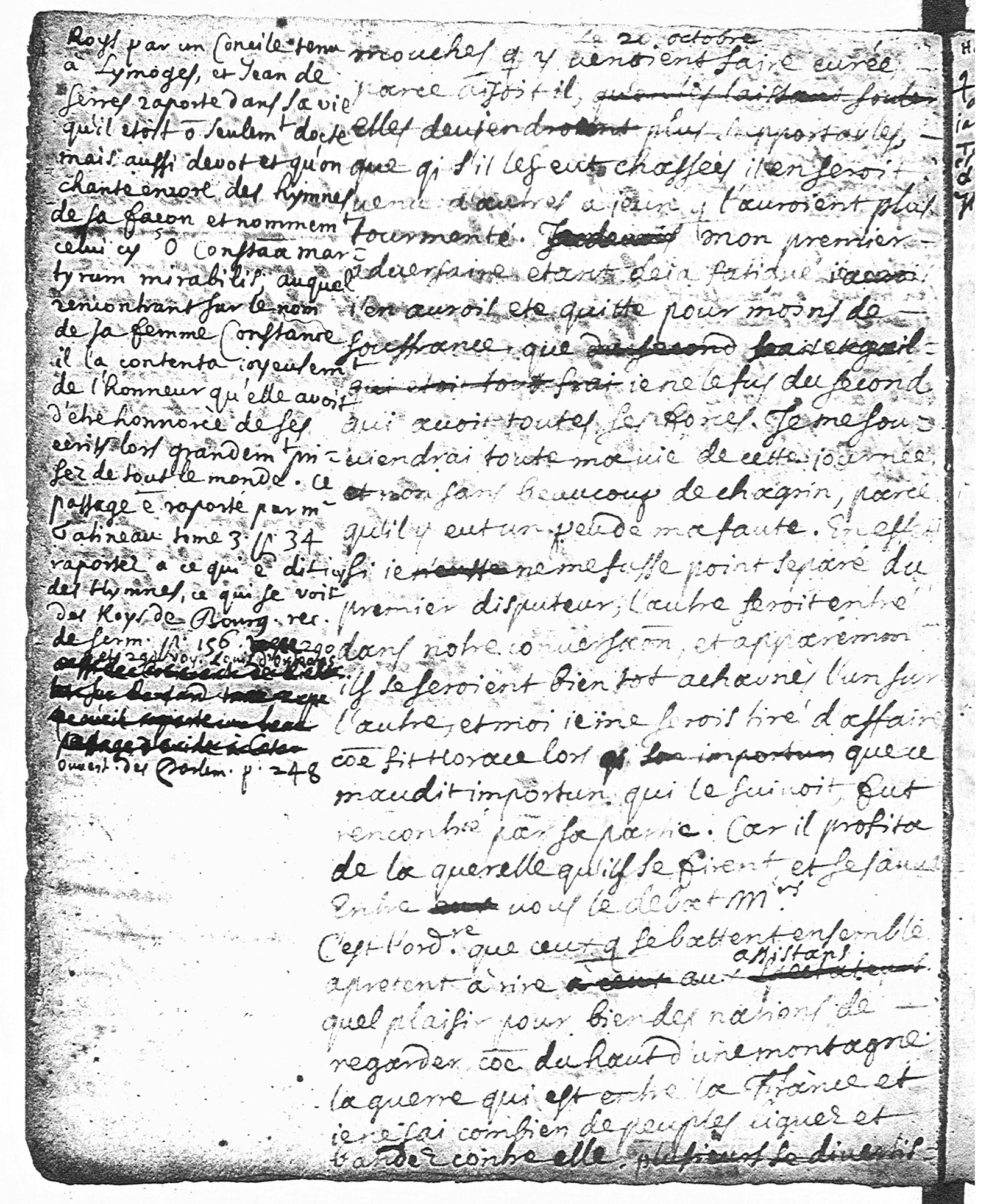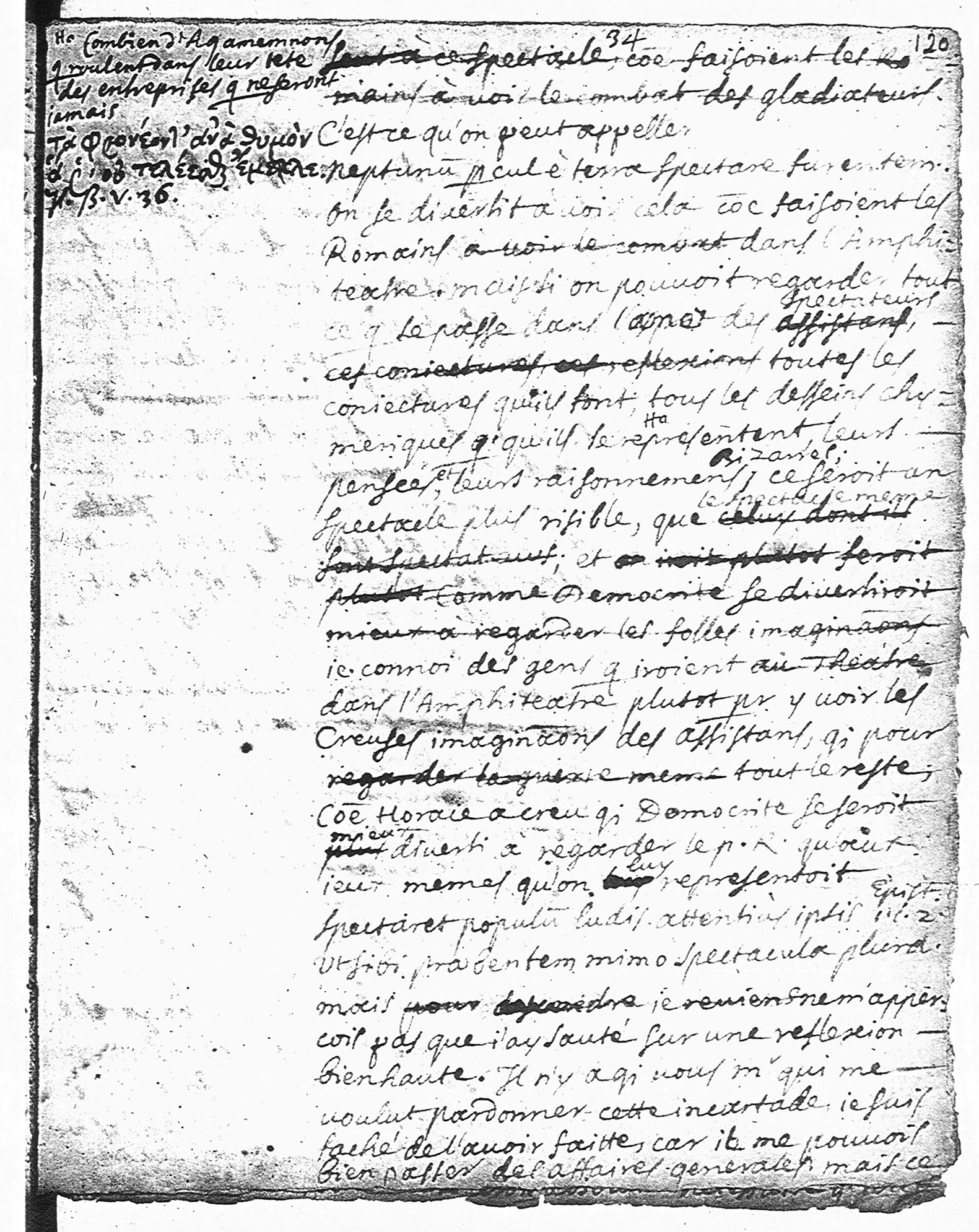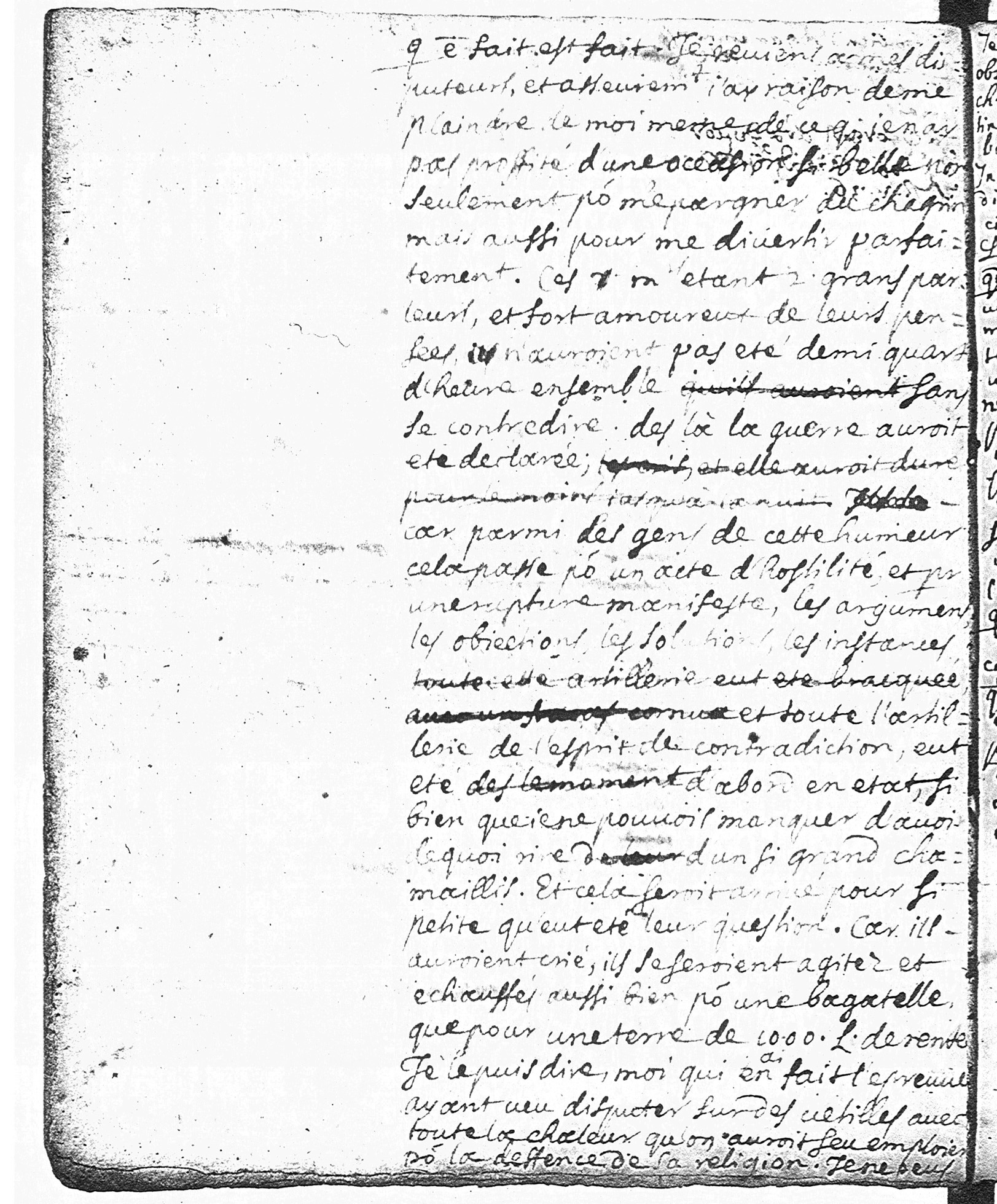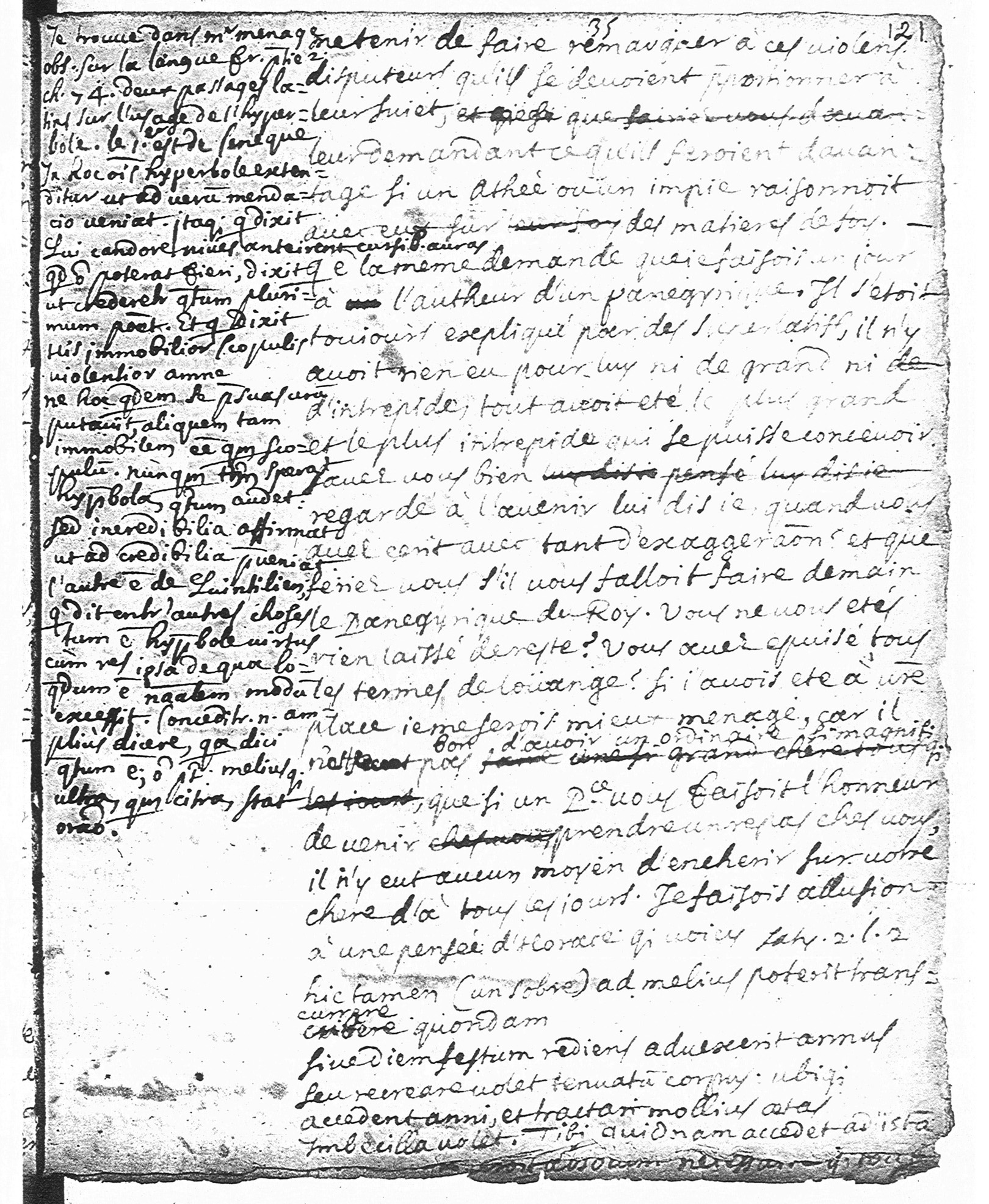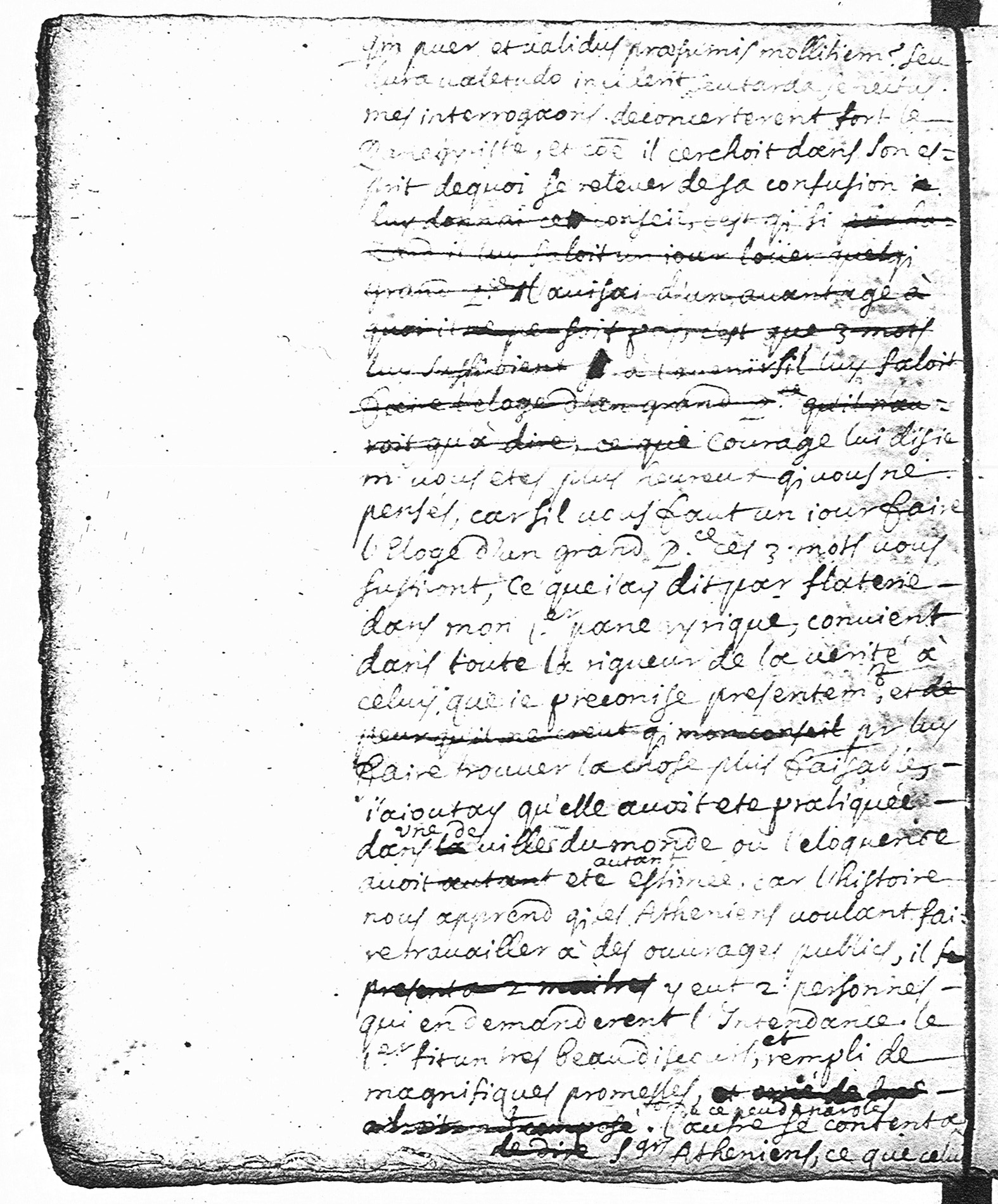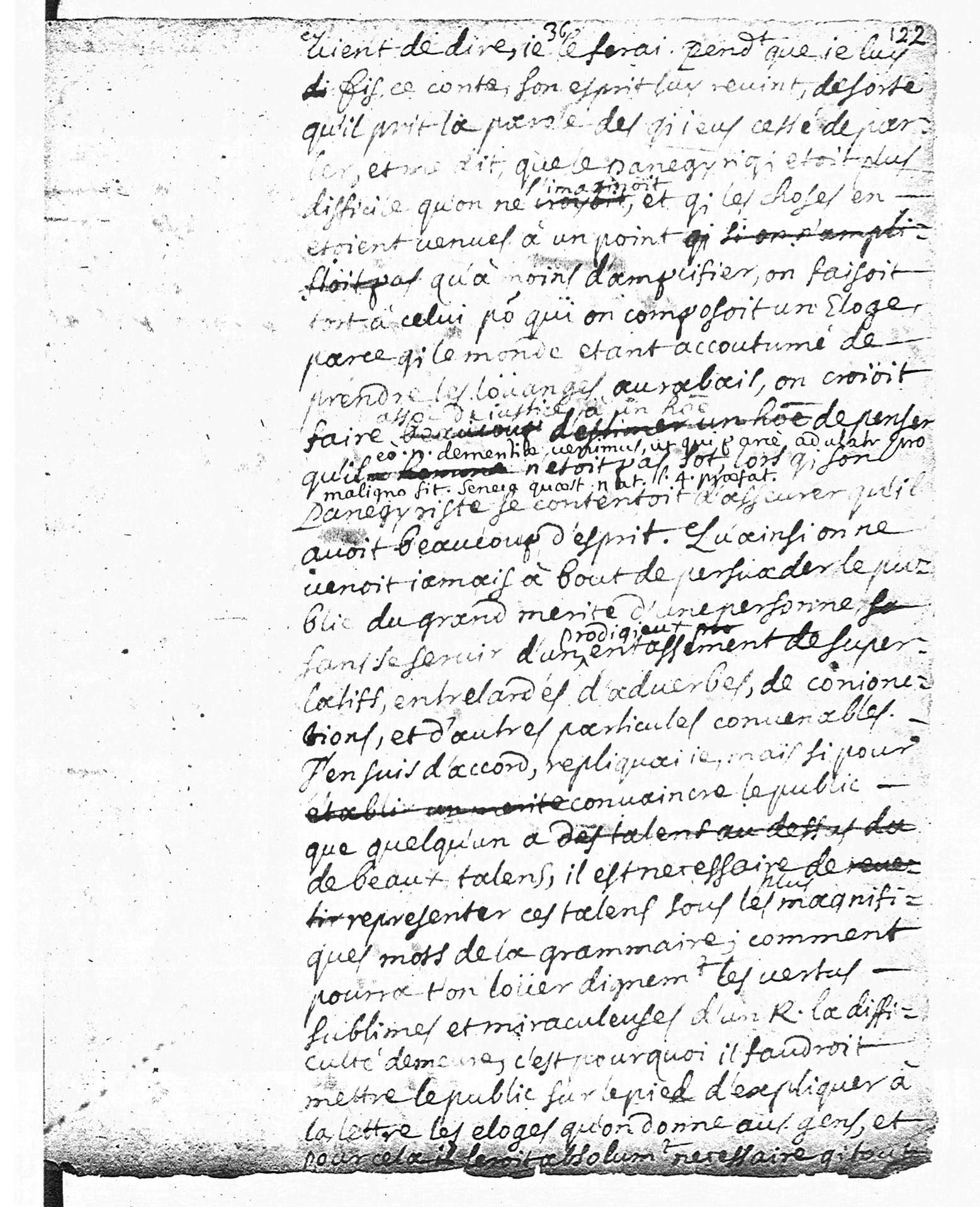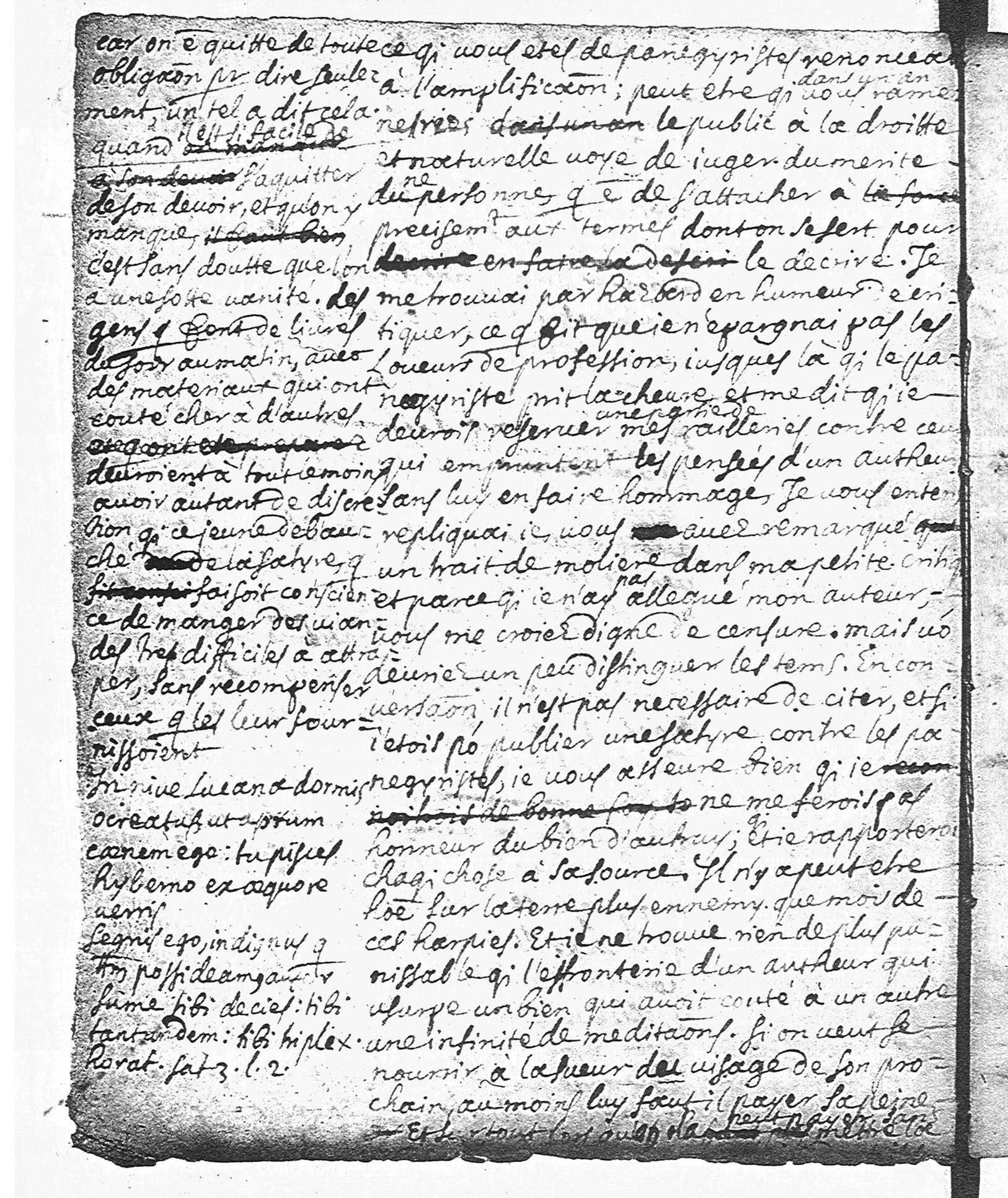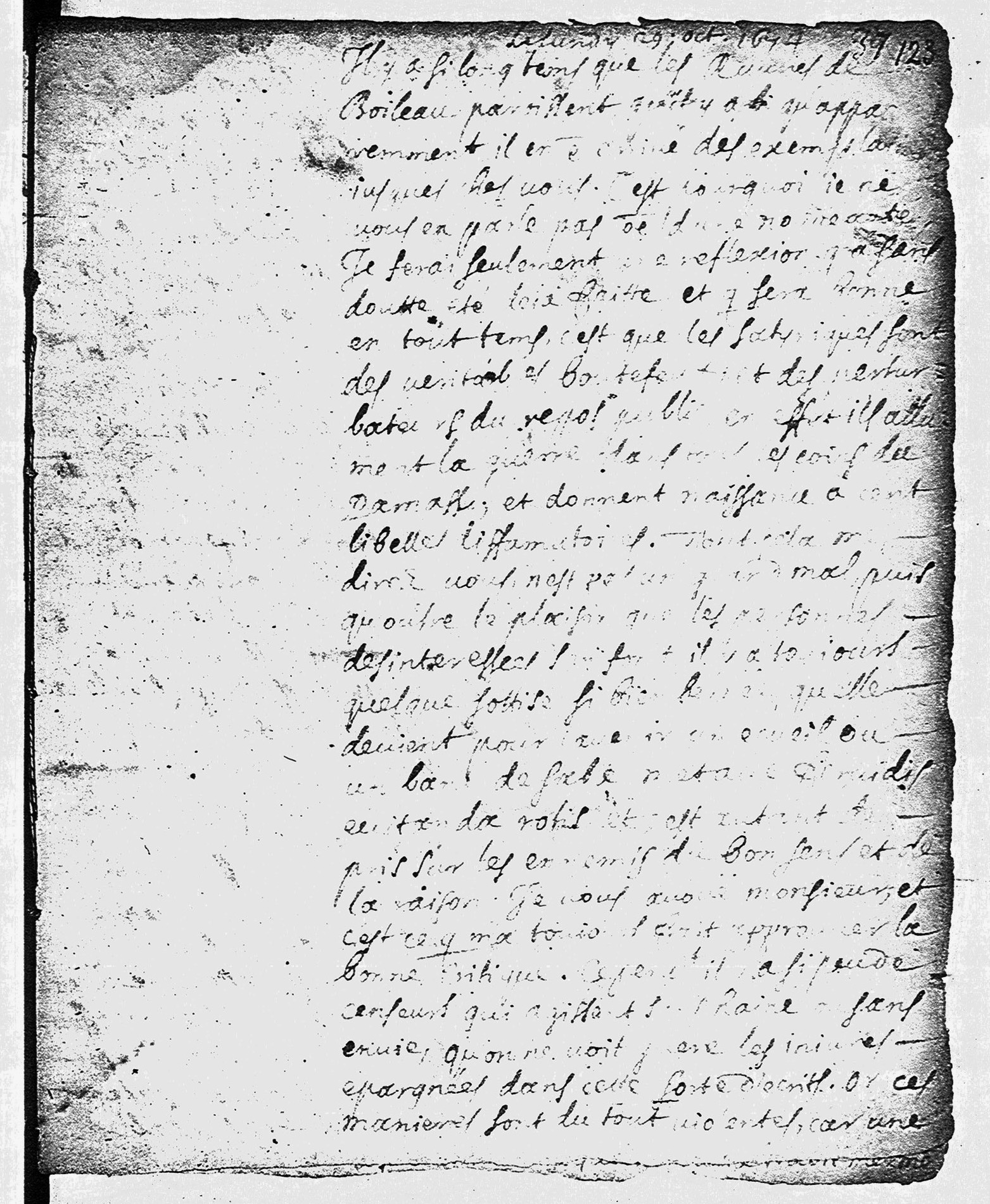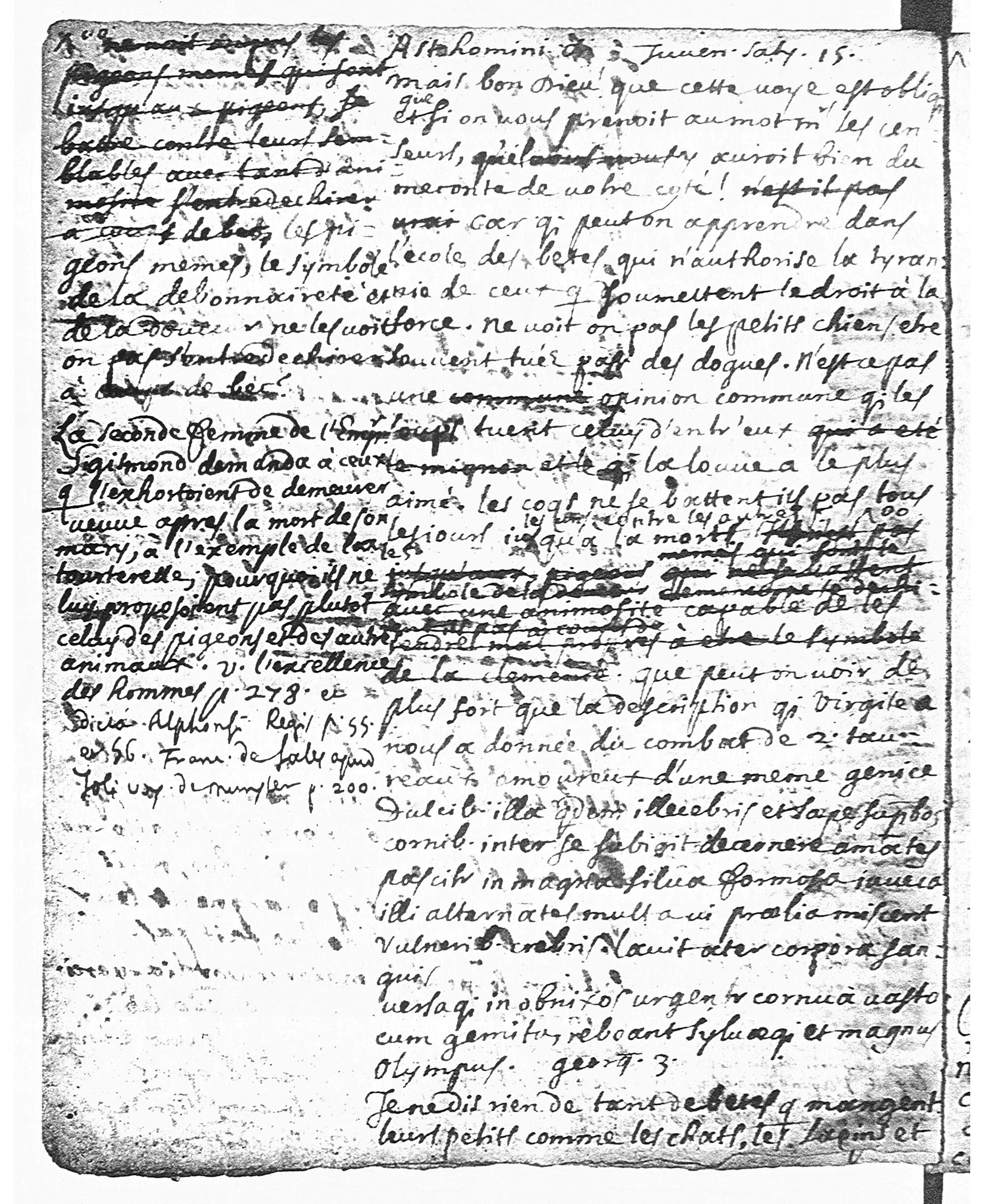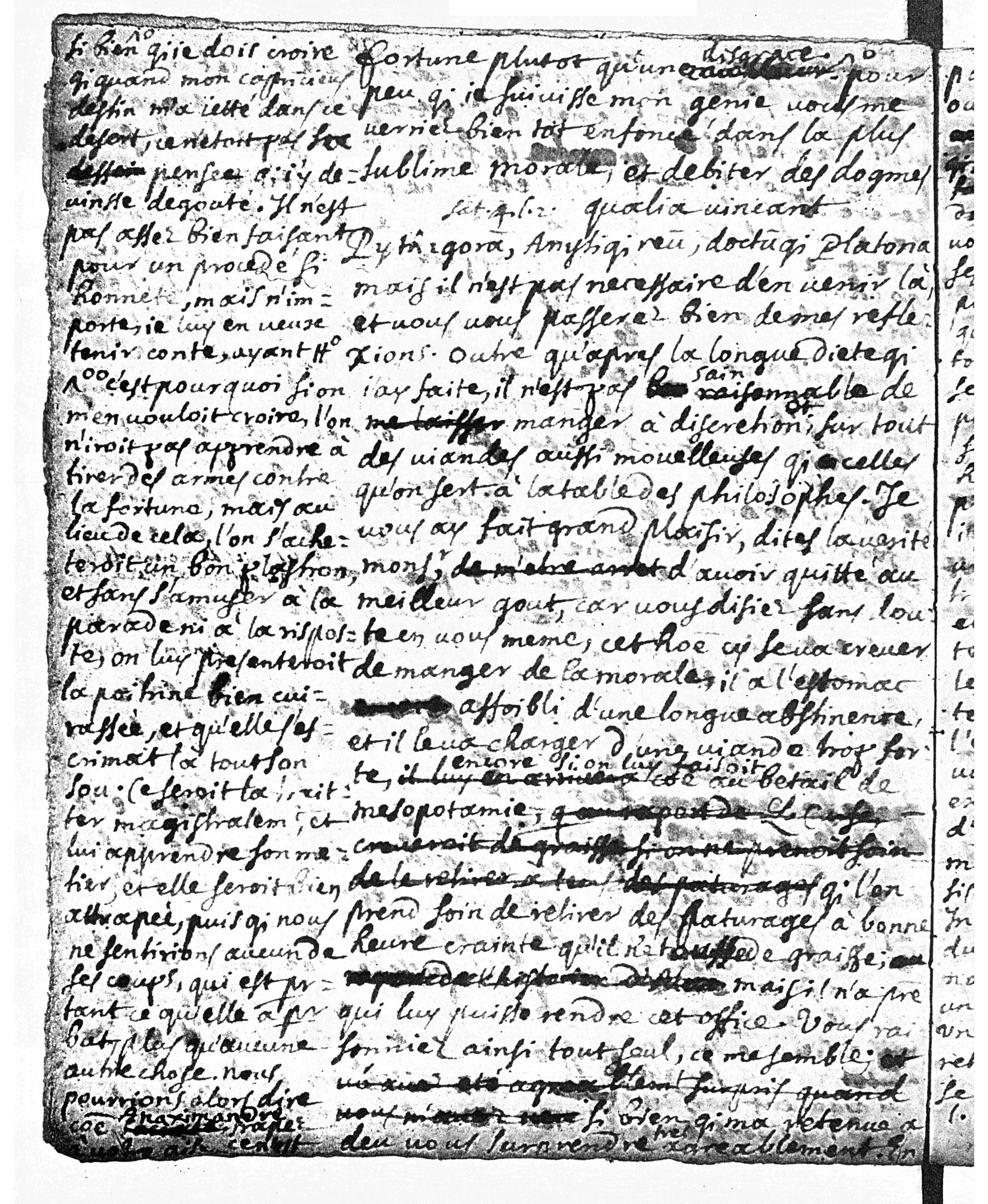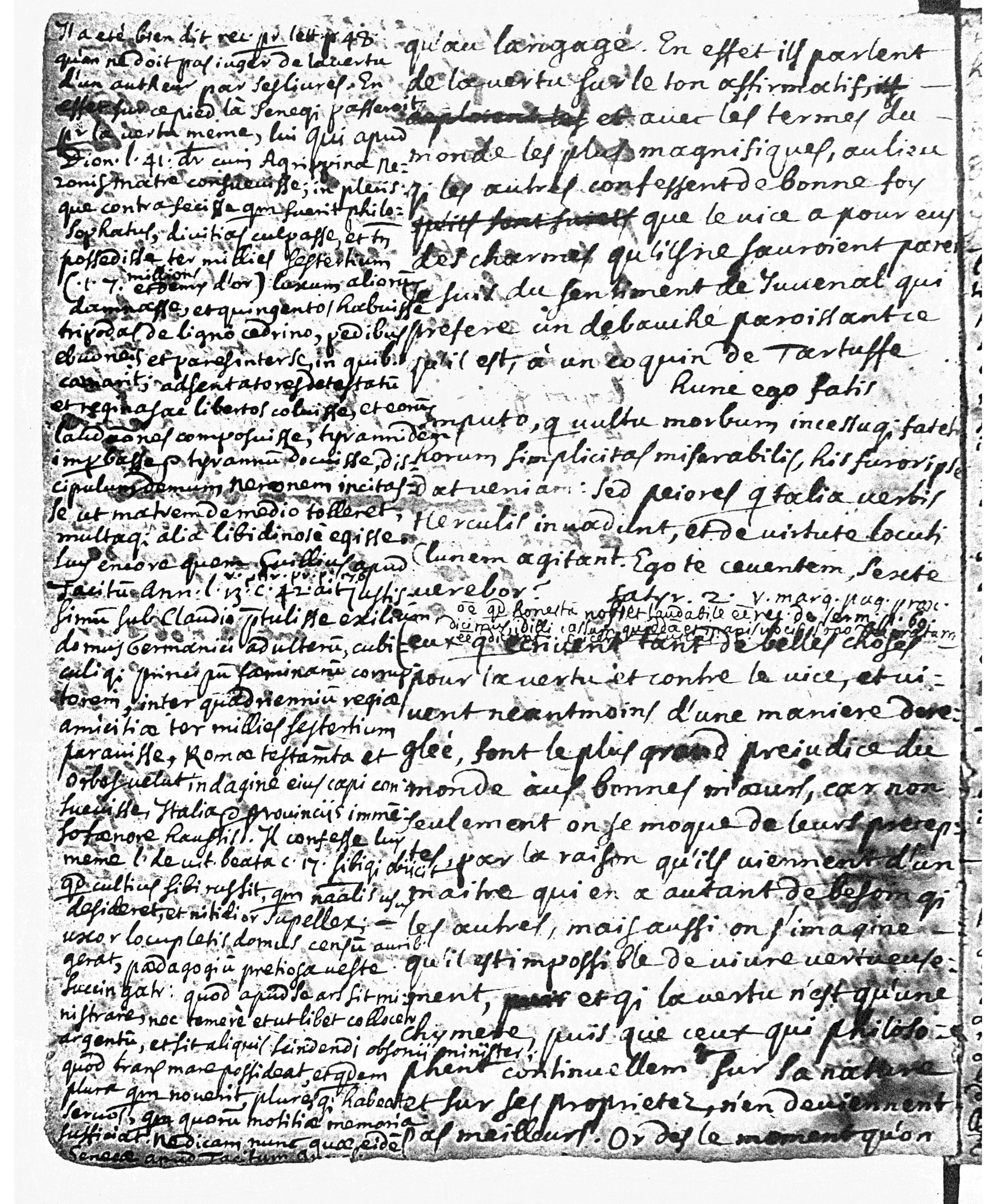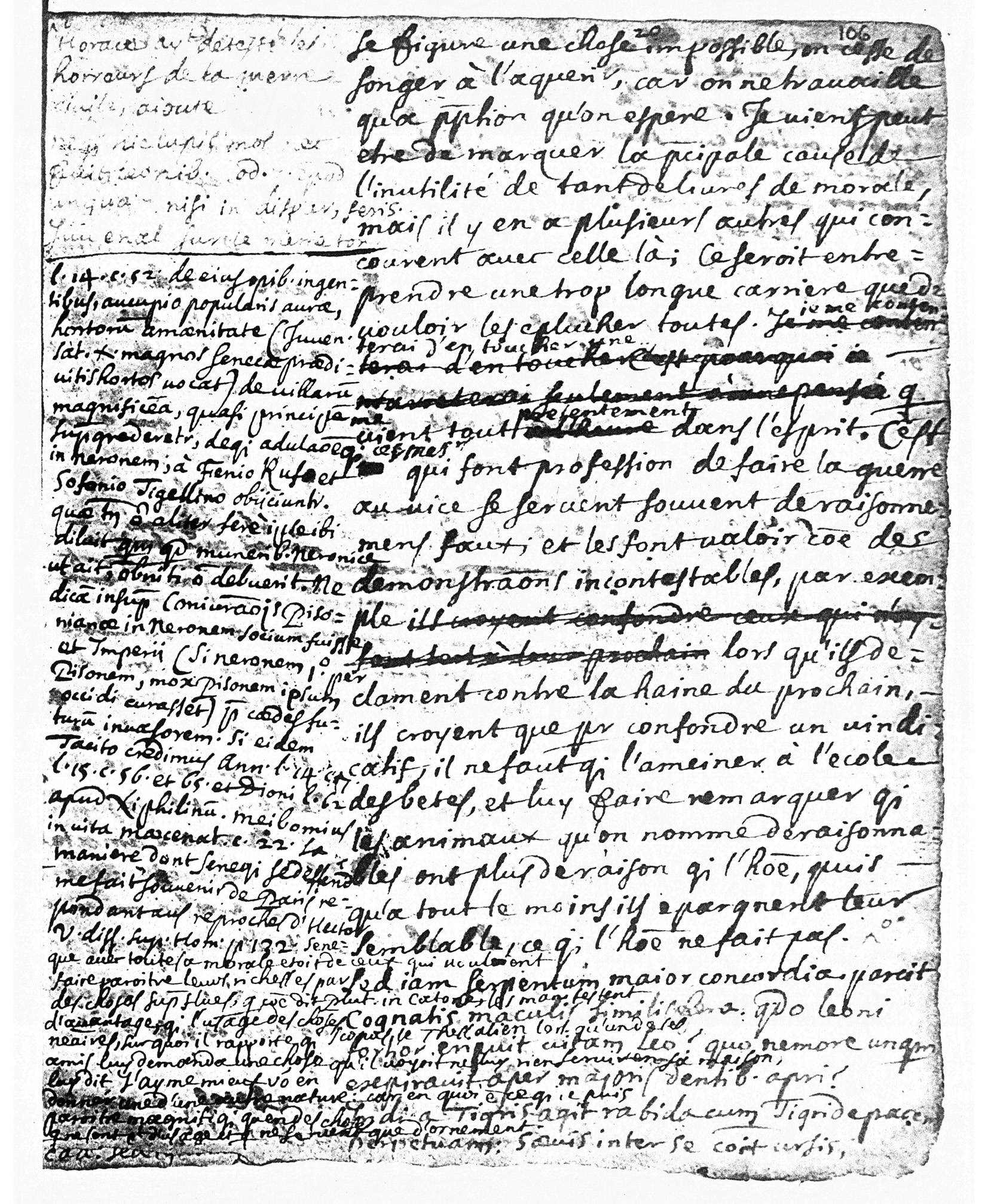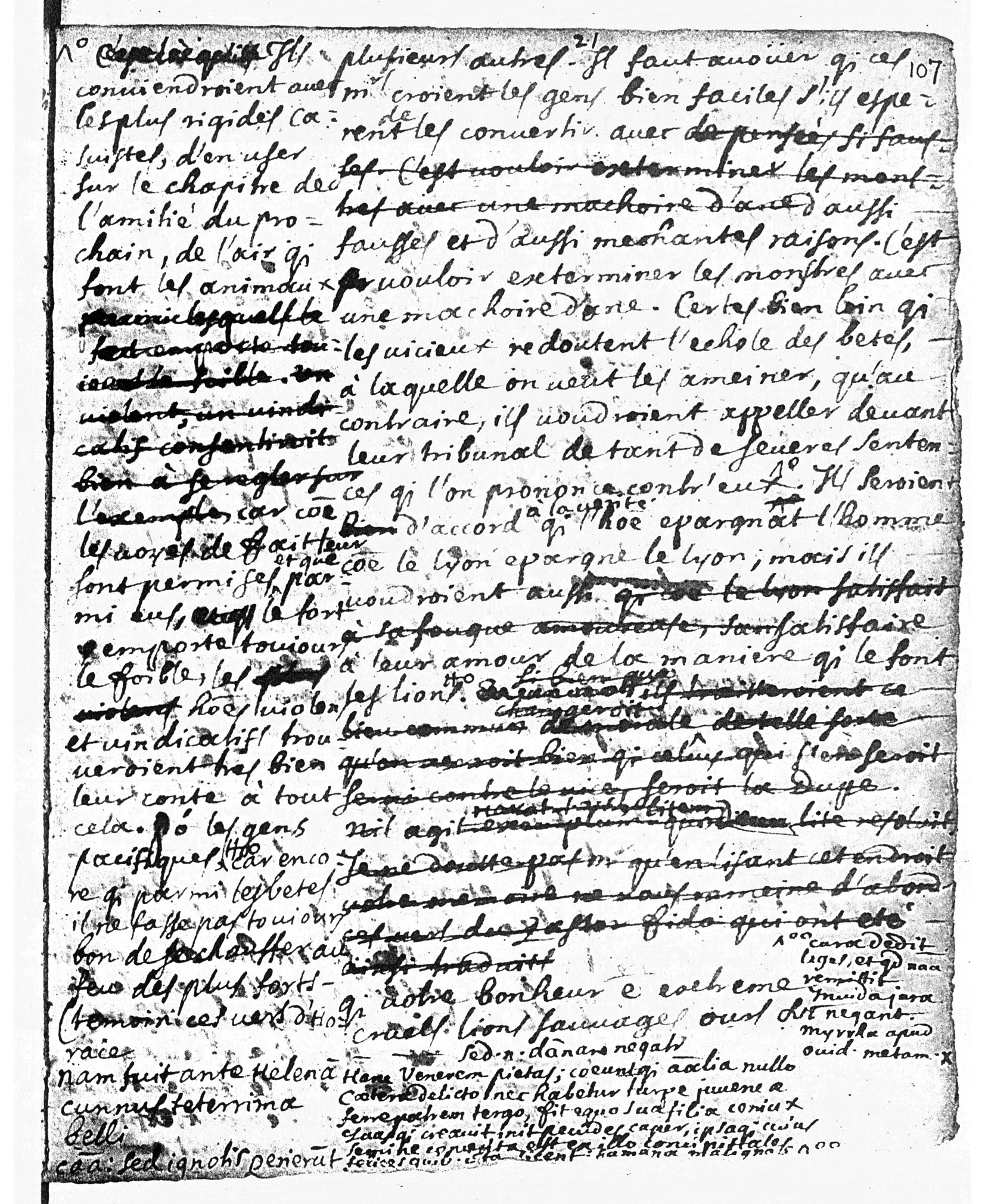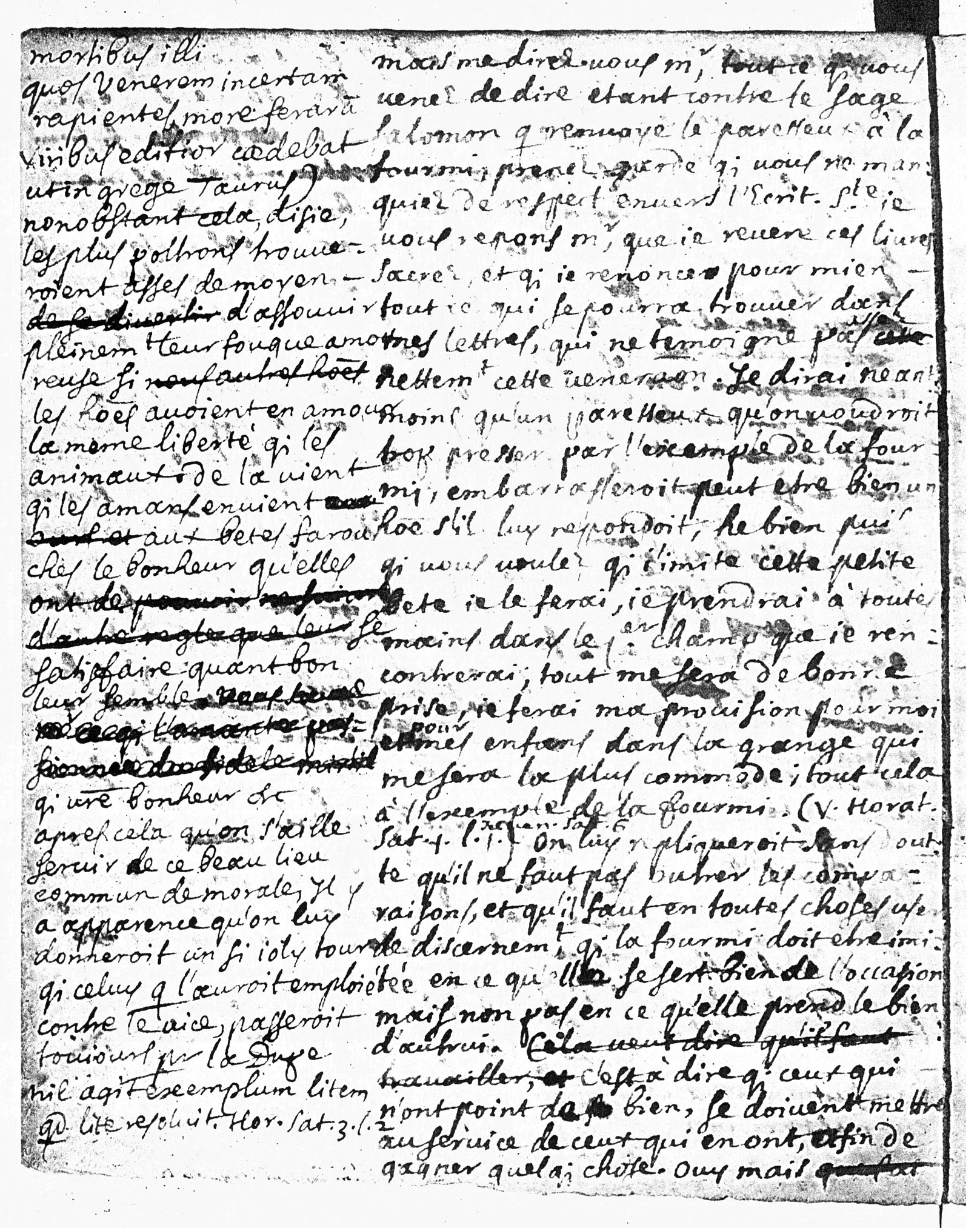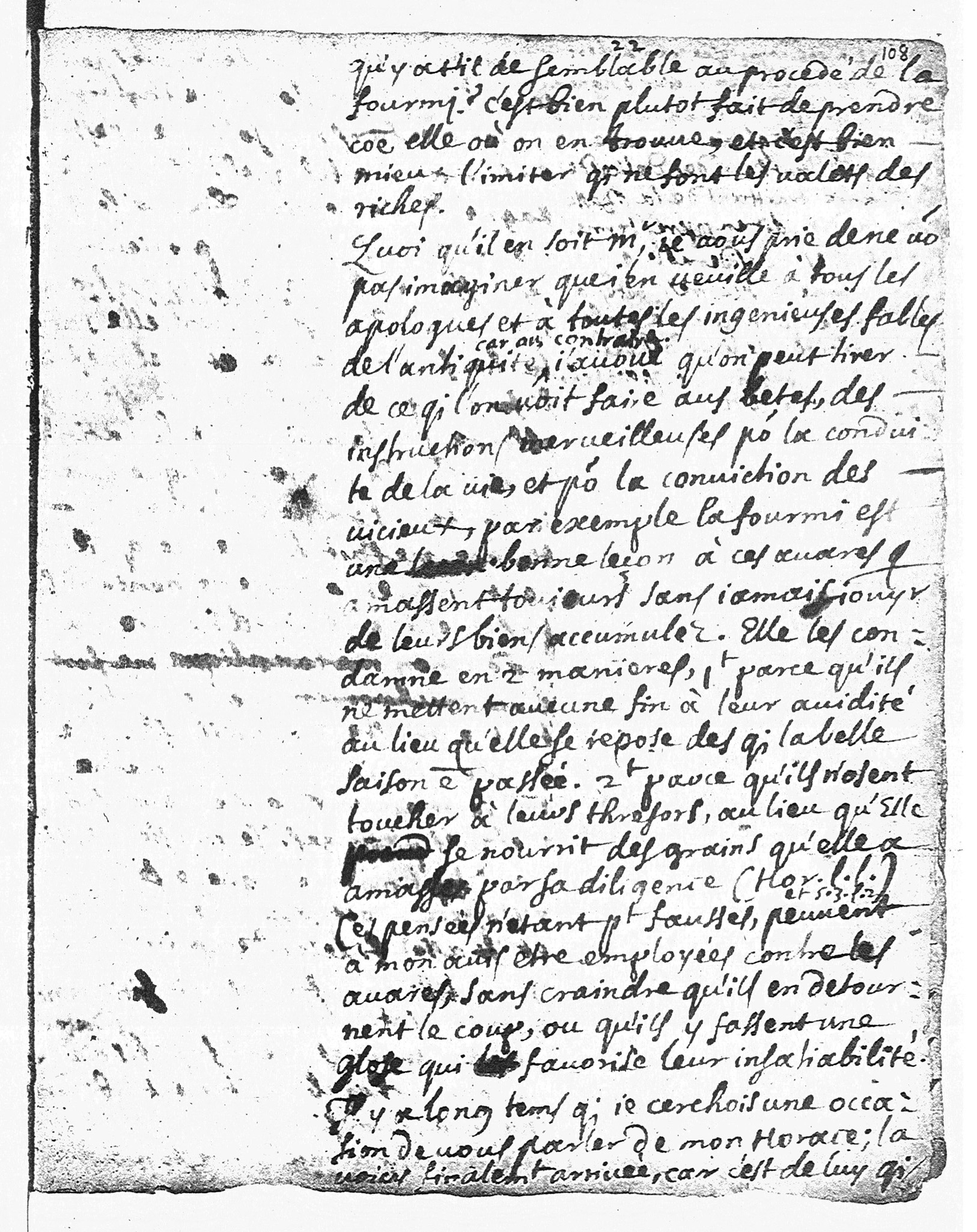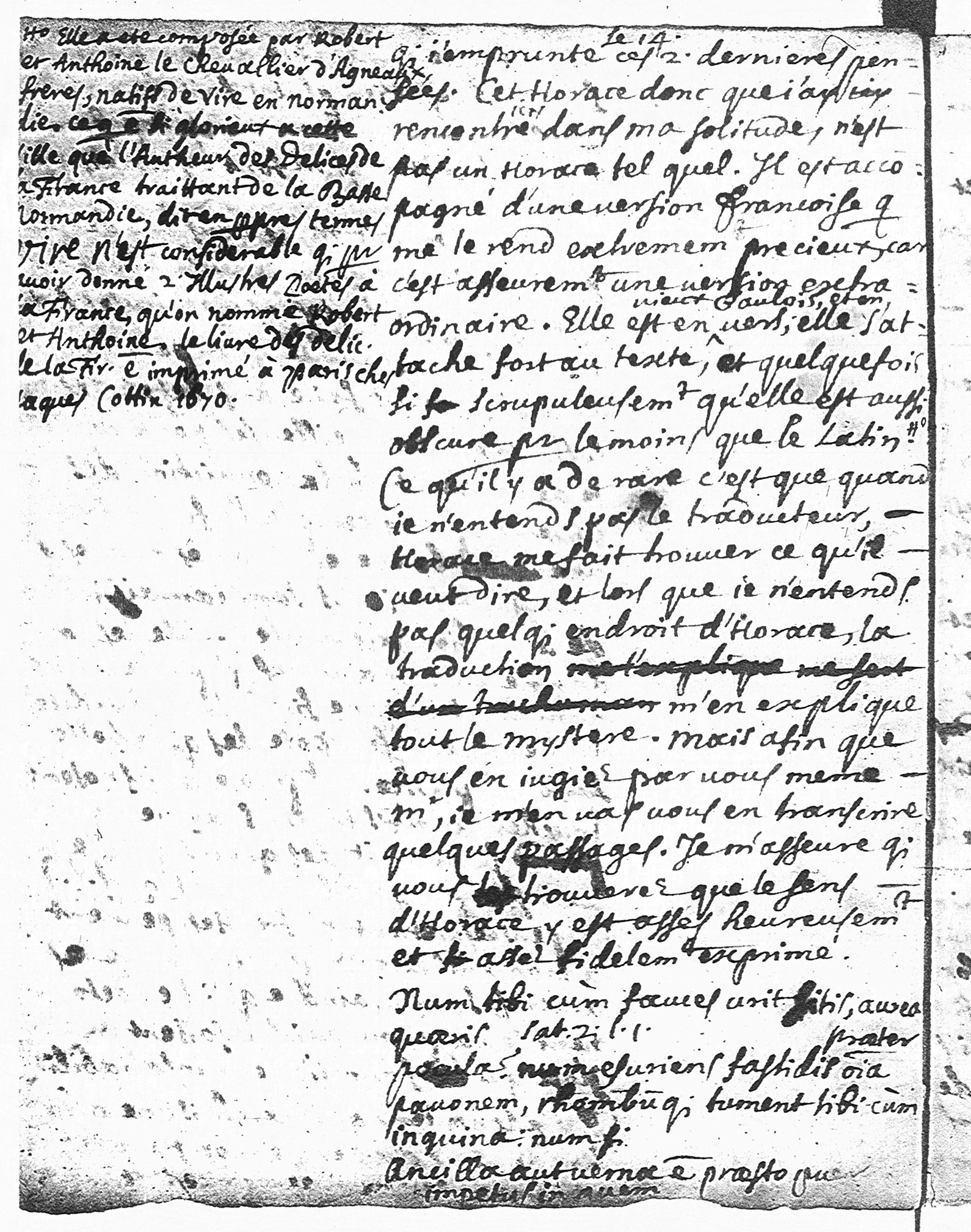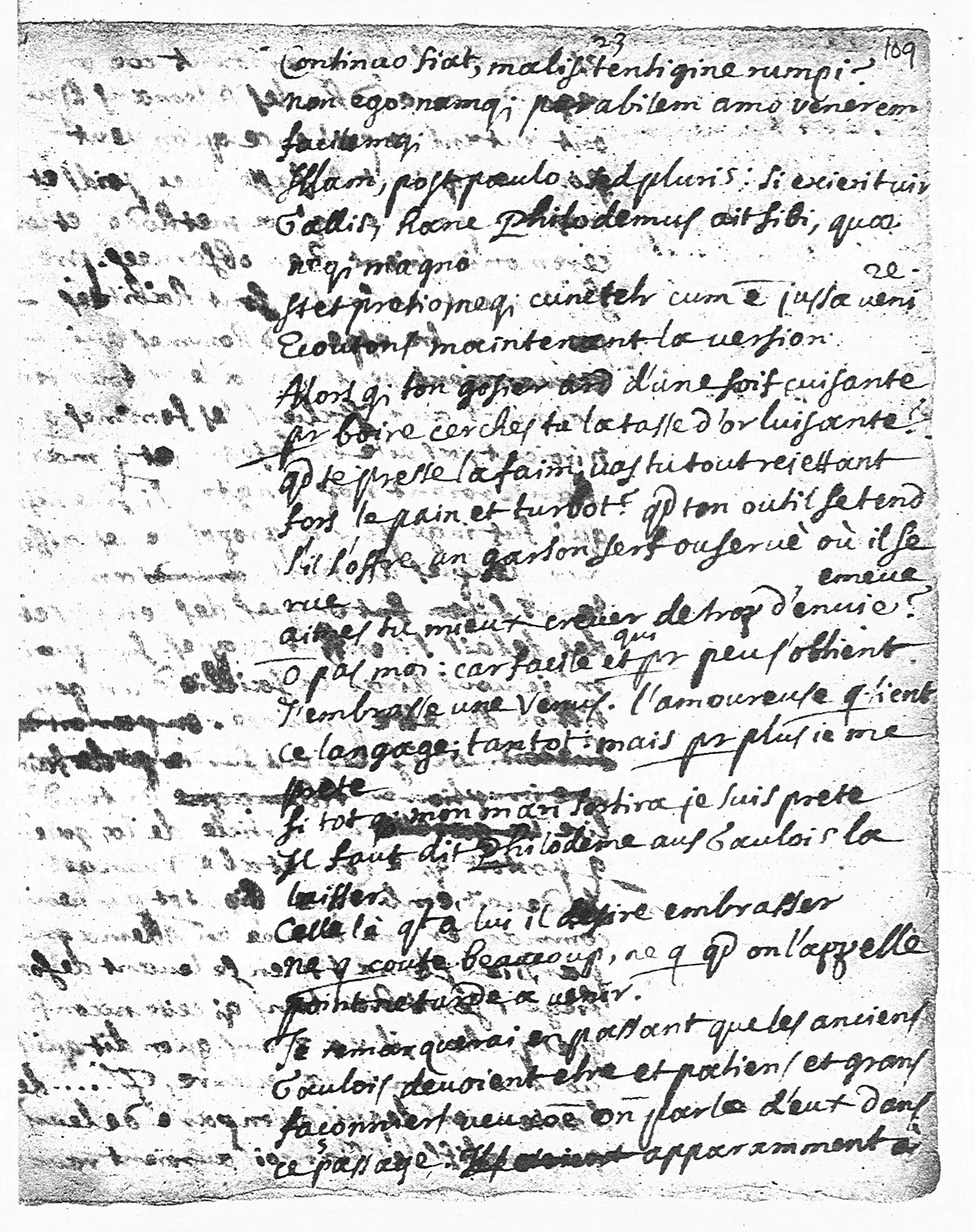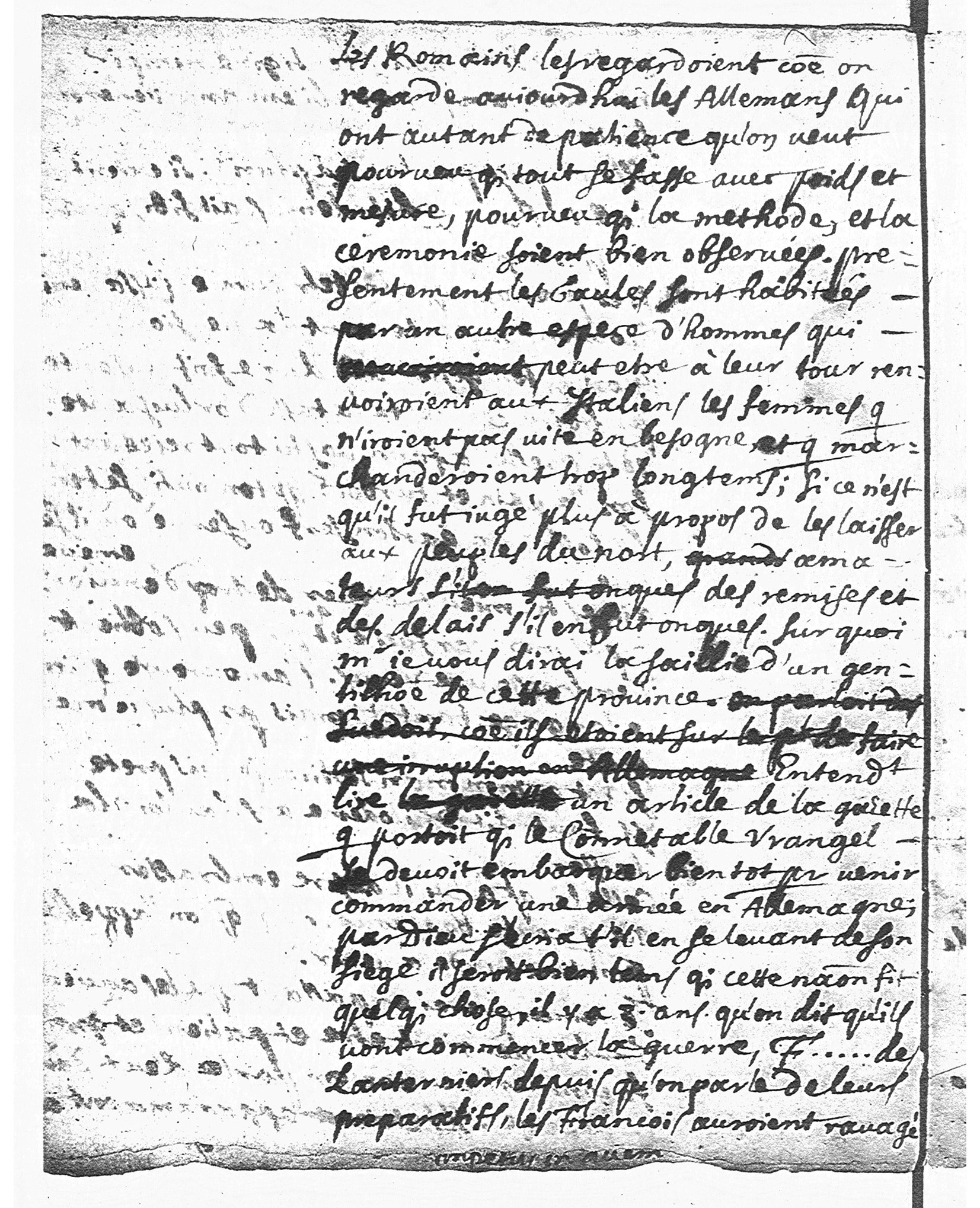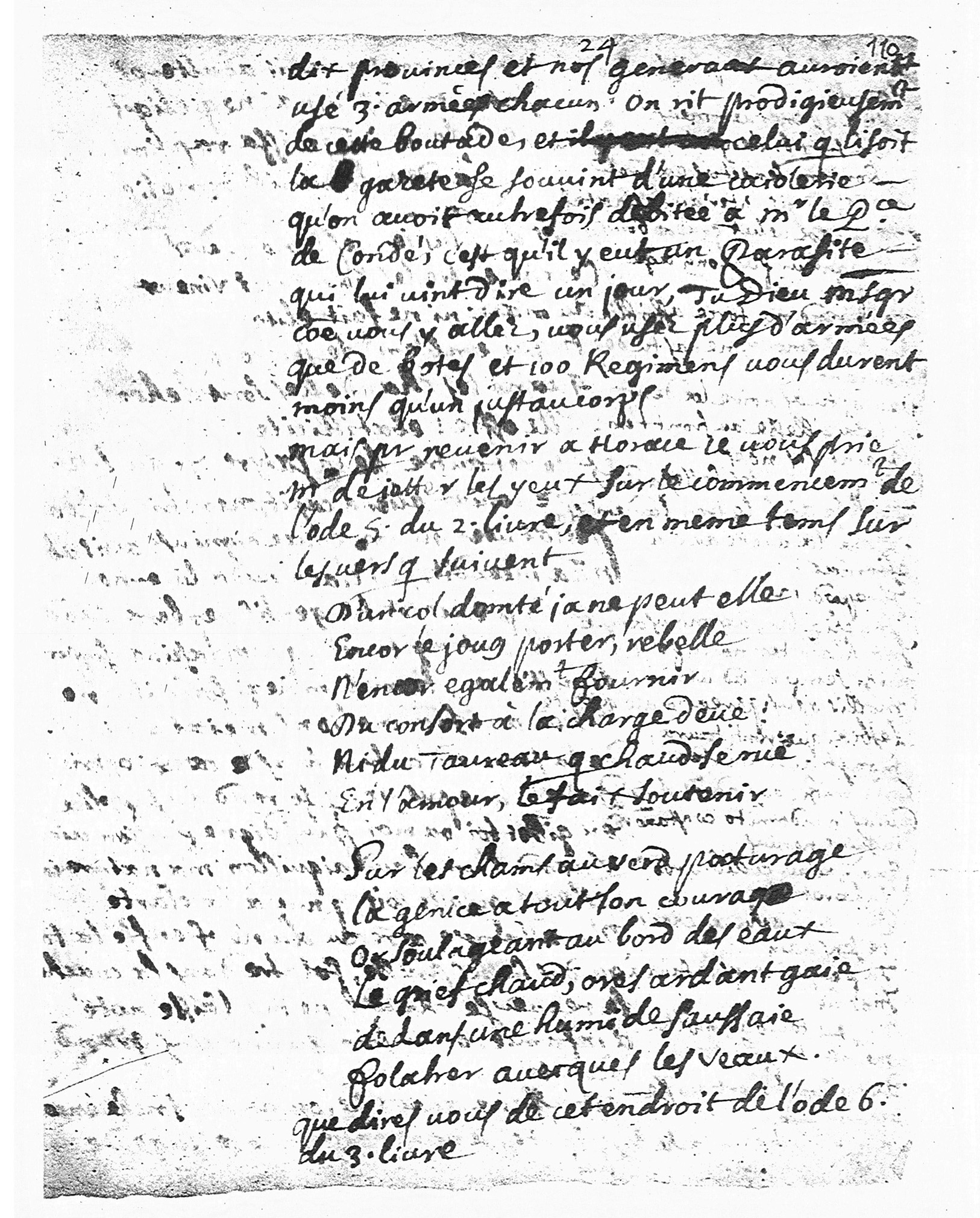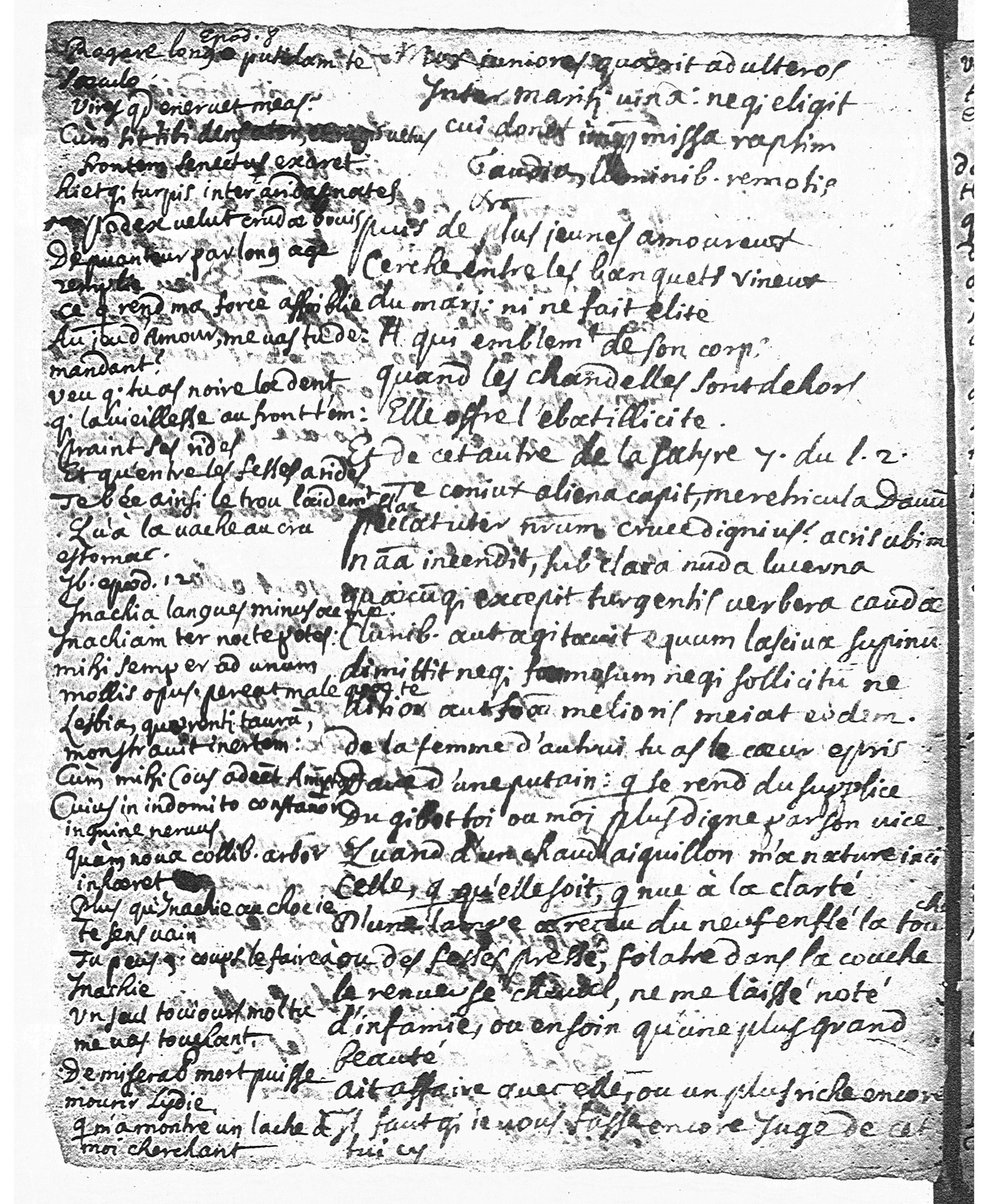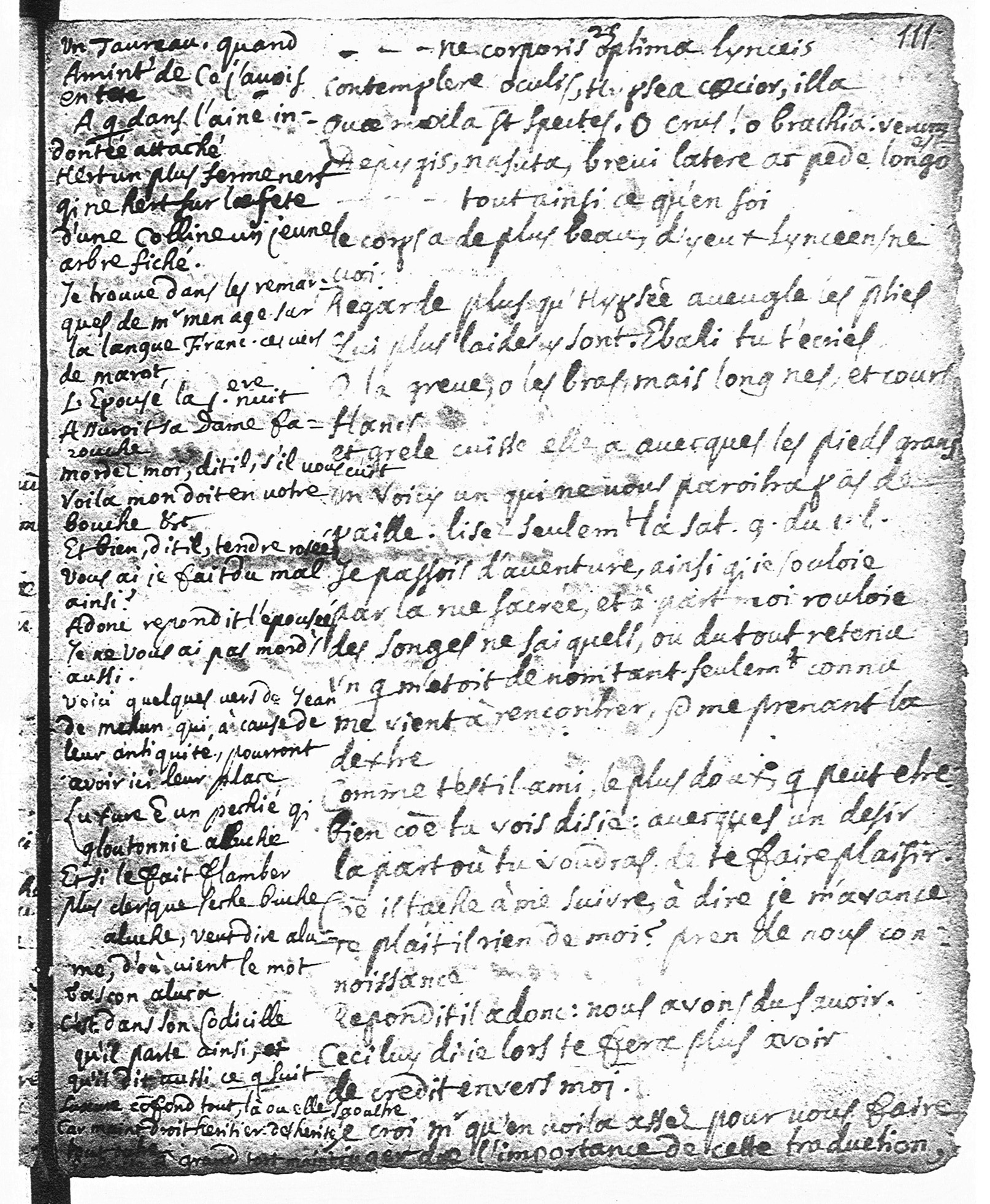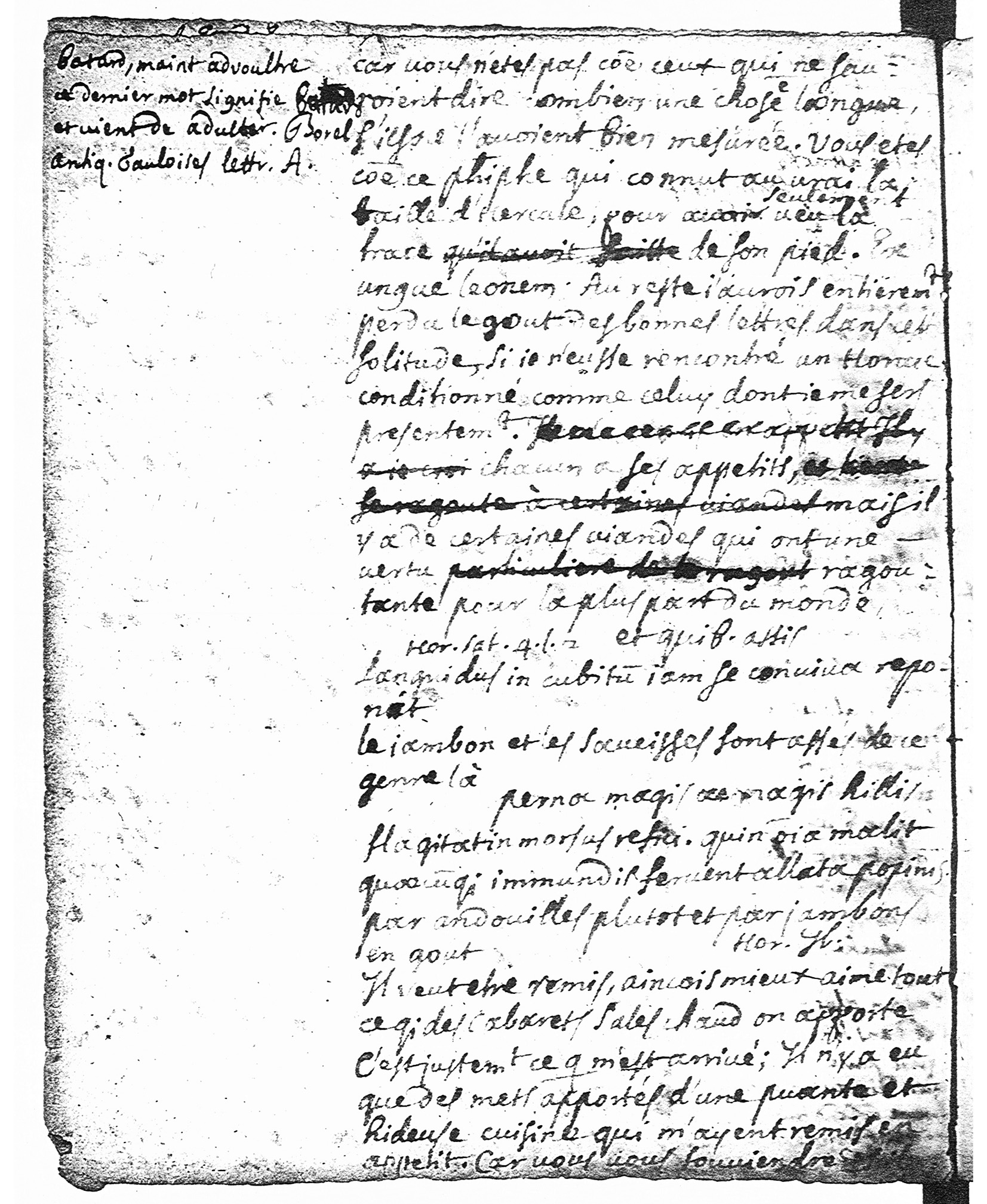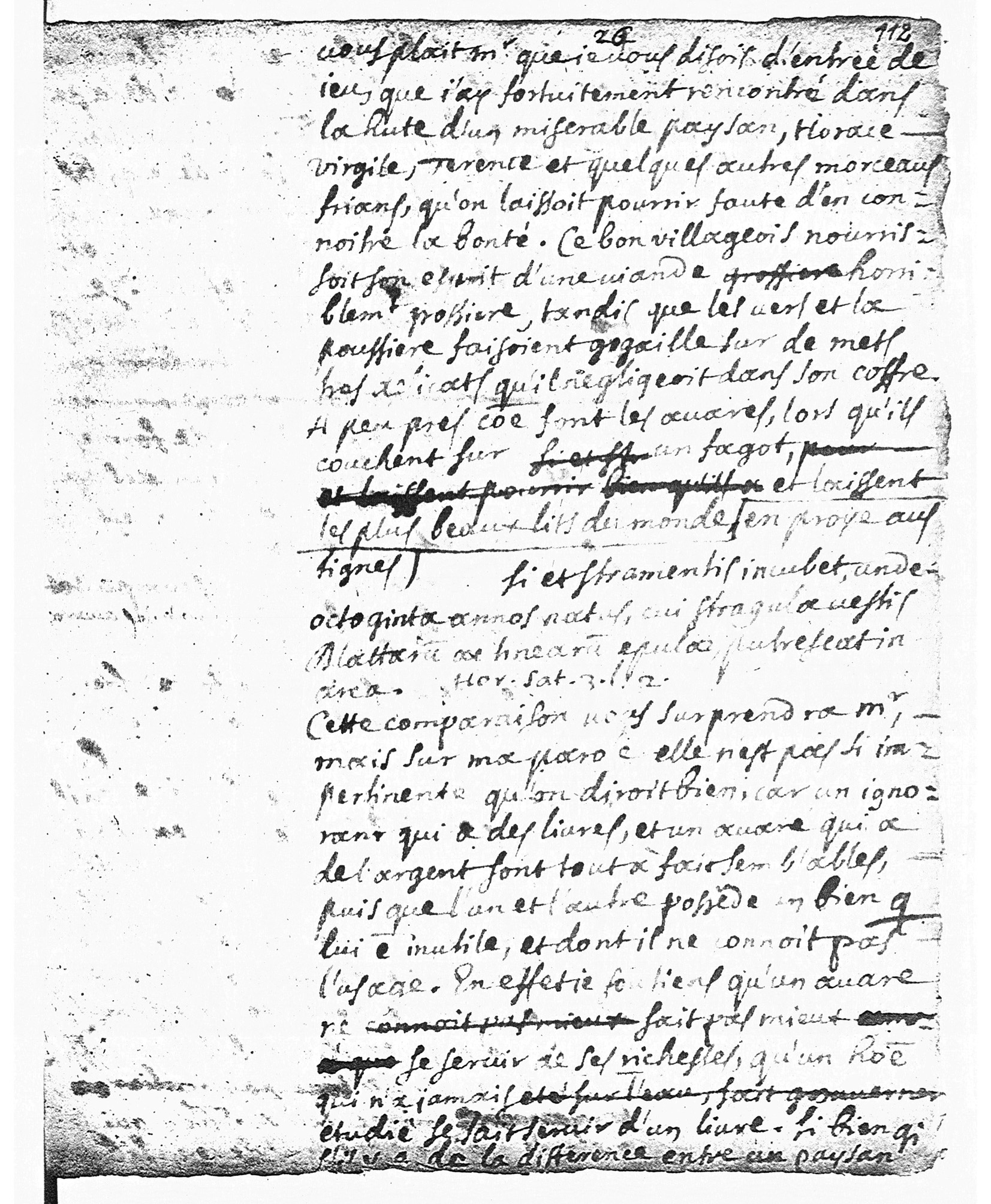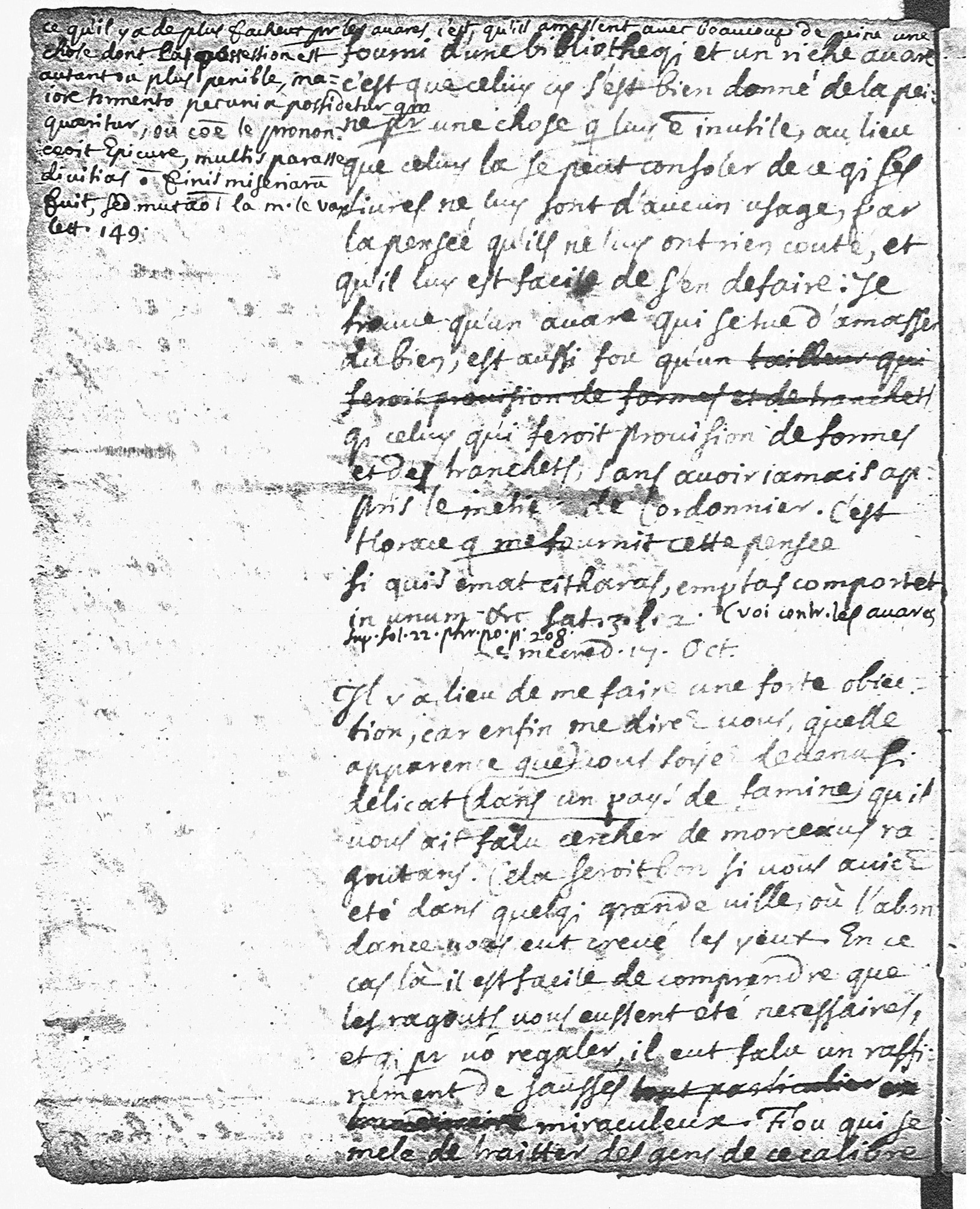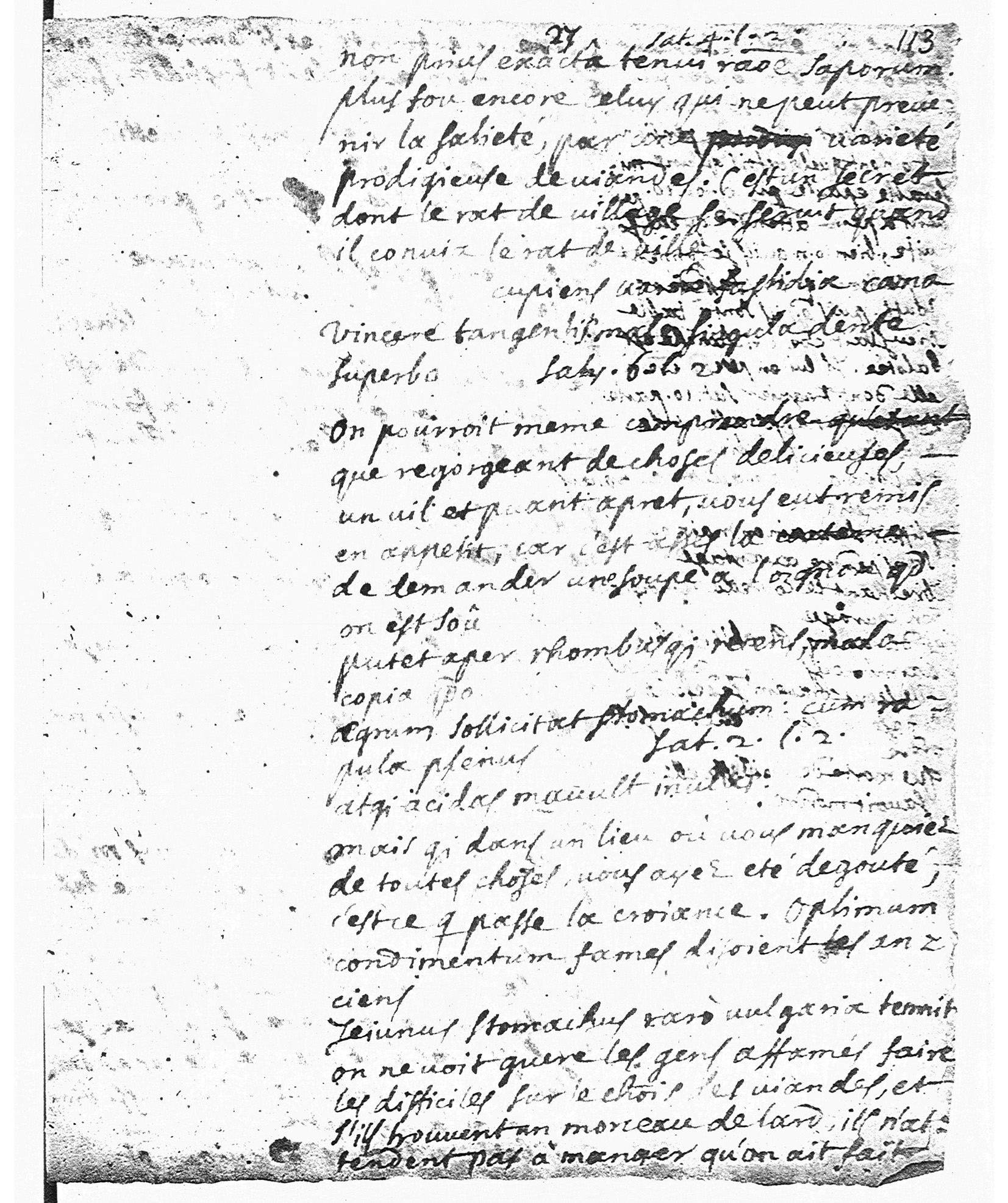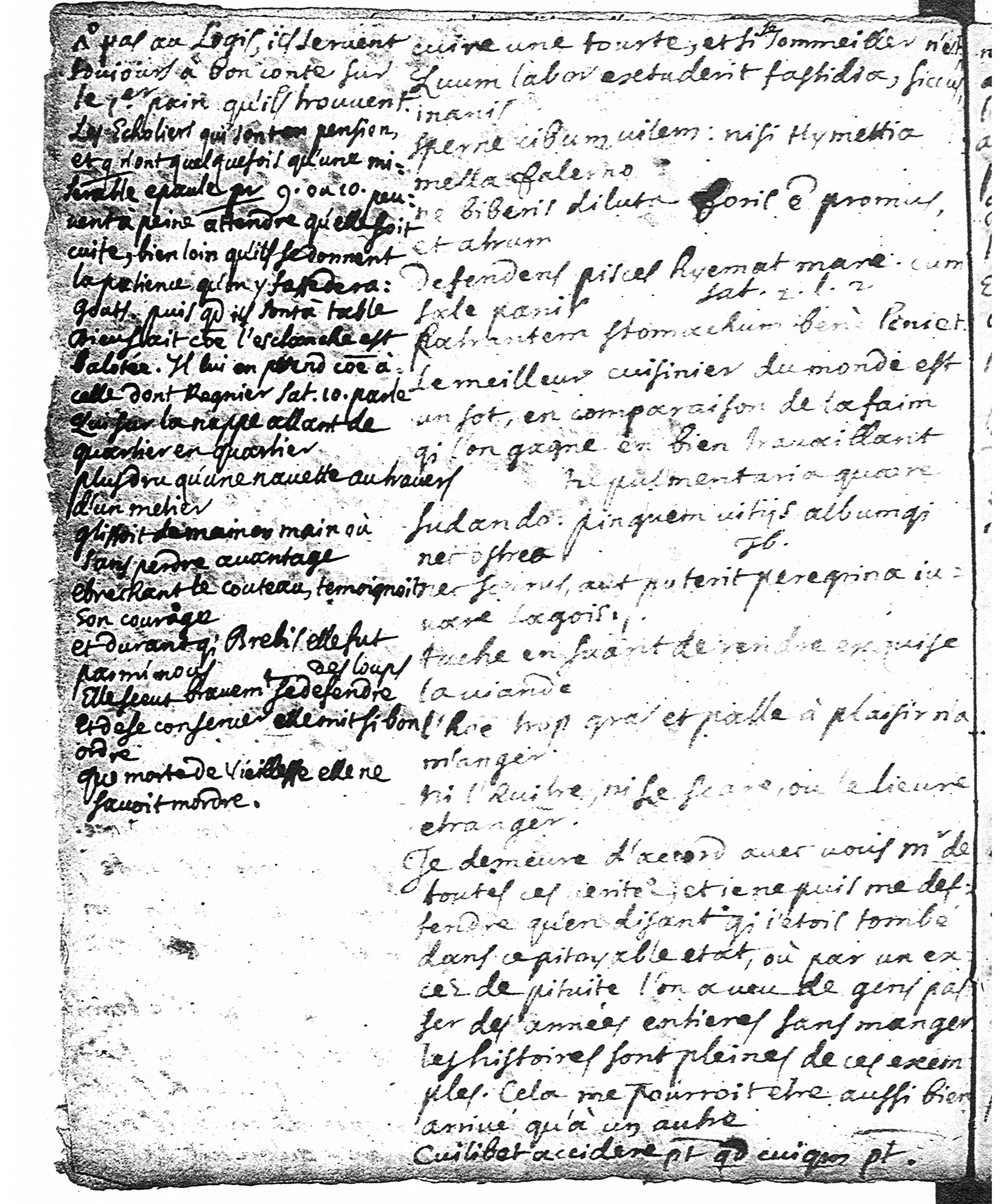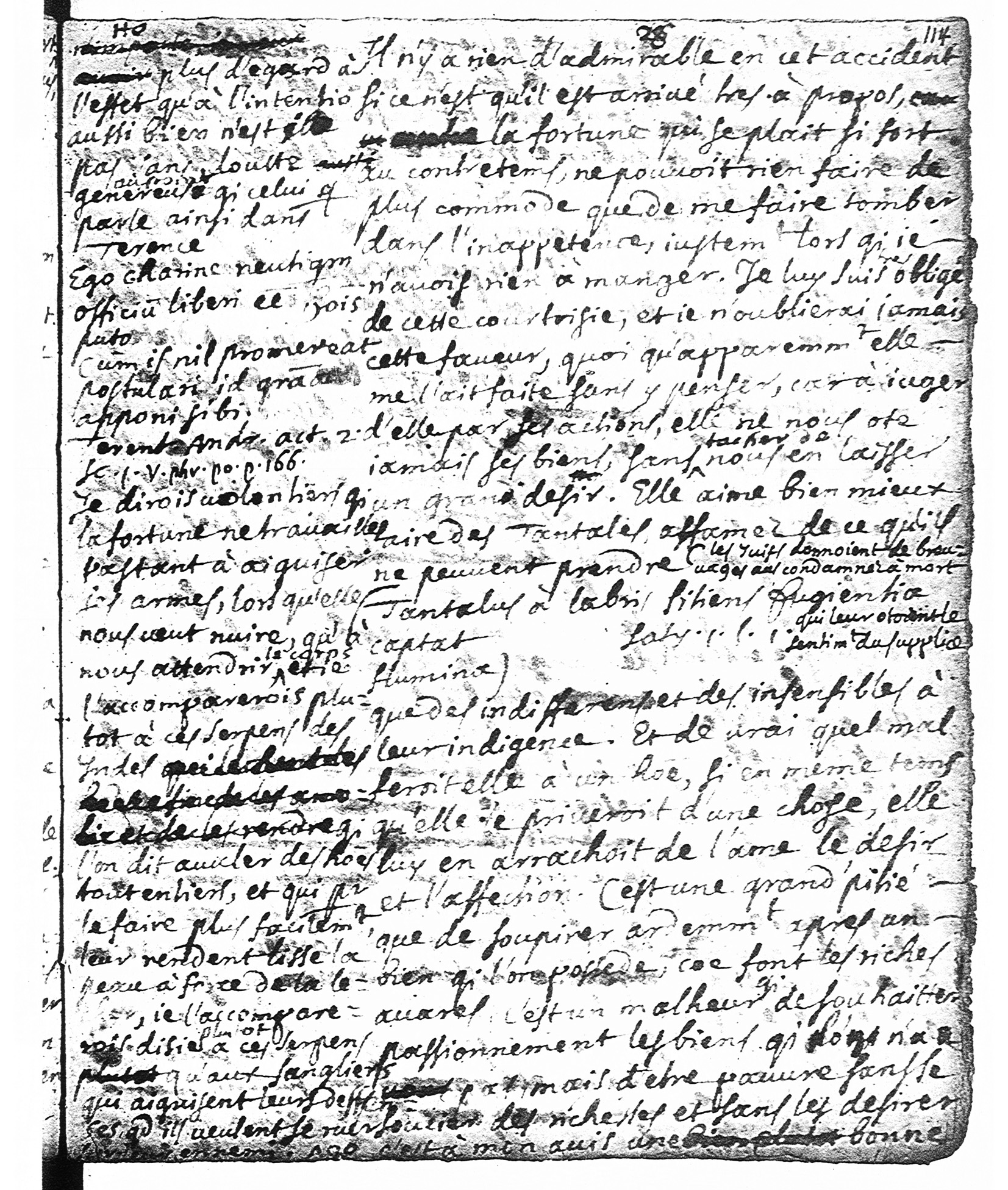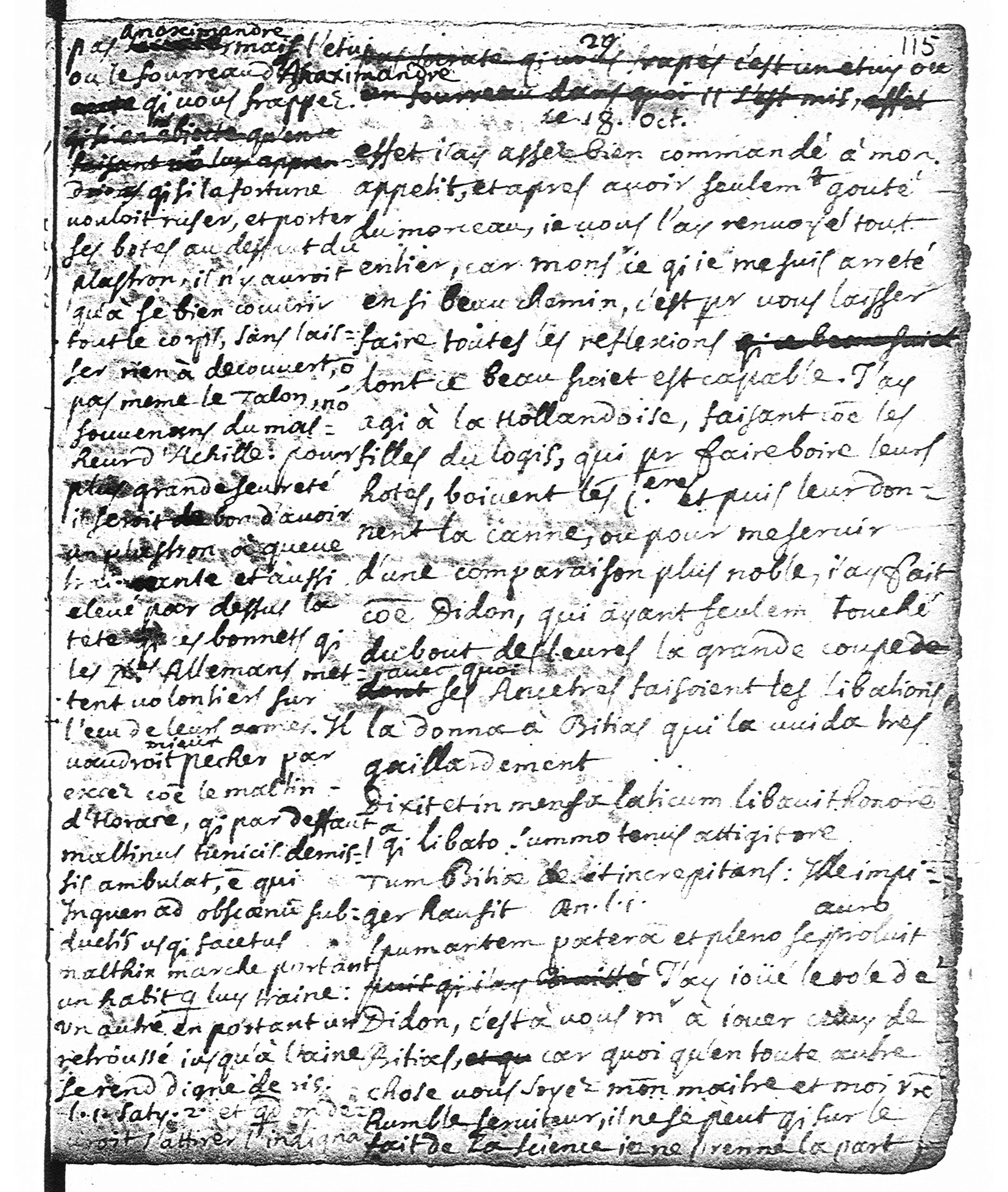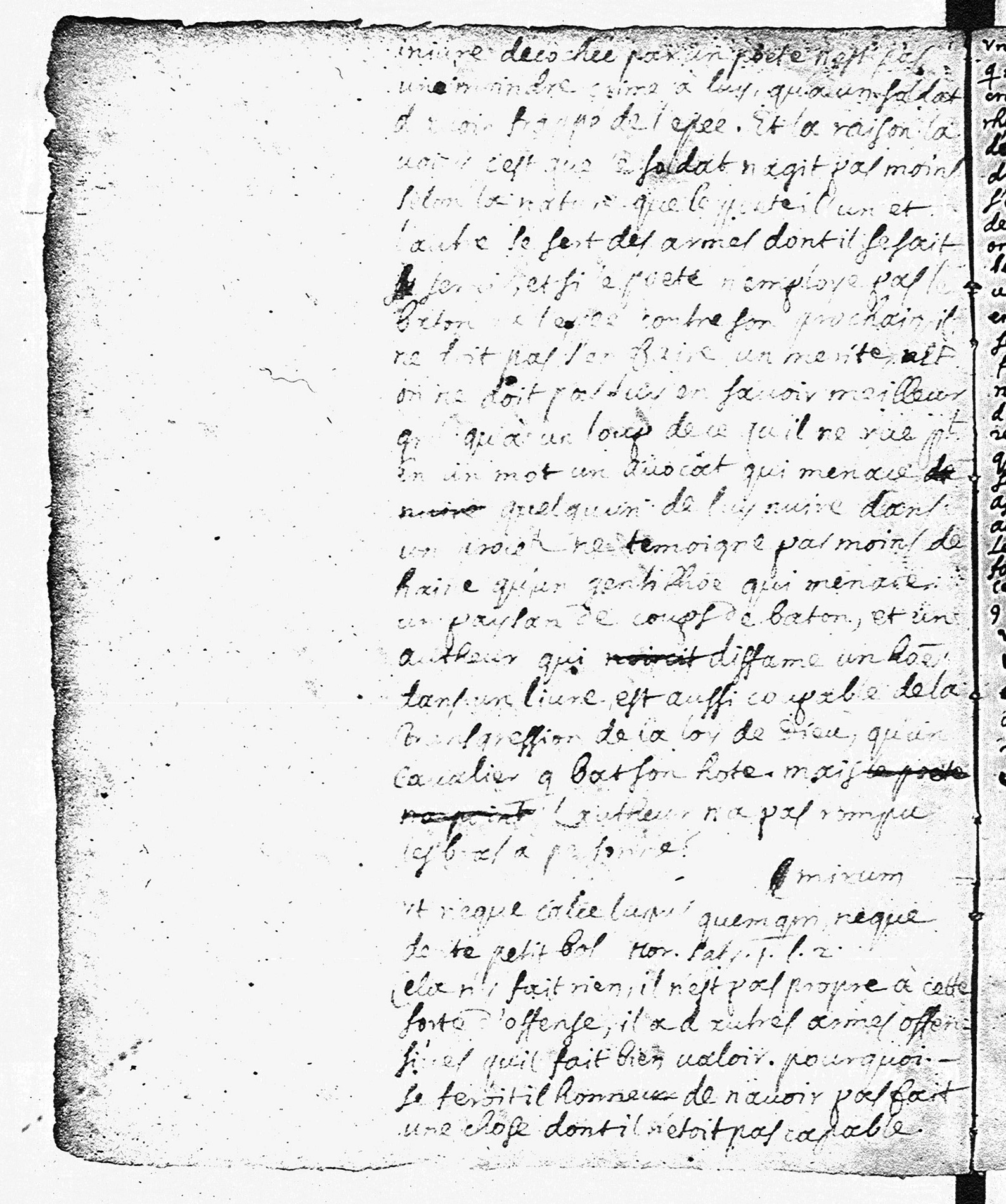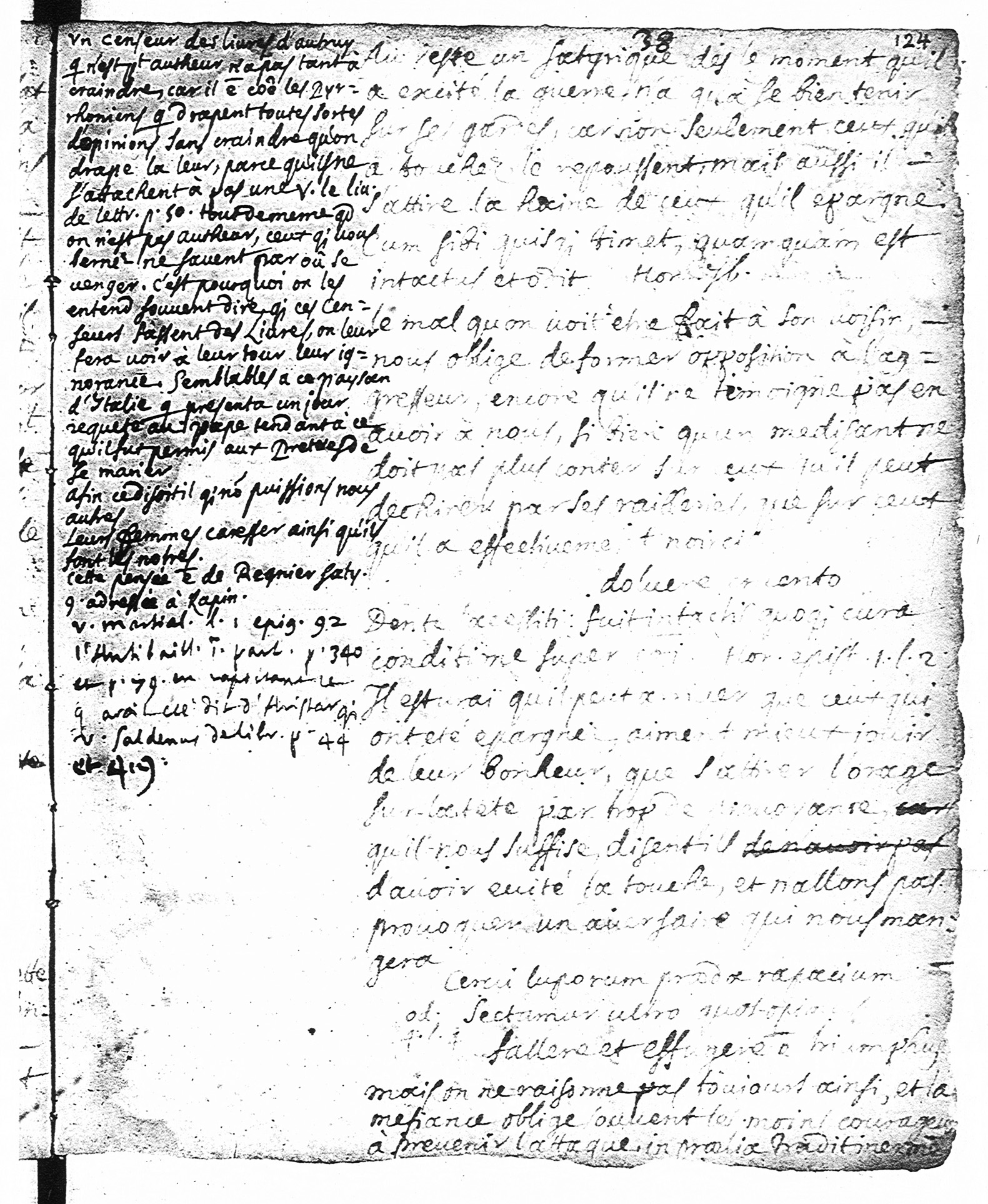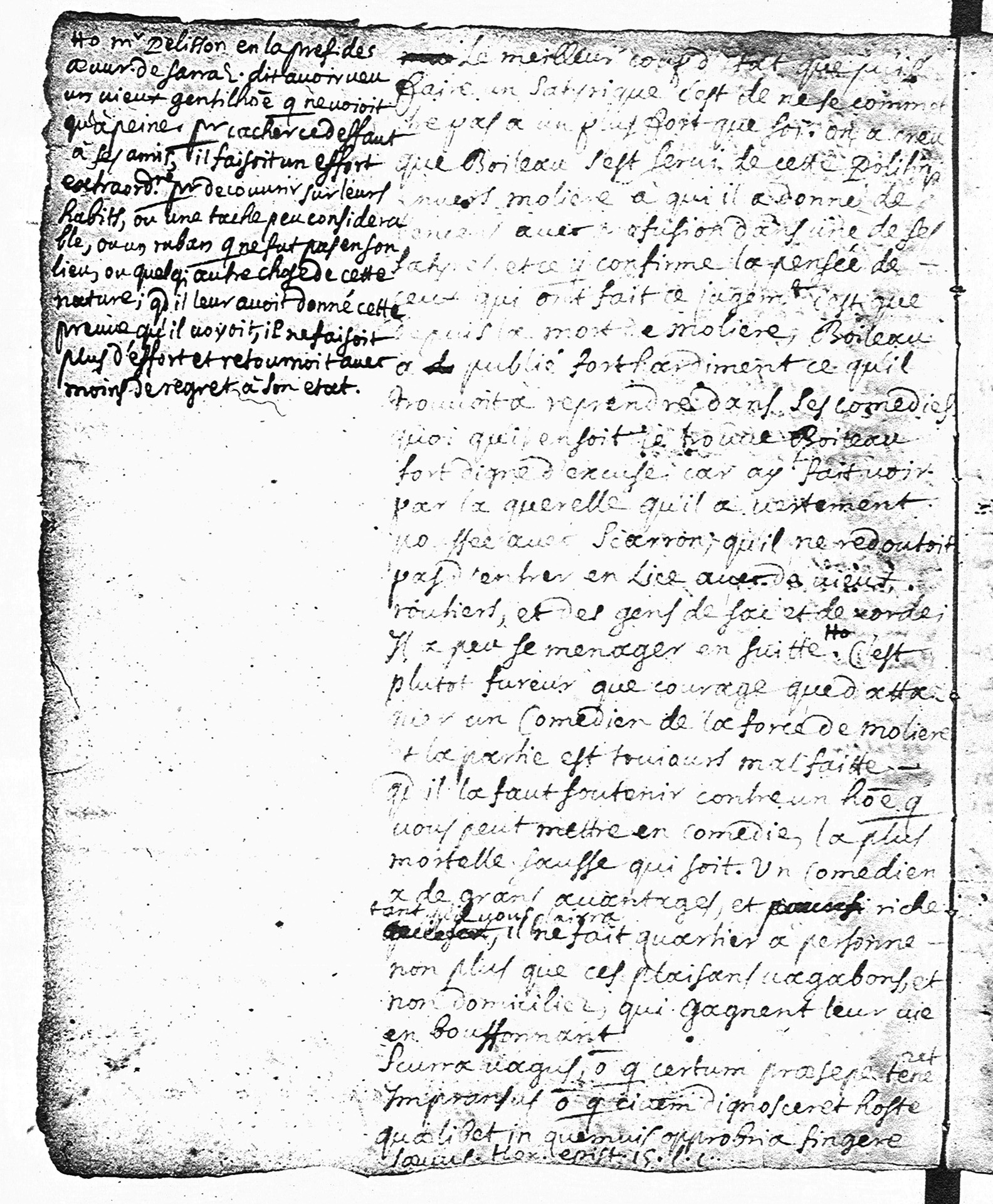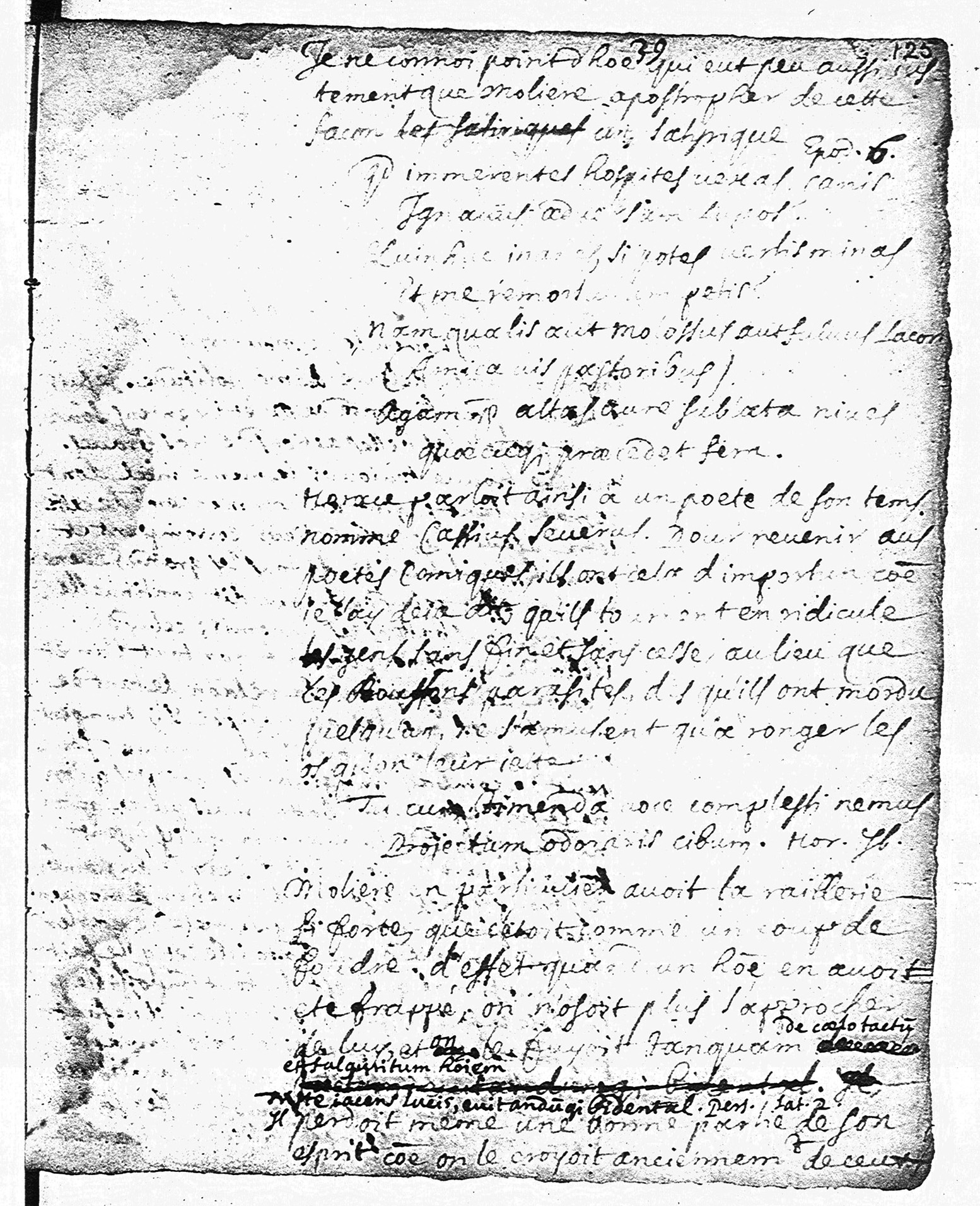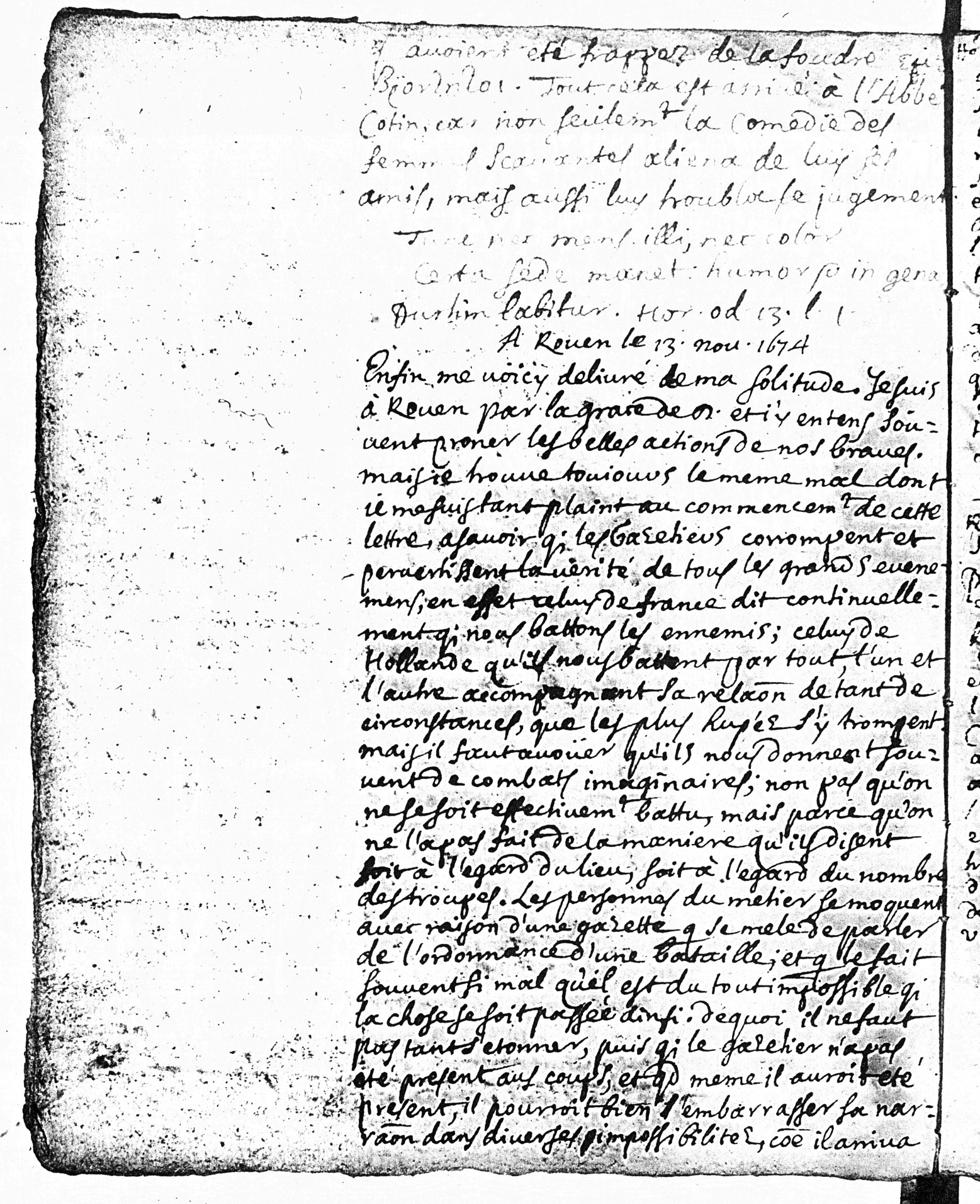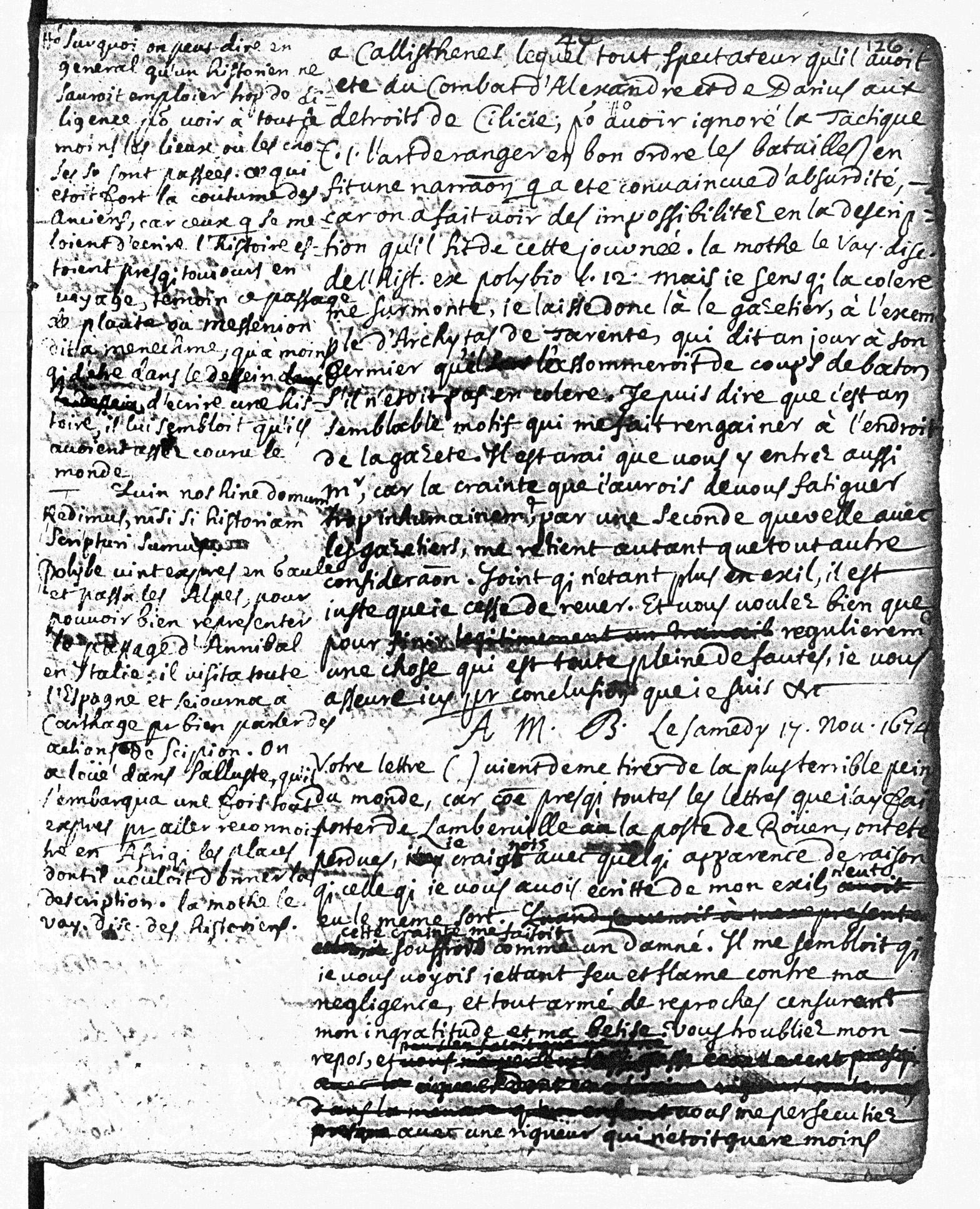Lettre 65 : Pierre Bayle à Vincent Minutoli
Vous etés si accoutumé, mon cher Monsieur, à mes compositions de campagne, qu’il n’est pas besoin que je vous fasse des excuses de ce que je vous communique les pensées qui me sont venues dans un mechant petit hameau où j’ay passé une partie de cet eté [1]. Il y a long tems que je vo[us] puis dire co[mm]e à un autre Pollion, Pollioamat etc. ( Ecl[ogarum] 3) [2]. J’aimerois pourtant mieux vous faire exercer sur une muse de ville, la charité que vous exercéz sur une muse campagnarde, car franchement ce n’est pas trop mon fait que la campagne, aussi ne m’y suis je jamais pleu sinon lors que j’y ay eté avec une troupe de bons amis ou avec quantité de livres, et si le sejour de Copet ne m’a pas semblé extremement facheux, je vous en ay mon cher Monsieur toute l’obligation, car le bon accueil que vous faisiés à mes lettres, et la peine que vous preniez d’y repondre me faisoient oublier toutes les • incommoditez* qui me pouvoient arriver d’ailleurs. Ce coup icy* j’ay eté relegué dans un village, où je n’ay eu aucun commerce* ni avec les amis vivans ni avec les amis morts, c’est à dire que mon imagina[ti]on seule m’a tenu lieu et de lecture et de conversation et de toutes choses. Vous allez sans doutte vous affliger de cette mienne deconvenuë mais consolez vous mon cher Mr mon mal n’e[st] pas sans remede, car dés le moment que mon imagination commence à s’epuiser [j’ay] trouvé par hazard 4 ou 5 des meilleurs poetes de l’Antiquité dans la maison d’un paysan, à demi rongés de vers, et portans de tristes marques du long combat qu’ils ont soutenu contre la fumée et les ordures d’une chetive cabane. Ce lamentable etat ne les empeche point de venir à mon secours le plus à propos du monde, car je n’en pouvois plus, et ils y viennent meme fort utilement, puis que malgré toutes leurs mutilations, je puis voir tous les vers de mon cher Horace, lequel vous me permettrez s’il vous plait d’apostropher en cette facon
( Ecl[ogarum] 5). [3]
Et co[mm]e un bonheur, non plus qu’un malheur ne vient jamais seul, je m’avise tout d’un tems* du grand et souverain remede de tous mes ennuys, c’est Monsieur de me transporter dans votre chambre, de m’y asseoir aupres de vous, et de vous dire selon ma coutume, tout ce qui me viendra à la bouche. Il ne faut pour toutes ces operations miraculeuses, sinon que je m’imagine fortement que je vous dis tout ce que ma plume barbouille sur ce papier
Nous sommes vous et moi un peu nouvelistes*[,] c’est pour quoi vous ne trouverés pas etrange que je debute par des reflexions sur le combat de Senef [5]. Il est assez plaisant de voir que l’un et l’autre party s’attribue la victoire avec des fanfares et des applaudissemens incroyables. On diroit que la divine providence a voulu se menager entre les 2 partis, ne faire point de mecontens et s’attirer des actions de graces aussi bien en France que dans tout le reste de la chretienté. On avoit cru jusques icy que le gain de l’un etoit la perte de l’autre et qu’en meme tems qu’on se rejouissoit d’un coté, pour une victoire remportée, on pleuroit de l’autre, la honte et le malheur d’une defaite. Mais ces vieilles maximes ne sont plus de mise, notre siecle se conduit bien autrement, et en depit du sens commun, on y voit des triomphes et des vainqueurs, sans qu’il y ait de vaincus. C’est à mon avis le bel ouvrage des gazetes. Depuis qu’on s’est avisé d’en faire par tous pays, on s’imagine qu’il y va de l’honneur d’une nation de la publier toujours heureuse, et victorieuse au lieu de debiter cette sorte d’ecrits dans la veuë d’instruire les curieux de tout ce qui se passe dans le monde, on ne se propose que d’abuser les peuples, par un beau detail de mille prosperitez vraies ou fausses, et de flatter ceux qui ont part au gouvernement [6]. C’est par cet esprit que se dispensent tous les eloges et tous les blames dont on est si prodigue dans les gazetes, et cela etant, quelle apparence que jamais un gazetier avouë de bonne foy les mauvais succez*de son party. D’ailleurs on tire de si grandes consequences du moindre mot d’une gazete, qu’on se garde biend’ y avoüer aucune chose que les ennemis puissent interpreter à leur avantage. Par exemple si le gazetier francois avoit seulement dit que l’avantage avoit eté egal au combat de Senef, les Hollandois n’auroient pas manqué de se prevaloir de cet aveu, et de l’interpreter pour une ample et formelle confession de leur victoire. La Gazete de France avoit dit une fois que nos troupes s’etant battues dans le Roussillon avec les Espagnols les avoient enfin contraints de se retirer, mais que quelques uns de nos escadrons les ayant poursuivis avec plus de courage que de prudence en avoient eté enveloppez, d’où etoit arrivé que les Espagnols ne nous avoient pas laissé un ava[n]tage aussi plein et aussi entier qu’ils auroient fait sans cela [7]. Le gazetier de Hollande trouva ces termes si significatifs qu’il publia que ce recit avoit fort l’air d’une deffaite [8]. J’ay ouy dire cent fois à vos nouvelistes* de Geneve, puis que les Francois ne se vantent pas d’avoir batu les ennemis c’est signe qu’on les a bien batus. Tant il est vrai que l’on interprete le plus desavantageusem[en]t q[ue] l’on peut pour les ennemis, les moindres mots qui leur echappent dans leurs relations, c’est pourquoi pour se mettre pleinement à couvert de la malignité de semblables interpreta[ti]ons, chaque parti ne parle que de ses victoires, et cela avec les termes les plus forts et les plus emphatiques dont on puisse se servir. Car ce seroit se rendre manifestem[en]t suspect de fausseté, que de n’affirmer pas les choses avec la derniere confiance, et de ne les pas appuyer de plusieurs circonstances etudiées. C’est icy qu’on pratique mieux qu’autre part cette regle, qu’il faut mentir tout à fait effrontem[en]t ou ne s’en pas méler.
Credit[u]r à multis fiducia [9] .
Juven[alis], Sat[yrarum] 13, vs 109
Or quand une fois la raison d’etat a voulu q[ue] le gazetier publiat une victoire, c’est une suitte qu’on face chanter le Te Deum, qu’on allume des feux par toutes les rues, qu’on tire le canon, et choses semblables, car ce seroit trop visiblement dementir le gazetier, et decouvrir l’artifice, que de manquer à ces ceremonies, et les ennemis ne s’ oublieroient* pas à tirer de là une nouvelle preuve de leur victoire. C’est donc à qui fera mieux eclater sa joye, à qui fera plus de fanfares, car il est bien asseuré qu’on prejuge en faveur de celuy qui meine le plus de bruit.
Sur ce pied* là je ne doutte nullement que les etrangers n’attribuent la victoire du combat de Senef, aux troupes confederées ; car les Francois ont incomparablement moins meiné de bruit que les autres. On s’en etonne, sur tout quand on vient à faire reflexion qu’ils ne sont pas les plus modestes du monde. Cepend[an]t ils se sont contentez de publier une rela[ti]on à leur avantage, de faire des feux de joye, de faire chanter le Te Deum, d’ appendre* dans les eglizes les drapeaux pris sur les ennemis ; au lieu que les confederez ont fait des rela[ti]ons hyperboliques presque en toutes les langues vivantes. Cela ne leur a point paru suffisant. Il a falu que les langues mortes fussent de la partie, et ils ont employé la latine pour porter jusques au bout du monde les nouvelles de leur valeur [10]. Je suis surpris que les Espagnols n’ayent pas fait composer par quelque rabin une gazette en hebreu afin de faire part de cette heureuse nouvelle aus sujets de leur maitre q[ui] sont dans son roy[aume] de Hierusalem [11]. Enfin on ne sauroit jamais dignement decrire combien la joye des confederez a eté turbulente, Ils ont envoyé des messagers expres dans les pays lointains avec des relations à leur poste*, on en a fait imprimer en une infinité de villes, on en a communiqué de manuscrittes, Ils ont repeté 2 mois de suitte qu’ils avoient vaincu ajoutant à chaque ordinaire*, quelque nouvelle circonstance, et quelque nouveau bonheur, co[mm]e pour insinuer à toute l’Europe que leur victoire avoit eté signalée par tant d’avantages memorables qu’il n’etoit pas possible de les decrire qu’à diverses reprises. Les magnificences de leurs feux de joye, et le nombre des lieux où ils en ont fait sont au delà de toute expression de sorte qu’il est fort probable que les cris de joye des Francois, ont eté etouffés par un si furieux tintamarre de tant de peuples et de langues differentes.
J’ay veu plusieurs personnes qui s’etonnoient que les Francois ayant des plus solides marques de la victoire que leurs ennemis[,] ayent fait pourtant moins eclater leur triomphe qu’eux. Ils ont pris 107 drapeaux ou etendards qui ont eté exposés à la veue de tout Paris, ils ont quantité de prisonniers, parmi lesquels il y a 3 ou 4 princes. Le general de l’armée d’Espagne est mort dans leur armée, des blesseures qu’il avoit receues au combat. Les confederez n’ont rien de si effectif que cela, neantmoins ils crient victoire bien plus haut. En voicy quelques raisons. P[remieremen]t ils sont composez de 3 nations dont chaqu’une pour le moins est aussi fanfaronne que la notre. On sait que l’Espagne est le pays des hableries et des fanfaronnades. Il n’est rien de plus fier que les Hollandois, rien de plus enteté pour sa nation que les Allemans. Jugés un peu quel effroyable fracas ne doivent pas faire ces 3 nations jointes ensemble pour proner leur gloire commune. De plus il seroit si honteux aus confederez si les troupes de 3 differentes nations se laissaien[t] batre par la 3me partie des troupes fra[n]coises (on sait q[ue] l’armée de Mr le p[rin]ce n’est que la 3 me de celles q[ue] le R[oi] a en campagne) [12] qu’il n’est rien qu’ils ne doivent faire pour persuader toute l’Europe qu’ils ont eu l’avantage[.] Il ne seroit pas si honteux à Mr le p[rin]ce de Condé q[ue] 3 grandes armées jointes ensemble lui eussent arraché la victoire, et dés là on voit que les ennemis ont plus de besoin de falsifier leurs relations que nous [13], et que supposé qu’ils eussent eté deffaits, il est fort probable qu’ils ne pourroient jamais se resoudre à se couvrir de la honte de l’avoüer. D’ailleurs les ennemis du Roy ont fait si peu de chose, dans toute cette guerre que c’est presq[ue] le premier feu de joye qu’ils ont peu prendre pretexte de faire, si bien qu’il ne faut pas s’etonner s’ils eclatent extraordinairement. Un bien qui s’est fait long tems attendre, qui a couté tant de peines et de sueurs, et qui a eté precedé de beaucoup de disgraces, se fait sentir d’une façon si vive, qu’il nous jette dans l’emportement et dans l’extase. Mais il n’en e[st] pas de meme ches nous, où on a veu tant de feux de joye depuis 3 ans qu’on en e[st] presq[ue] rebuté. On s’accoutume aus bons succez* comme à toutes les autres choses, et la nouvelle d’une victoire, de la prise d’une ville, est si familiere aus Francois, qu’ils ne s’en emeuvent pas autrement. Enfin le Roy a plus d’interet à vaincre ses ennemis qu’il n’en a à convaincre toute l’Europe de ses victoires. Il n’a deja que trop dechainé l’envie contre sa gloire. Sa bonne fortune, et sa valeur ne luy ont • deja suscité que trop d’ennemis, que savons nous s’il n’est pas plus expedient pour ses affaires que les etrangers s’imaginent qu’il n’est pas le plus fort, afin que cette croyance les empeche de se liguer avec ses ennemis, ou les oblige de se joindre avec luy pour faire la balance egale. C’est pourquoi il se contente de faire sentir à ses sujets qu’il est toujours le maitre de ses ennemis sans se soucier de le persuader à cor et à cri à toutes les puissances de l’Europe. Si on eut laissé les p[rin]ces d’Allemagne dans l’opinion où les gazetes d’Hollande et de Francfort les avoient mis touchant la bataille de Sintsheim [14], on ne verroit pas peut etre au deca du Rhyn cette prodigieuse armée q[ui] menace notre frontiere. Ces gazetes avoient si bien deguisé la verité, que toute l’Allemagne croyoit Mr de Turenne batu sans ressource, si bien qu’on ne jugeoit pas necessaire de se remuer • à son occasion, mais il a fait sentir par de si terribles et de si sanglantes marques, qu’il avoit eu la victoire, et il a si bien desabusé le public de la fausse idée qu’on avoit conceue de sa foiblesse que tous les p[rin]ces d’Allemagne le voyant ravager le Palatinat en veritable vainqueur [15], sont vitement accourus eteindre cet embrasement. Ce n’est pas toujours le meilleur d’agir selon toute l’etendue de ses forces. V[oir] lett[re] E. p.682 [16][.]
Il me semble Mr, qu’il y a long tems q[ue] vous avez envie de me faire une objection sur ce que j’ay dit que les gazetes sont cause que chaque parti pretend avoir eu le dessus. La veritable cause de cela me direz vous, c’est qu’il importe à un prince que ses sujets ne sachent pas ses disgraces, parce qu’il pourroit arriver que le voyant malheureux, ils perdroien[t] et la crainte et l’estime qui les tenoient dans l’obeissance. Je vo[us] accorde cela. J’avoue encore qu’il luy importe que les etrangers soient persuadez de la gloire de ses armes (excepté lors que cette gloire devenant trop formidable, peut donner occasion à• tous ses voisins de se liguer contre luy) parce que cette persuasion luy peut conserver ses alliez, qui pour l’ordinaire ne sont bien fidelles qu’à ceux qui sont favorisez de la fortune. Mais voicy Mr coment je concois que la gazette a part dans tout cecy. Je concois que si on ne faisoit aucune gazete la perte d’une bataille ne se repandroit pas facilement parmi le peuple, car encore que les victorieux publiassent leur triomphe, et fissent des feux de joye, la nouvelle n’en seroit pas portée dans le pays ennemy supposant comme j’aye fait que ce ne fut pas la coutume d’envoyer de[s] nouvelles par tout où vont les postes. Or comme ce n’est que pour abuser les peuples que les vaincus publient qu’ils ont eu l’avantage ; dés qu’il n’y auroit p[oin]t de danger que les peuples seussent de quel coté auroit tourné la victoire, on ne se mettroit pas en peine de faire imprimer une fausse relation, et cela ne seroit point suspe[c]t aux sujets du p[ri]nce vaincu, parce que sachant qu’on ne publie pas les divers succes de la guerre, il ne verroit rien de nouveau dans cette conduitte. Ainsi voila un article vuidé à saque*[colon] ceux qui auroient eté battus se tairoient. Ce silence des vaincus rabatroit bien le caquet des vainqueurs, car dés qu’ils verroient qu’on ne leur chicaneroit point leur avantage, ils ne s’amuseroient pas à des exagerations odieuses, ils n’insulteroient point à leurs ennemis par tant de traits de rhetorique que l’on mele aujourd huy dans les relations, enfin ils jouiroient de leur victoire sans outrager par des ecrits adroitement composez, ceux sur q[ui] ils l’auroien[t] remportée. Ce qui produiroit un bon effet car les vaincus en garderoient d’autant mieux le silence, et par là les peuples sauroient moins le vrai de la chose, qui est ce pour quoi on travaille en faisant cette prodigieuse multitude de gazetes contradictoires. Voila ce qui arriveroit supposé que la gazette fut abolye mais voicy ce q[ui] arrive dans la supposition contraire. P[remieremen]t les peuples sont si accoutumez à savoir toutes les grandes affaires qui se passent dans le monde, qu’il n’y a pas apparence de luy taire le succez d’une bataille. Si le gazetier n’en fournissoit pas une rela[ti]on dés là l’on jugeroit qu’elle auroit eté perdue, on se figureroit le mal plus grand qu’il ne seroit, on raisonneroit à tors et a travers si bien que c’est une necessité qu’on publie ce qui en est reussi*, soit q[ue] le succez* en ait eté favorable, soit qu’il ne l’ait pas eté•. C’est encore une necessité que la relation qu’on publie ne contienne que tous bons et heureux succez, quel sens y auroit il de publier soy meme ses disgraces, et d’apprendre aux peuples un malheur q[ue] la politiq[ue] veut qu’on leur cele ? et quel avantage ne donneroit on pas aus ennemis si on en usoit de la sorte ? Comme il est fort naturel de ne dire pas tout ce q[ui] tourne à notre honte, ils paroitroient tres bien fondez de conclure que la rela[ti]on ne contiendroit que la moindre partie du mal.
D[euxiememen]t de l’air dont j’ay deja remarqué qu’on compose la gazette dans chaq[ue] pays, asa[voir] afin de faire l’eloge du gouvernem[en]t il arrive que ceux q[ui] ont gagné une bataille ne se contentent pas de s’attribuer la victoire. Il faut de plus q[ue] le gazetier les loüe par tous les lieux communs de la rhetorique, et avec des exaggera[ti]ons si prodigieuses, qu’il ne demeure aus vaincus q[ue] l’honneur d’avoir bien fuy apres une longue resistance. Il faut qu’ils perdent leur canon leurs drapeaux leur bagage. Ce n’est pas assez, il faut qu’ils ayent eté bien retranchés, avantageusem[en]t postez, une riviere devant eux, le vent[,] le soleil par derriere, en plus grand nombre q[ue] leurs ennemis, et que malgré tous ces avantages, la valeur de ceux q[ui] les ont attaquez, les ait mis en deroute. Toutes ces observa[ti]ons amplifiées et deduites* le plus pompeusem[en]t* q[ue] l’on peut, souvent meme melée[s] de railleries piquantes exposent les vaincus à trop d’infamie, pour demeurer muets. Voila donc une seconde necessité à ceux q[ui] ont perdu une bataille, de se vanter qu’ils l’ont gagnée. Quand on est cocu dans un livre on en a jusques à la derniere posterité, disoit un heros de roman [17], disons aussi que quand on est decrié dans une gazette, on l’est jusques au bout du monde, c’est pourquoi les gen[eraux] d’armée n’ont garde de se mettre à la discretion d’un gazetier ennemy, ils font imprimer des rela[ti]ons à leur poste*, afin que du moins le jugem[en]t du public demeure suspendu entre les 2 gazettes.
Permettés moi Monsieur de remarquer en passant que les anciens Romains avoient bien meilleure foy qu’on n’en a aujourdhui. c.v. la lettre H, p.729 [18][.] C’est par eux que nous avons apris les belles actions d’ Hannibal, et les signalées victoires qu’il a remportées sur leur nation. Cornelius Nepos dans la vie d’Annibal dit tout le contraire.
V[oir] infr[a] f[olio] 31 [20]. On peut dire aussi des Romains que leurs rela[ti]ons etoient plus fideles, car y ayant une loy qui n’assignoit le triomphe qu’à celuy q[ui] avoit tué dans un seul combat 5 000 ho[mm]es,
Plutarque in V[ita] Fab[ii] Max[imi] [22] remarque q[ue] lors de la bataille de Trebia ni le general q[ui] en ecrivit, ni l’envoyé q[ui] en apporta la nouvelle, ne dirent la chose comme elle etoit. On feignit q[ue] l’avantage avoit eté egal de sorte q[ue] l’on ne savoit à Rome lequel des partis avoit eu du meilleur* ; mais apres la bataille du lac de Thrasimene, on y proceda de bonne foi et le peuple r[omai]n seut le malheur. Bien que ce grand cap[itai]ne [23] n’ait point eu d’historien de son party qui nous ait laissé sa vie ; nous ne laissons pas de voir tous les jours dans les histoires de ses ennemis, tous les maux qu’il a faits à la repub[lique] rom[aine] et les avantages considerables qu’il a eus sur leurs troupes. En un mot les Romains avoüent de bonne foy qu’il les a batus à dos et à ventre* dans 4 batailles consecutives.
Le lendem[ain] 28
Où est presentement cette bonne foy romaine ? n’est il pas vrai que s’il n’y avoit point d’historien en France, toutes les victoires du R[oi] demeureroient ensevelies dans un profond oubly ? Si ce grand p[rin]ce ne devoit attendre son immortalité que des histoires etrangeres, il n’auroit qu’à y renoncer dés à cette heure, car je ne concois pas qu’il y ait assés de sincerité parmi les ennemis ou les emules de notre mon[arque] (et sous ces 2 noms je comprens toute l’Eur[ope]) pour laisser publier des histoires où on le louat selon son merite. Vous le verrez Mr, tous les etrangers qui se meleront de l’histoire ou ne parleront qu’en gros des conquetes du R[oi] ou memes en ravaleront le prix autant qu’il leur sera possible par mille petites raisons frivoles[,] mais Dieu mercy le R[oi] se peut passer d’eux, et co[mm]e sans leurs secours il a fait des actions dignes d’etre consacrées à l’immortalité, aussi il les y fera consacrer sans leur entremise et il trouvera parmi ses sujets d’asses bonnes plumes pour le louer dignement, et pour confondre la malignité et la passion des histoires etrangeres. Apparemment on ne dira jamais des Francois que
Urgent[u]r […]
[…] carent quia vate Gallo [24]
Cepend[an]t c’est un desavantage considerable quand une na[ti]on n’est loüée q[ue] par elle meme, car si ses ennemis accusent ses historiens de flatterie, comment se justifier ? La presomption allant au plus grand nombre[,] si toutes les histoires etrangeres s’accordent à decrier la France, les Francois auront beau ecrire à la louange de leurs compatriotes, on ne prendra leurs histoires q[ue] p[ou]r de[s] fables. C’est pourquoi il est plus facheux* qu’on ne pense d’avoir afaire à des confederéz et à des ligues, car [n]o[n] seulem[en]t on se voit accablé d’une multitude d’ennemis mais aussi on perd le temoignage des historiens [n]o[n] suspects. Par exemple, cette conjura[ti]on q[ui] vient d’eclorre contre ce Roy nous ote toutes les plumes allemandes, q[ui] auroient pû etre desinteressées si la guerre n’eut eté qu’avec l’Espagne, et propres par ce moyen à decider les diferens qui naitront entre les historiens francois et espagnols. Nous serons obligez de recuser presq[ue] toute sorte d’histoires parce q[ue] la faction allemande entrainera tous les ecrivains septentrionaus[,] l’espagnole[,] les Italiens. De sorte q[ue] co[mm]e j’ai deja dit[,] il n’y aura de notre coté q[ue] des historiens de la na[ti]on ausquels les etrangers feront difficulté de s’en tenir [25].
Je me souviens que pend[an]t le dernier siege de Bezançon toutes les nouvelles qui venoient de la part des Francs Comtois etoient si desavantageuses aus assiegeans, que des personnes d’ailleurs mal intentionnées p[ou]r la France plaignoient notre R[oi] d’avoir si malheureusem[en]t commis sa reputation. Au dire de ces nouvelistes les travaux des assiegeans n’avancoient jamais de 10 pas que les sorties des assiegés ne les reculassent de 15 [26]. La disette etoit extreme dans le camp. Les bourgeois temoignoient un courage de lyon, ils battoient les Francois dans toutes les sorties qu’ils faisoient sur eux, on ne savoit où etoit le Roy, on conjecturoit seulem[en]t qu’il etoit retourné à Dijon voyant le mauvais etat du siege. Cepend[an]t il conste* q[ue] S[a] M[ajesté] a pris part à toutes les fatigues du siege et a visité chaq[ue] jour tous les postes de son armée. Mais qu’arriva t’il, c’est que 2 jours apres toutes ces belles relations, on apprit q[ue] Bezançon avoit capitulé [27]. Ce qui convainc les Franscomtois ou de mauvaise foy en ce qu’ils n’ont pas confessé que le siege s’avançoit de jour en jour, ou de coyonnerie* en ce qu’ils se sont laissé forcer dans si peu de tems, car il ne faut mettre en ligne de comte que le tems où les ennemis ont gagné du terrein. Il me semble que je voi où estoit leur mal, pendant qu’ils ont peu cacher les progres des assiegeans, ils l’ont fait. S’ils avoient peu aussi bien derober à la connoissance publique la reddition de la place, ils ne l’auroient pas avoüée. Mais ce sont de faits trop eclatans pour oser les nier.
Je dirai encore une chose que ma memoire me fournit, c’est q[ue] pend[an]t le siege de Candie [28] toutes les nouvelles qu’on en publioit nous apprenoit [29] les meilleurs succez du monde, que les maladies, et les longueurs du siege desoloient l’armée des Turcs, qu’ils etoient repousséz dans tous les assauts, qu’on faisoit joüer contre eux des mines dont l’effet etoit admirable*, qu’on eventoit toutes les leurs, que les sorties des assiegez ruinoient tous leurs travaux et ainsi du reste. Cependant il falut avoüer enfin qu’ils s’etoient rendus maitres de la place. Dés lors je pris en detestation les gazetes, car disois je en moi meme[colon] N’est ce pas se moquer de la credulité du monde de publier que les Chretiens rendent inutiles tous les efforts des Turcs, et neantmoins les Turcs prenent la ville qu’ils assiegeoient, Il faut de necessité qu’on nous cache les progrés des infidelles puis qu’il n’est pas possible qu’ils reduisent une forte place à capituler sans avoir occupé tous les dehors. D’où vient donc qu’on n’a jamais mis dans la gazete qu’ils s’etoient emparez de tel ou de tel bastion ? C’est faire co[mm]e si en regardant joüer on tenoit seulem[en]t conte des coups de perte ; il se trouveroit par une telle supputa[ti]on q[ue] celui q[ui] auroit le plus gagné, auroit fait des pertes considerables. Mr Fouquet tome I de la Suitte de ses deffens[es], se sert de cette pensée à l’occasion de ceux qui ne mettoient en ligne de conte q[ue] ses depenses, et non ses receptes [30].
Il n’est rien qu’un gazetier doive plus craindre qu’un siege, de quelq[ue] parti qu’il soit. Si la place est prise le gazetier des assiegeans se tire d’affaire, parce que tous les grans succez qu’il a publiez de jour en jour deviennent vraisemblables par la reduction de la place, mais l’autre gazetier ne peut qu’etre couvert de confusion, et exposé à la risée publique, parce qu’il a hardim[en]t asseuré selon le deu de sa charge, que les assiegéz faisoient des merveilles, et rendoient tous les efforts des ennemis inutiles. Mais si on est contraint de lever le siege ; la medaille se tourne, car alors Mr le gazetier des assiegeans est à quia* ; Il avoit dit comme de raison q[ue] les attaques reussissoient à miracle, qu’on etoit maitre de la demy lune*, du bastion ainsi nommé, qu’on alloit attacher le mineur*, que les batteries, et les bombes foudroioient la ville, mais la levée du siege dement tout cela d’une façon q[ui] ne souffre point de replique. Vous me direz qu’il n’a qu’à dire co[mm]e les choses se passent. Bagatelles. Il a son stile reglé po[ur] les sieges et po[ur] les batailles, et sans attendre les nouvelles des lieux dont il faudra parler, il sait bien ce qu’il faut qu’il en dise, il se gouverne par formulaire co[mm]e les procureurs [31], et il suppose que les assiegés de son party gardent bien la contrescarpe et font de vigoureuses sorties, et que les assiegeans aussi de son party s’emparent de tous les dehors, et font une breche raisonnable [32]. C’est ainsi qu’on taille les morceaux aux gazetiers. C’est pourquoi ils aiment toujours mieux qu’on fasse la guerre par des batailles rangées, q[ue] par des sieges. Quand on donne des batailles ils taillent en plain drap, ils employent hardiment toutes leurs phrases et tous leurs termes sans craindre d’etre convaincus de fausseté. Mais la prise d’une ville, ou la levée d’un siege etant des faits de notorieté publique, il n’y a pas moyen de les revoquer en doutte. Il faut parler francois necessairem[en]t.
Sur quoi Mr je vous dirai la plaisante imagina[ti]on d’un ho[mm]e de ma connoissance. On s’etonnoit un jour de ce que presentement on s’attachoit si fort aus sieges, et point du tout aus batailles. Voulez vous savoir, dit il[,] la raison de cela[?] C’est que la prise d’une ville est un gage si asseuré de la victoire, qu’il n’y a ni mauvaise foy, ni chicane, ni illusion des ennemis qui puisse tenir contre. En montrant que vous avés garnison dans la place vous refutés invinciblement toutes leurs fausses relations, au lieu que quand vous gagnez une bataille, vous n’avez souvent à opposer que des paroles à l’impertinence de ceux que vous avez battus, qui souvent se glorifient plus hautem[en]t de la victoire que le vainqueur. Ainsi[,] poursuivit il[,] n’attendez pas qu’on donne de batailles rangées à moins que d’avoir des juges desinteressez pour temoigner du succez de la journée et pour en donner le prix à qui le • meritera. Je ne sai meme[,] ajouta t’il[,] si q[uan]d on trouveroit de tels juges, on arreteroit l’effronterie et la sotte vanité des parti vaincu, car du tems que les ministres et les pretres disputoient* en conference reglée, bien qu’il y eut des commissaires pour juger des coups, et des secretaires p[ou]r ecrire tout ce q[ue] les disputans alleguoient l’un contre l’autre, on ne laissoit pas de voir des imprimez, où chacun s’attribuoit la gloire d’avoir confondu son antagoniste, et c’a eté une de[s] principales raisons qui ont fait cesser cette sorte de disputes [33]*. Il ne faut donc pas s’etonner (concluoit il) si pour une semblable raiso[n] on aime mieux prendre des villes que se battre en rase campagne, car quand on tueroit 20 000 Espagnols et autant de Hollandois, ils ne laisseront pas de faire courir des gazetes et des rela[ti]ons par toute l’Europe où ils trancheroient* des victorieux avec toute la fierté imaginable.
Je le dis encore un coup.* On ne sauroit asses blamer l’institution de la gazete de la façon qu’on la compose presentement. C’est le fleau et la peste de l’histoire [34]. Car ceux qui en voudront composer une d’icy à cent ans s’imagineront que pour y proceder en bonne conscience il faudra consulter les autheurs contemporains, comme ceux qui ont eu le plus de facilité pour s’instruire du vrai de la chose [35]. Mais que sont, je vous prie[,] les autheurs contemporains, sinon des rapsodeurs et des compilateurs de la gazete, ou bien y a t’il un honnete ho[mm]e soit en Hollande soit en France, qui voulut presentem[en]t se hazarder* d’ecrire du combat de Senef [36] autrem[en]t qu’ont fait les gazetes ?
Ainsi Mons[ieu]r la posterité ne sauroit avoir qu’une histoire fabuleuse, puis qu’elle sera ecritte sur de si mechans memoires. Si en cela la posterité est à plaindre, je vous asseure q[ue] nous ne le sommes gueres moins, car quelle certitude avons nous de plus, nous qui voyons chaque party narrer les circonstances d’un combat d’une maniere toute differente. Dois je ajouter plus de foy aus rela[ti]ons allemandes qu’aux francoises ; je le ferai mais c’est quand on m’aura bien convaincu qu’en Allemagne on ecrit sans aucune preoccupation*. L’entreprise ne seroit pas petite. P[ou]r oter les esprits de l’incertitude il faudroit qu’à la fin de la guerre les plenipotentiaires de tous les partis fissent imprimer une veritable rela[ti]on de tout ce qui se seroit passé, et donnassent leur declara[ti]on en bonne et deüe forme, comme ils tomboient d’accord de toutes choses y contenues, sans avoir egard à aucunes gazetes, ou histoires anterieures ausquelles par leur acte il seroit pleinement derogé sinon en ce qu’elles auroient de conforme à la rela[ti]on. Il faudroit faire l’échange des ratifica[ti]ons de cette relation, [n]o[n] moins q[ue] du traitté de paix, en remettre l’original scellé du seau des potentats interesséz, et signé de leur main, entre les mains d’un p[rin]ce non partial, et en fournir des copies fidellement collationnées au susd[i]t original en presence de tous les plenipotentiaires, •à tous les souverains qui auroient eté mediateurs de la paix, ou compris dans le traitté. Moyennant ces precautions il me semble qu’on mettroit à couvert l’histoire, de la contagion de tant de flateries et de tant de fables dont les gazetes sont remplies [38].
Au reste Mr ce q[ue] j’ay dit à la loüange de la sincerité romaine ne doit pas vous faire penser que je me dedis de mes anciennes maximes, et que je suis un transfuge qui me range parmi les loueurs eternels de l’Antiquité. Ce n’est pas cela Mr, je crois fermement qu’on etoit aussi corrompu dans le siecle d’ Hannibal q[ue] dans le notre [39]. Mais voici ma pensée, c’est que chaq[ue] siecle ayant po[ur] ainsi dire un vice favori et dominant, ou plutot en ayant plusieurs qui tiennent le haut bout, chacun dans un certain ordre d’hommes ; celui qui dominoit parmi les Romains du tems de la 2 e guerre punique n’etoit pas une fierté • à nier impudemment toutes les veritez desavantageuses. • Quel que fut le peché regnant de ce tems là ; il restoit assez de bonne foi dans Rome po[ur] demeurer d’accord q[ue] les Carthaginois batoient les Romains. C’est presentem[en]t qu’est venu le tour de cette demesurée fierté c’est presentement qu’il y a un certain esprit d’envie et d’orgueil qui preside dans les conseils de plusieurs peuples, lequel non seulem[en]t ne souffre point qu’on se plaigne des coups qu’on a receu[s] mais qui oblige meme ceux qui ont eté batus jusques au sang de s’applaudir d’un triomphe imaginaire, et de le faire savoir à tous peuples, nations et langues.
Le dimanche 30 sept[embre]
Mais c’est trop insister sur le chapitre de la gazete, et je ne me souviens pas que je me suis proposé de donner un air de conversation à cet ecrit. Pour cela il me faut souvent changer de theme, car on sait bien q[ue] dans les conversa[ti]ons on passe continuellement d’un sujet à un autre, et c’est ce qui en fait le principal agrément. Il n’en va pas comme des disputes* de l’Ecole, où ceux qui attaquent toutes les theses l’une apres l’autre, et changent de medium* [40] •à chaq[ue] reponse qu’on leur fait sont insupportables à m[essieu]rs les docteurs, bacheliers, licenciez et autres pretendans au bonnet et à la robe doctorale. Un pauvre maitre es arts enrage de tout son cœur quand il entend disputer* si pitoyablem[en]t, parce qu’il n’apprend rien de nouveau dans une dispute si voltigeante. Trois ou 4 syllogismes ne sont pas son fait, il en feroit bien autant sans prepara[ti]on. Il attend qu’un homme vienne à la maitresse difficulté, et qu’il renverse tous les retranchemens q[ui] la deffendent. Et pour son malheur il voit que Mr l’argumentant se retire avant que de l’avoir seulement envisagée. Ce seroit pour faire dechirer son bonnet à un docteur espagnol, car dans leurs universitez il faut pouvoir disputer 10 heures de suitte sans changer de medium. Mais graces à la liberté francoise, nos docteurs ne sont pas si rigides, et ils ne se battent pas en desesperéz comme ceux qui s’enferment dans une cuve le poignard à la main, Ils donnent et ils prennent la liberté de reculer et d’aller chercher de nouvelles armes, lors q[ue] les premieres sont emoussées. Neantmoins co[mm]e je l’ay deja dit, ceux qui se servent de ce privilege sans garder quelque mesure courent risque de n’acquerir aucun los*, ou meme d’etre traittez de ridicules. Et pour revenir à mon point, ils font aussi mal, q[ue] ceux qui dans la conversa[ti]on ne se servent pas de la liberté q[ui] y regne de faire tourner le discours tantot d’un coté tantot de l’autre. Je profiterai desormais de cette pensée.
Il y a quelque tems que je me trouvai dans une compagnie où l’on parloit de Luther et de Calvin un peu moins respectueusem[en]t qu’on ne fait à Geneve. Ils ont usurpé, disoit l’un, une charge qui demandoit bien d’autres gens, et ce n’etoit point l’affaire d’un petit compagnon, que de refformer l’Eglize, encore, disoit un autre, pourroit on les excuser s’ils avoient procedé selon les formes [41]. Vous en parlez bien à votre aise leur dis je Mess[ieur]s, et il me semble que j’entens ces medecins de la comedie qui disent qu’il vaut mieux qu’un malade meure selon les formes, q[ue] s’il guerissoit contre les regles de la faculté [42]. L’Eglize etoit en un tel etat qu’elle avoit besoin d’un promt remede, et qui eut* voulu s’amuser à une scrupuleuse observa[ti]on des moindres formalitez, c’etoit joüer à verifier le proverbe, apres la mort le medecin. Dans une maladie desesperée, on est en droit de tout essayer, sans consulter si le remede vient de la part d’un docteur, et si c’est la coutume d’en user de la sorte. On a veu plusieurs malades abandonnéz des medecins, recouvrer leur santé par des remedes q[ue] le 1er venu s’offroit de <bj 2>8fleur preparer à tout hazard. Il n’est pas jusqu’aux medecins, si grands formalistes d’ailleurs qui n’abandonnent leur pont aus anes*, et leur methode journaliere, lors q[ue] le malade court risq[ue] de la vie,
Cicer[o],
in tranquillo tempestatem adversam optare dementis est : subvenire a[utem] tempestati quavis ra[ti]o[ne] sapientis, eoque magis si plus adipiscare re explicata boni, q[ua]m addubitata mali [46]. En un mot on ne sauroit travailler sous de meilleurs auspices q[ue] lors qu’on agit p[ou]r le salut public. Ciceron in Cat[one] Maj[ore] louë Q. Fabius Maximus
Il dit au 3. Des off[ices] q[ue]
et que
Quelqu’un a dit fort sagem[en]t :
V[oir] Naudé, Consider[ations] sur les coups d’etat [50] .
Je vous demande, si le gouverneur d’une ville de guerre amenoit la garnison aux ennemis, si cette ville etoit assiegée en meme tems ; les bourgeois n’auroient ils pas le droit de se creer un gouverneur. Pourroit on les blamer de cette conduite[?] Je ne le pense pas, cepend[an]t c’est contre les formes, parce que po[ur] agir selon les formes il faudroit q[ue] le souverain nommat un gouv[erneur] il faudroit q[ue] ce gouv[erneur] s’en vint dans la ville avec les ordres necessaires ; il faudroit qu’on luy fit une entrée magnifiq[ue] qu’on luy remit les clefs de la place, et qu’il se mit en possession de son gouvernement.
Le 5 octo[bre]
En un mot Mess[ieu]rs vous trouvez etrange q[ue] Luther et Calvin n’ayent pas voulu gober le boucon*. Vous leur faites un crime de ce qu’ils n’ont pas voulu boire à longs traits d’un breuvage empoisonné. Vous vous ecriez co[mm]e cet emp[ereur] rom[ain] [51] Quoi[!] prendre des antidotes contre l’Eglize romaine ? Cepend[an]t il n’y a rien de plus naturel q[ue] cela. Nous rejettons tous ce q[ue] no[us] croions nous etre contraire, et personne ne s’en formalise ; et personne ne pretend qu’il faille etre authorisé du souverain po[ur] faire cette rejection*. Par quel droit pouvez vous donc dire q[ue] ce n’etoit pas à de petits compagnons de rejetter un culte idolatre[?] Ils me repartirent à cela plusieurs choses qui n’etoient pas toutes à propos, et puis la conversation porta sur de[s] matieres differentes, comme c’est la coutume, mais je les avertis auparavant q[ue] tout mon discours n’etoit q[ue] le fameux
Je croi Mr que vous serez pour ce dernier trait, beaucoup mieux que po[ur] tout le reste parce qu’effectivem[en]t mes raisons ne sont pas tant* solides, co[mm]e* elles etoient proportionnées au lieu et au tems et aux p[e]r[sonn]es avec qui je disputois, de sorte q[ue] pour remplir le vuide de mes reponses cavalieres il etoit à propos de faire comprendre à ces grans formalistes, que cela meme où il faisoit consister le venin, ne se rencontroit point dans la conduitte de nos reformateurs, puis que nous pretendons qu’il nous seroit facile de justifier qu’ils ont procedé selon les formes. Le mieux est ce me semble de s’en tenir là ; car supposé que notre • capital* soit de prouver que nous avons repurgé l’Eglize des erreurs mortelles qui la travailloient ; c’est à nous à fortifier ce poste du mieux qu’il nous sera possible. Or pour le bien deffendre contre les attaques des ennemis, il faut avoir des dehors, et les garder à toute extremité ; il ne leur faut ceder aucun pouce de terrain, Il faut que la contrescarpe, qu’un ouvrage à corne, qu’un ravelin, une demy lune ou un bastion [53] epuisent toutes leurs forces, et alors la citadelle sera parfaitem[en]t en seureté. Cela veut dire qu’il ne faut pas accorder à m[essieu]rs de l’Egl[ise] rom[aine] que la procedure de nos reformateurs n’ait pas eté selon les formes, car ce seroit leur abandonner les dehors de notre place. Il ne faut pas non plus leur passer q[ue] l’inobserva[ti]on des formalitez soit une nullité à la reforma[ti]on de l’Eglize, c’est encore comme un ouvrage à corne* dont il ne faut pas les laisser emparer. En un mot il y a plusieurs questions moins principales dans lesquelles nous devons garder tres exactement tout notre droit, parce q[ue] c’est fermer d’autant à nos adversaires les approches de notre principale forteresse. La dispute se doit traitter à la maniere des joüeurs ordinaires, qui ne hazardent q[ue] l’argent qu’ils se trouvent dans leur bourse, et non à la maniere des joüeurs, qui au rapport d’un ancien poete, faisoient apporter leurs coffres dans le brelan*
Ad casum tabulæ ; positâ sed ludit[u]r arcâ
Ce n’est pas q[ue] quelquefois je ne voulusse relacher de cette rigueur, et accorder aus adversaires de se loger tout d’un coup pres des murailles, il ne faut pas toujours se traitter comme de Turc à Maure* ; mais ce seroit seulem[en]t pour essayer s’ils savent bien pousser leur pointe*, et je prendrois bien mes precautions pour les pouvoir faire retirer, en cas qu’ils me pressassent trop vivement. Et pour me servir encore d’une comparaison tirée du jeu, je fairois une reserve semblable à celle q[ue] les joüeurs de paume font souvent. S’ils offrent à quelqu’un de joüer contre luy avec un batoir [55], ils se reservent le droit de jouer avec la raquette meme en cas q[ue] la partie ne soit pas tenable autrement. C’est ainsi que j’en aurois usé, Mr, avec ces grans protecteurs des formalitez, desquels je vous parlois nagueres, car s’ils eussent eté plus forts que moi sur le chapitre de la necessité d’observer les formes ; j’aurois fait valoir mes p[remi]eres pretentions, qui sont q[ue] nos peres ont refformé l’Eglize en bonne et deüe forme. Mais il ne fut pas besoin d’en venir là.
Le samedy 6 oct[obre]
Si ces Mrs eussent eté espagnols, la dispute ne se seroit pas si tot terminée, car vous savez Mr qu’ils sont diablement opiniatres à ergotiser*. Comme je l’ay deja dit, quiconque pretend à l’estime de bon disputeur parmi eux, doit pousser un meme argument des 10 et 12 heures de suitte. Il s’est trouvé des opposans •à Salamanque que toute l’authorité du recteur de l’Université n’a peu faire taire, et qui aimoient mieux etre degradez des lettres, pour crime de desobeissance q[ue] de ne disputer pas tout leur sou*, à peu pres co[mm]e cette servante du Bourgeois gentilh[omme] qui consent d’etre battue pourveu qu’on la laisse rire autant qu’elle voudra [56]. J’ay ouy dire qu’on a eté• diverses fois sur le point de demander que la regle des 24 heures, si celebre parmi les faiseurs des comedies [57], fut receuë dans les universitez d’Espagne en forme de loy, pour etre la mesure des disputes publiques ; Si quelq[ue] chose a fait obstacle à ce dessein c’a eté sans doutte la considera[ti]on de celuy qui soutiendroit des theses, po[ur] qui on a justem[en]t apprehendé, qu’il ne succombat à une si longue courvée*, car po[ur] l’aggresseur on sait bien qu’il ne demanderoit pas mieux que d’avoir un jour et une nuit à son commandem[en]t. En quoi l’on voit une tres grande difference entre le genie des soldats espagnols, et celuy des docteurs de la meme nation. Ceux là sont incomparables dans une ville assiegée, et tres mediocres dans une attaque ; c’est le contraire de ceux cy ; Cependant il y a plus à gagner po[ur] un soldat qui fait merveilles dans un assaut, que pour un docteur qui impugne vigoureusem[en]t une these, car le plus souvent s’il vous prenoit envie de demander, ce docteur qui crie et qui se debat si fort, quel sujet a t’il de se mettre tant en colere ? Mr vous repondroit on, c’est po[ur] un p[oin]t le plus scientifiq[ue]* de l’Ecole.
Si par hazard la dispute ne portoit pas sur l’une ou l’autre de ces 2 questions, ce seroit au moins sur quelq[ue] sujet de semblable importance ; peut etre sur quelqu’un des problemes q[ue] l’ingenieux Rabelais a mis en avant p[ou]r se moquer de la pedanterie de l’Ecole. Voicy co[mm]e chante le p[remi]er Utrum une idée platoniq[ue] voltigeant dextrement* sur l’orifice du chaos pourroit debeller* les escadrons des atomes democritiques [59]. Trouvéz vous pas Mr que c’est se donner de la peine bien inutilem[en]t, et q[ue] le profit q[ui] en peut venir ne vaut pas le moindre cri et la moindre contorsion de corps q[ui] se fait dans une dispute. Mais ces m[essieu]rs n’en jugent pas de la sorte, et ils sont de l’humeur de ce Romain qui sur la question quel chemin etoit le meilleur p[ou]r aller à Brindes, ou celuy d’Appius ou celuy de Numicus, n’auroit pas demordu de son opinion, po[ur] une 2. vie. Ecoutons parler Horace là dessus
Propugnat, nugis armatus : Scilicet utnon
Sit mihi p[rim]a fides, et verè q[uo]d placet, ut non
Acriter elatrem, prætium ætas altera sordet.
Ambigit[u]r quid [e]n[im] ? Castor sciat an Docilis plus
Brundusium Minuci melius via ducat an Appi.
Au fonds je pourrois bien m’etre trompé q[uan]d j’ay dit qu’il y avoit plus à gagner p[ou]r un soldat q[ui] grimpe hardim[en]t sur un bastion q[ue] p[ou]r un docteur qui dispute à toute outrance, car il y en a plus de 4 à qui la profonde connoissance des chicaneries de l’Echole, a valu un bon benefice, voire meme le chapeau de cardinal. Combien y en a t’il dont toute la science s’occupe à bien embrouiller la matiere des universaux et du continu (j’ay ouy parler d’un jesuite qui avoit medité 1 000 heures de conte fait sur la divisibilité à l’infini du moindre grain de poussiere) et qui ne laissent pas de faire bonne chere, tandis que des beaus esprits, ennemis de la pedanterie, et remplis de politesse jusques aus dents
Courent de toutes parts crottez jusqu’à l’echine,
Pour mendier leur pain de cuisine en cuisine
Et n’ont le plus souvent que les os et la peau [61].
Il y a bien de[s] gens qui ont parlé de la misere des beaux esprits, sur tout des poetes. Voici ce qu’en dit Regnier en sa Sat[ire] 2
C’est que la pauvreté comme moi les affole
Et que la grace à Dieu, Phœbus et son troupeau,
Nous n’eumes sur le dos jamais un bon manteau
Aussi lorsque l’on voit un homme par la rue
Dont le rabat est sale et la chausse ro[m]pue
Ses gregues aux genoux, au coude son pourpoint
Qui soit de pauvre mine, et qui soit mal en point
Sans demander son no[m] on le peut reconoitre
Car si ce n’est un poete, au moins il le veut etre [62].
Il faut donc pour accorder mes paroles ensemble q[ue] je dise qu’il y a plus à gagner po[ur] un soldat, qui monte bravem[en]t à la breche, q[ue] po[ur] un docteur qui bat en ruine un soutenant, non pas si l’on a egard aux recompenses q[ue] l’un et l’autre se peut promettre (de cette façon il y auroit du meconte p[ou]r le soldat la plus part du tems) mais si l’on regarde la chose meme q[ui] est en question ; car le soldat combat p[ou]r une ville qui est une chose reelle, au lieu q[ue] le docteur dispute p[ou]r un etre de raison qui n’est à proprem[en]t parler qu’une imagina[ti]on creuse et puerile.
Mais voyez un peu Mr, co[mm]e toutes choses changent. Rabelais ne fit l’histoire de son Pantagruel q[ue] p[ou]r dedommager son libraire q[ui] s’etoit ruiné à faire imprimer un tres beau commentaire sur Hyppocr[ate] (v[oir] lett[re] F, p.700) [63] de la façon de Rabelais, qui n’avoit eu nul debit [64]. Et moi j’ay cognu un libraire à Thoulouse q[ui] ayant fait de notables pertes en faisant imprimer des livres de galanterie fit un gain immense par l’impression d’un livre où les questions de l’Ecole etoient poussées au plus haut point d’abstraction où elles puissent monter. On y donnoit de nouvelles idées de l’etre in communi [65] qui etoient d’un usage merveilleux p[ou]r demontrer que la matiere p[remi]ere depend de la forme quant à son existence, bien qu’elle soit le sujet d’eduction [66] de lad[i]te forme. Du commencem[en]t ce livre (l’autheur e[st] le P[ere] Reginald jacobin [67]) ne se vendoit guere, mais co[mm]e l’interet nous ouvre les yeux l’imprimeur s’avisa d’en envoyer quelques exemplaires en Espagne. Dés qu’ils parurent, on regarda ce livre comme un miracle de l’art, l’imprimeur n’en pouvoit plus faire tenir autant qu’on en vouloit, et il y avoit combat en Espagne à qui l’acheteroit le p[remi]er tant y a qu’en •2 ou 3 mois il s’en debita 4 000 exemplaires. Pour moi je crois fermem[en]t qu’il y a une etoile qui preside à la naissa[n]ce de tous les livres, et q[ui] e[st] la veritable cause du bon ou du mauvais succez qu’ils ont, selon la diversité de ses aspects*. Car si d’un coté les livres plaisans ont enrichy le libraire de Rabelais qu’u[n] ouvrage serieux et docte avoit appauvri[,] de l’autre un livre de la plus guindée* et de la plus abstraite metaphysiq[ue] a fait remonter sur sa bete* le libraire de Tholoze, que des pieces galantes avoient fort incommodé. Quand le libraire du P[ere] Theophile Raynaud se plaignoit à luy q[ue] ses livres n’avoient point de cours, Je sai ce qu’il faut au public, luy repondoit le pere, il luy faut des livres bouffons. Il est indigne q[ue] je luy fasse part de mes ouvrages, si c’etoient des sottises, vous les debiteriez fort facilement [68]. Ouy mais je demande, le livre qui a tant fait gagner le libraire de Tholoze, n’etoit il pas semblable quant à la matiere à ceux du P[ere] Raynaud, (le P[ere] Reginald et le P[ere] Raynaud etoient 2 scholastiques fieffés) pour la forme, il e[st] sans doutte q[ue] ceux du jesuite l’emportoient sur ceux du jacobin. Cependant celuy ci enrichit son libraire, l’autre le met à l’hopital. N’est ce pas un caprice de l’etoile ? Je sai qu’on pourroit donner plusieurs raisons de cette difference de succez, tirées de la diversité du tems, des lieux, et des personnes, mais qu’importe je ne me dedirai pas p[ou]r le present.
Le mardy 9 oct[obre]
On a raison de se plaindre q[ue] l’ho[mm]e ne fait rien moins que ce où il devroit s’attacher principalem[en]t. Les phi[loso]phes sont coupables de cette faute, aussi bien q[ue] le vulgaire, ils donnent le meilleur de leur tems à la logique et à la metaphysiq[ue] et laissent à l’abandon la morale qui devroit etre le principal sujet de leurs etudes. Ce n’est pas qu’il ne se trouve quantité de livres de morale, mais ce que je viens de dire c’est ay[ant] egard à la pratique des colleges et des universitez. Un professeur ne met guere plus d’un mois à dicter son traitté de morale, au lieu qu’il en employe •7 ou huit, à la logique. Mais ce n’est pas là le grand mal, ce qu’il y a de plus blamable, c’est qu’au lieu de traitter de l’excellence de la vertu, et de la necessité de l’aquerir, on ne fait q[ue] disputer sur sa nature, et sur sa definition. Aussi n’a t’on jamais veu qu’un ecolier ait profité quelq[ue] chose po[ur] ses mœurs, par ce qu’on luy peut avoir dicté de morale dans son cours de phi[loso]phie. Vous me direz Mr q[ue] les professeurs laissent à d’autres le soin de rectifier notre volonté, et qu’ils se contentent de cultiver notre entendem[en]t, mais je les trouve en cela peu dignes d’excuse, car ou il faut renoncer au titre de phi[loso]phe, ou il en faut bien remplir les devoirs les plus essentiels q[ui] sont sans doutte* de nous rendre sages et vertueux. Je ne sai si la crainte que les phi[loso]phes ont euë, de ne p[oin]t reussir à imprimer l’amour de la vertu dans l’ame de leurs echoliers, leur a fait abandonner cette partie de la philosophie, mais une chose sai je bien c’est que cette crainte ne seroit pas sans fondement, car qu’a t’on gagné par tant de volumes et par tant de predica[ti]ons où l’on a excité les hommes à la vertu ?
Le 13 oct[obre]
N’a t’on pas employé inutilem[en]t et les exhorta[ti]ons serieuses de la morale et les remontrances enjouées de la satyre et de la comedie ? On n’a presq[ue] rien oublié, on a tourné la chose de tous les cotez, cepend[an]t le monde va toujours son train, et la vertu e[st] toujours regardée co[mm]e un beau sujet de declama[ti]on, et rien davantage. Voila de quoi faire enrager ceux qui employent tant de soins et tant de veilles à ecrire de la vertu, mais co[mm]e la pluspart se proposent de faire admirer leur esprit et leur eloquence, plutot q[ue] de reformer le monde, pourveu qu’on leur accorde le premier ils se consolent facilement de n’obtenir pas le reste. De verité Mr pensez vous q[ue] les autheurs qui traittent si gravement de la morale, ayent bien à cœur la reforma[ti]on des mœurs ? Je n’y vois pas grande apparence, car si cette reforma[ti]on leur touchoit si fort au vif, ils la commenceroient par eux memes ; et ils nous donneroient un bel exemple de la perfection où ils nous invitent. Ils ne font rien moins q[ue] cela, et ceux qui les observent de pres, ne manquent pas de reconnoitre qu’ils sont hommes aussi bien q[ue] nous et qu’ils ne different des autres qu’au langage. En effet ils parlent de la vertu sur le ton affirmatif, et avec les termes du monde les plus magnifiques, au lieu q[ue] les autres confessent de bonne foy que le vice a pour eus des charmes* qu’ils ne sauroient parer [69][.] Je suis du sentiment de Juvenal qui prefere un debauch[é] paroissant ce qu’il est, à un coquin de Tartuffe [70].
Imputo, qui vultu morbum incessuque fatet[u]r
Horum simplicitas miserabilis, his furor ipse
Dat veniam : Sed peiores qui talia verbis
Herculis invadunt, Et de virtute locuti
[C]lunem agitant. Ego te ceventem, Sexte verebor ?
Satyr[arum] 21 [71]. v. marg. pag. praec. •
Extat egregius locus apud Gellium l.13, c.8 (citante Briosio in episto[lis]) Versus Afrani s[un]t in togata, cui Sellæ nomen e[st] :
Et Pacuvius
Quæ s[un]t inter cutem et carnem, aquæ intercutes dicunt[ur] ; p[er] allusione[m] a[utem] vitia, quæ non foris apparent, sed penitus s[un]t imbibita intercutia no[m]i[n]at. V[ide] phr[ases] pr[osaicas] p.281 et phr[ases] po[eticas] p.25 [72]
Le Lacedemonien Panthoïdas se promenant avec des Atheniens dans le fauxbourg de l’Academie q[ui] l’obligeoient d’ecouter les p[ro]fonds raisonnem[ens] et les grands traits de morale de quelques phi[loso]phes, co[mm]e* on lui eut demandé ce qu’il pensoit de ces graves instructions, Elles sont admirables, repliqua t’il, mais au reste inutiles parce q[ue] vous n’en faites rien. Laced[emone] anc[ienne] et nouv[elle] [73] , p.515 [74]
Il a eté bien dit
Luy encore
Il confesse luy meme l.
Ne dica[m] insup[er] Coniura[ti]o[n]is Pisonianæ in Neronem socium fuisse et Imperii (si Neronem 1 o per Pisonem, mox Pisonem ipsum occidi curasset) p[er] cædes futuru[m] invasorem. Si eidem Tacito credimus Ann[alium] l.14 c.7 l.15 c.56 et 65 [81] et Dion[is] l.62 [12-13] apud Xiphilinum [82]. Meibomius in vita Mæcenat[is] c.22 [83].
La maniere dont Seneq[ue] se deffend me fait souvenir de Paris repondant aus reproches d’Hector v[oir]
Ciceron Tuscul[anæ] [87]
Ceux q[ui] ecrivent tant de belles choses pour la vertu et contre le vi ce, et vivent neantmoins d’une maniere dereglée, font le plus grand prejudice du monde aus bonnes mœurs, car non seulement on se moque de leurs preceptes, par la raison qu’ils viennent d’un maitre qui en a autant de besoin q[ue] les autres, mais aussi on s’imagine qu’il est impossible de vivre vertueusement et q[ue] la vertu n’est qu’une chymere, puis que ceux qui philosophent continuellem[en]t sur sa nature et sur ses proprietez, n’en deviennent pas meilleurs. Or dés le moment qu’on se figure une chose impossible, on cesse de songer à l’aquerir, car on ne travaille qu’à p[ro]p[or]tion qu’on espere. Je viens peut etre de marquer la p[rin]cipale cause de l’inutilité de tant de livres de morale, mais il y en a plusieurs autres qui concourent avec celle là ; Ce seroit entreprendre une trop longue carriere que de vouloir les eplucher toutes. Je me contenterai d’en toucher une q[ui] me vient tout presentement dans l’esprit. C’est q[ue] ces mes[sieur]s qui font profession de faire la guerre au vice se servent souvent de raisonnemens faux ; et les font valoir co[mm]e des demonstra[ti]ons incontestables, par exemple, lors qu’ils declament contre la haine du prochain, ils croyent que p[ou]r confondre un vindicatif, il ne faut q[ue] l’ameiner à l’ecole des betes, et luy faire remarquer q[ue] les animaux qu’on nomme deraisonnables ont plus de raison q[ue] l’ho[mm]e, puis qu’à tout le moins ils epargnent leur semblable, ce q[ue] l’ho[mm]e ne fait pas.
Horace ay[an]t detesté les horreurs de la guerre civile, ajoute :
Juvenal, sur le meme ton
Cognatis maculis similis fera quando leoni
Fortior eripuit vitam leo ? quo nemore unq[ua]m
Expiravit aper majoris dentib[us] apri ?
Indica Tigris agit rabida cum Tigride pacem
Perpetuam : sævis inter se co[nven]it ursis
Ast homini &c
Juven[alis]
Mais bon Dieu ! que cette voye est obliq[ue] et que si on vous prenoit au mot, M rs les censeurs, qu’il y auroit bien du meconte de votre coté ! Car q[ue] peut on apprendre dans l’ecole des betes qui n’authorise la tyrannie de ceux q[ui] soumettent le droit à la force. Ne voit on pas les petits chiens etre souvent tuez par des dogues. N’est ce pas une opinion commune q[ue] les loups tuent celuy d’entr’eux q[ue] la louve a le plus aimé. Les coqs ne se battent ils pas tous les jours les uns contre les autres jusqu’à la mort ? Les pigeons memes, le symbole de la debonnaireté et de la douceur ne les voit on pas s’entredechirer à coups de bec ?
La seconde femme de l’emp[ereu]r Sigismond [90] demanda à ceux q[ui] l’exhortoient de demeurer veuve apres la mort de son mary, à l’exemple de la tourterelle ; pourquoi ils ne luy proposoient pas plutot celuy des pigeons et des autres animaux v[oir] L’Excellence des hommes [91] p.278 [92] et Dicta Alphonsi regis p.55 et 56 [93]. Franc[ois] de Sales apud Joli Voy[age] de Munster [94] p.200 [95].
Que peut on voir de plus fort que la description q[ue] Virgile nous a donnée du combat de 2 taureaux amoureux d’une meme genice
Cornib[us] inter se subigit decernere ama[n]tis[.]
Pascit[u]r in magna selva formosa juven[c]a :
Illi alterna[n]tes multa vi prælia miscent
Volnerib[us] crebris[ :] lavit ater corpora sanguis ;
Versaque in obnixos urgent[u]r cornua vasto
Cum gemitu ; reboant sylvæque et magnus Olympus
Je ne dis rien de tant de betes q[ui] mangent leurs petits comme les chats, les lapins et plusieurs autres. Il faut avoüer q[ue] ces m[essieu]rs croient les gens bien faciles s’ils esperent de les convertir avec d’aussi fausses et d’aussi mechantes raisons. C’est vouloir exterminer les monstres avec une machoire d’ane [97]. Certes bien loin q[ue] les vicieux redoutent l’echole des betes, à laquelle on veut les ameiner, qu’au contraire, ils voudroient appeller devant leur tribunal de tant de severes sentences q[ue] l’on prononce contr’eux. Ils conviendroient avec les plus rigides casuistes, d’en user sur le chapitre de l’amitié du prochain, de l’air q[ue] font les animaux car co[mm]e les voyes de fait leur sont permises et que parmi eus, le fort emporte toujours le foible, les ho[mm]es violens et vindicatifs trouveroient tres bien leur conte à tout cela. Po[ur] les gens pacifiques, ils seroient d’accord à la verité q[ue] l’ho[mm]e epargnat l’homme comme le lyon epargne le lyon ; mais ils voudroient aussi satisfaire à leur amour de la maniere q[ue] le font les lions.• Car encore q[ue] parmi les betes il ne fasse pas toujours bon de se chauffer au feu des plus forts (temoin ces vers d’ Horace
Ca[us]a : sed ignotis perierunt mortibus illi
Quos Venerem incertam rapientes, more ferarum
Viribus editior cædebat ut in grege taurus [98]
Nonobstant cela, dis je, les plus poltrons trouveroient asses de moyen d’assouvir pleinem[en]t leur fougue amoureuse si les ho[mm]es avoient en amour la meme liberté q[ue] les animaux. De là vient q[ue] les amans envient aux betes farouches le bonheur qu’elles ont de se satisfaire quant [99] bon leur semble.• Apres cela qu’on s’aille servir de ce beau lieu commun de morale, Il y a apparence qu’on luy donneroit un si joly tour q[ue] celuy q[ui] l’auroit emploié contre le vice, passeroit toujours p[ou]r la dupe
Hor[atius] Sat[yrarum] 3.
Hanc Venerem pietas ; coeuntque a[nim]alia nullo
Cætera delicto nec habetur turpe juvencæ
Ferre patrem tergo, fit equo sua filia coniunx
Quasque creavit, init pecudes caper, ipsaque cuius
Semine concepta est ex illo concipit ales
Felices quib[us] ista licent ! humana malignas
Cura dedit leges, et q[uo]d na[tur]a remittit
Invida jura negant.
Mais me direz vous Mr, tout ce q[ue] vous venez de dire etant contre le sage Salomon q[ui] renvoye le paresseux à la fourmi [102], prenez garde q[ue] vous ne manquiez de respect envers l’Ecrit[ure] S[ain]te[.] Je vous repons Mr, que je revere ces livres sacrez, et q[ue] je renonce* pour mien tout ce qui se pourra trouver dans mes lettres, qui ne temoigne pas assez nettem[en]t cette venera[ti]on. Je dirai neantmoins qu’un paresseux qu’on voudroit trop presser par l’exemple de la fourmi, embarrasseroit peut etre bien un ho[mm]e s’il luy repondoit, He bien puis q[ue] vous voulez q[ue] j’imite cette petite bete je le ferai, je prendrai à toutes mains dans le p[remi]er champ que je rencontrerai ; tout me sera de bonne prise, je ferai ma provision pour moi et pour mes enfans dans la grange qui me sera la plus commode ; tout cela à l’exemple de la fourmi ( v[ide] Horat[ium] Sat[yrarum] 1, l.1, Juven[alem] Sat[yrarum] 6 [103] ). On luy repliqueroit sans doutte qu’il ne faut pas outrer les comparaisons, et qu’il faut en toutes choses user de discernem[en]t, q[ue] la fourmi doit etre imitée en ce qu’elle se sert bien de l’occasion mais non pas en ce qu’elle prend le bien d’autrui.• C’est à dire q[ue] ceux qui n’ont point de bien, se doivent mettre au service de ceux qui en ont, afin de gagner quelq[ue] chose. Ouy mais qu’y a t’il de semblable au procedé de la fourmi ? C’est bien plutot fait de prendre co[mm]e elle où on en trouve, et c’est bien mieux l’imiter q[ue] ne font les valets des riches.
Quoi qu’il en soit Mr, je vous prie de ne vo[us] pas imaginer que j’en veuille à tous les apologues et à toutes les ingenieuses fables de l’Antiquité car au contraire j’avoue qu’on peut tirer de ce q[ue] l’on voit faire aus betes, des instructions merveilleuses po[ur] la conduite de la vie, et po[ur] la conviction des vicieux, par exemple la fourmi est une bonne leçon à ces avares q[ui] amassent toujours sans jamais jouyr de leurs biens accumulez. Elle les condamne en 2 manieres, p[remieremen]t parce qu’ils ne mettent aucune fin à leur avidité au lieu qu’elle se repose dés q[ue] la belle saison e[st] passée. D[euxiememen]t parce qu’ils n’osent toucher à leurs thresors, au lieu qu’elle se nourrit des grains qu’elle a amassés par sa diligence ( Hor[atius]
Il y a long tems q[ue] je cerchois une occasion de vous parler de mon Horace ; la voicy finalem[en]t arrivée, car c’est de luy q[ue] j’emprunte ces 2 dernieres pensées. Cet Horace donc que j’ay rencontré icy dans ma solitude, n’est pas un Horace tel quel. Il est acco[m]pagné d’une version francoise q[ui] me le rend extremem[en]t precieux, car c’est asseurem[en]t une version extraordinaire. Elle est en vieux gaulois, et en vers ; elle s’attache fort au texte, et quelquefois si scrupuleusem[en]t qu’elle est aussi obscure p[ou]r le moins que le latin. Elle a eté composée par Robert et Anthoine Le Chevallier d’Agneaux freres, natifs de Vire en Normandie [105]. Ce q[ui] e[st] si glorieux à cette ville que l’autheur des Delices de la France traittant de la basse Normandie, dit en p[ro]pres termes Vire n’est considerable q[ue] p[ou]r avoir donné 2 illustres poetes à la France, qu’on nomme Robert et Anthoine. Le livre des Delic[es] de la Fr[ance] e[st] imprimé à Paris ches Jaques Cottin 1670 [106]. Ce qu’il y a de rare c’est que quand je n’entends pas le traducteur, Horace me fait trouver ce qu’il veut dire, et lors que je n’entends pas quelq[ue] endroit d’Horace, la traduction m’en explique tout le mystere. Mais afin que vous en jugiez par vous meme Mr, je m’en vas vous en transcrire quelques passages. Je m’asseure q[ue] vous trouverez que le sens d’Horace y est assés heureusem[en]t et assez fidelem[en]t exprimé
Pocula num esuriens fastidis o[mn]ia præter
Pavonen, rhombuque tument tibi cum inguina : num si
Ancilla aut verna est præsto puer impetus in quem
Continuo fiat, malis tentigine rumpi ?
Non ego : namque parabilem amo venerem facilemque
Illam, post paulo : sed pluris : si exierit vir
Gallis, hanc Philodemus ait sibi, quæ neq[u]e magno
S[te]t pretio neq[u]e cunctet[u]r cum est jussa venire.
Sat[yrarum] 2
Ecoutons maintenant la version
Pour boire cerches tu la tasse d’or luisante ?
Q[uan]d se presse la faim, vas tu tout rejettant
Hors le pain et turbot ? Q[uan]d ton outil se tend
S’il s’offre un garson serf ou servè où il se rue
Aimes tu mieux crever de trop d’envie emeue ?
[N]o[n] pas moi : car facile et qui pour peu s’obtient
J’embrasse une Venus. L’amoureuse qui [t]ient
Ce langage tantot : mais pour plus je me prete
Si tot que mon mari sortira je suis prete
Il faut dit Philodeme aus Gaulois la laisser.
Celle là q[uan]t à lui desire embrasser
Ni qui coute beaucoup, ni qui quand on l’appelle
Point ne tarde à venir [107].
Je remarquerai en passant que les anciens Gaulois devoient etre et patiens et grans faconniers* veu co[mm]e on parle d’eux dans ce passage [108]. Apparemment les Romains les regardoient co[mm]e on regarde aujourd’hui les Allemans qui ont autant de patience qu’on veut pourveu q[ue] tout se fasse avec poids et mesure, pourveu q[ue] la methode, et la ceremonie soient bien observées. Presentement les Gaules sont habitées par un autre espece d’hommes qui peut etre à leur tour renvoiroient aux Italiens les femmes q[ui] n’iroient pas vite en besogne, et q[ui] marchanderoient trop longtems ; si ce n’est qu’il fut jugé plus à propos de les laisser aux peuples du nort, amateurs des remises* et des delais s’il en fut onques. Sur quoi Mr je vous dirai la saillie d’un gentilho[mm]e de cette province.• Entend[an]t lire un article de la gazette q[ui] portoit q[ue] le connetable Vrangel se devoit embarquer bien tot p[ou]r venir commander une armée en Allemagne [109] ; Par Dieu s’ecria t’il en se levant de son siege il seroit bien tems q[ue] cette na[ti]on fit quelq[ue] chose, il y a 3 ans qu’on dit qu’ils vont commencer la guerre, f… des* lanterniers* depuis qu’on parle de leurs preparatifs, les Francois auroient ravagé dix provinces et nos generaux auroient usé 3 armées chacun. On rit prodigieusem[en]t de cette boutade, et celui q[ui] lisoit la gazette se souvint d’une cajolerie qu’on avoit autrefois debitée à Mr le p[rin]ce de Condé, c’est qu’il y eut un parasite qui lui vint dire un jour, Tu dieu M[on]s[ei]g[neu]r co[mm]e vous y allez, vous usez plus d’armées que de botes et 100 regimens vous durent moins qu’un justaucorps [110].
Mais p[ou]r revenir à Horace je vous prie Mr de jetter les yeux sur le commencem[en]t de l’ode 5 du 2 e livre, et en meme tems sur les vers q[ui] suivent
Encor le joug porter, rebelle
N’encor egalement fournir
Du confort à la charge deuë :
Ni du taureau qui chaud se ruë
En l’amour, le faix soutenir
Sur les champs au verd pasturage
La genisse a tout son courage
Or soulageant au bord des eaux
Le grief chaud ; ores ardant gaie
Dedans une humide saussaie
Folatrer avecques les veaux [111].
Que dirés vous de cet endroit de l’ode 6 du 3 e livre
Inter mariti vina : neque eligit
Cui donet imp[er]missa raptim
Gaudia, luminib[us] remotis etc.
Cerche entre les banquets vineux
Du mari : ni ne fait elite
A qui emblement de son corps
Quand les chandelles sont dehors
Elle offre l’ebat illicite [112].
Et de cette autre de la Satyre 7 du l[ivre] 2
Peccat uter n[ost]rum cruce dignius ? acris ubi m[e]
Na[tur]a incendit, sub clara nuda lucerna
Quæcu[m]que excepit turgentis verbera caudæ
Clunib[us] aut agitavit equum lasciva supinu[m]
Dimittit neque famosum neq[u]e sollicitu[m] ne
Ditior aut fo[rm]æ melioris meiat eodem.
Dave d’une putain : qui se rend du supplice
Du gibet toi ou moi plus digne par son vice
Quand d’un chaud aiguillon m’a nature inci[té]
Celle, qui qu’elle soit, qui nue à la clarté
D’une lampe a receu du nerf enflé la touche
Ou des fesses pressé, folatre dans la couche
Le renversé cheval, ne me laisse noté
D’infamie, ou en soin qu’une plus grande beauté
Ait affaire avec elle, ou un plus riche encore [113].
Il faut que je vous fasse encore juge de cettui ci
Contemplere oculis, Hypsæa cæcior, illa
Quæ mala s[un]t spectes. O crux ! o brachia ! verum
Depugis, nasuta, brevi latere ac pede longo est
Le corps a de plus beau, d’yeux Lynceens ne voi
Regarde plus qu’Hypsée aveugle les p[ar]ties
Qui plus laides y sont. Ebahi tu t’ecries
O la greve, o les bras, mais long nes et cour[t]s flancs
Et grele cuisse elle a avecques les pieds grans
En voicy un qui ne vous paroitra pas de paille* [114][.] Lisez seulement la Sat[ire] 9 du 1 er livre
Par la rue sacrée, et à part moi rouloie
Des songes ne sai quels, ou du tout retenu
Un qui m’etoit de nom tant seulement * connu
Me vient à rencontrer, et me prenant la dextre
Comme t’est il ami le plus doux, qui peut etre
Bien comme tu vois dis je : avecques un desir
La part où tu voudras, de te faire plaisir.
Comme il tache à me suivre, à dire je m’avance
Te plait il rien de moi ? pren de nous connoissance
Repondit il adonc : nous avons du savoir
Ceci lui di je lors te fera plus avoir
De credit envers moi [115].
Rogare longo putidam te sæculo
Vires q[uo]d enervet meas ?
Cum sit tibi dens ater, et rugis vetus
Frontem senectus exaret :
Hietque turpis i[n]ter aridas natis
Podex velut crudæ bovis
Ce qui rend ma force affoiblie
Au jeu d’amour, me vas tu demandant ?
Veu que tu as noire la dent
Que la vieillesse au front t’empraint ses rides
Et qu’entre les fesses arides
Te bée ainsi le trou laidement flac
Qu’à la vache au cru estomac [116]
Ib[idem] Epod[on] 12
Inachiam ter nocte potes : mihi semper ad unum
Mollis opus. Pereat male quæ te
Lesbia quærenti tauru[m], monstravit inertem :
Cùm mihi Cous ade[ss]et Amy[n]tas
Cuius in indomito constan[ti]or inguine nervus
Quam nova collibus arbor inhæret
Tu peus 3 coups le faire à Inachie
Un seul toujours mol tu me vas touchant
De miserab[le] mort puisse mourir Lydie,
Qui m’a montré un lache à moi cherchant
Un taureau quand Amint de Co j’avois en tete
A qui dans l’aine indontée attaché
Hert un plus ferme nerf que ne hert sur le fete
D’une colline un jeune arbre fiché [117].
Je trouve dans les Remarques de Mr Menage sur la langue franc[oise] ces vers de Marot :
Assuroit sa dame farouche
Mordez moi, dit il, s’il vous cuit
Voila mon doit en votre bouche etc.
Et bien, dit il, tendre rosée
Vous ai je fait du mal ainsi ?
Adonc repondit l’epousée
Je ne vous ai pas mordu aussi [118].
Voici quelques vers de Jean de Mehun qui, à cause de leur antiquité, pourront avoir ici leur place
Et si le fait flamber plus cler que seiche buche
Car maint droit heritier desherite tout outre
Et herite à grand tort maint bastard, maint advoultre
Ce dernier mot signifie
Je croi Mr qu’en voila assez pour vous faire juger de l’importance de cette traduction, car vous n’etes pas co[mm]e ceux qui ne sauroient dire combien une chose e[st] longue, s’ils ne l’avoient bien mesurée. Vous etes co[mm]e ce phi[loso]phe qui connut au vrai la taille d’ Hercule, pour avoir veu seulement la trace de son pied [120]. Ex ungue leonem [121] . Au reste j’aurois entierem[ent] perdu le gout des bonnes lettres dans cette solitude, si je n’eusse rencontré un Horace conditionné comme celuy dont je me sers presentem[en]t. Chacun a ses appetits, mais il y a de certaines viandes qui ont une vertu ragoutante* pour la plus part du monde,
Hor[atius]
Languidus in cubitu[m] jam se conviva reponet [122] .
Le jambon et les saucisses sont assés de ce genre là
Flagitat in morsus refici. Quin o[mn]ia malit
Quæcu[m]que immundis fervent illata popinis.
(Hor[atius]
Il veut etre remis, aincois mieux aime tout
Ce que des cabarets sales chaud on apporte.
Hor[atius] ib[idem] [123]
C’est justem[en]t ce q[ui] m’est arrivé ; il n’y a eu que des mets apportés d’une puante et hideuse cuisine qui m’ayent remis en appetit. Car vous vous souviendrez s’il vous plait Mr que je vous disois d’entrée de jeu, que j’ay fortuitement rencontré dans la hute d’un miserable paysan, Horace Virgile, Terence et quelques autres morceaus frians, qu’on laissoit pourrir faute d’en connoitre la bonté[.] Ce bon villageois nourrissoit son esprit d’une viande horriblem[en]t grossiere, tandis que les vers et la poussiere faisoient gogaille* sur de[s] mets tres delicats qu’il negligeoit dans son coffre. A peu pres co[mm]e font les avares, lors qu’ils couchent sur un fagot, et laissent en proye aus tignes* les plus beaux lits du monde,
Octoginta annos natus, cui stragula vestis
Blattaru[m] ac tinearu[m] epulæ, putrescat in arca.
(Hor[atius] Sat[yrarum] 3 l.2) [124]
Cette comparaison vous surprendra Mr, mais sur ma parole elle n’est pas si impertinente qu’on diroit bien, car un ignorant qui a des livres, et un avare qui a de l’argent sont tout à fait semblables, puis que l’un et l’autre possede un bien q[ui] lui e[st] inutile, et dont il ne connoit pas l’usage. En effet je soutiens qu’un avare ne sait pas mieux se servir de ses richesses, qu’un ho[mm]e qui n’a jamais etudié se sait servir d’un livre. Si bien q[ue] s’il y a de la difference entre un paysan fourni d’une bibliotheq[ue] et un riche avare c’est que celuy cy s’est bien donné de la peine p[ou]r une chose q[ui] luy e[st] inutile, au lieu que celuy là se peut consoler de ce q[ue] ses livres ne luy sont d’aucun usage, par la pensée qu’ils ne luy ont rien couté, et qu’il luy est facile de s’en defaire. Je trouve qu’un avare qui se tue d’amasser du bien, est aussi fou q[ue] celuy qui feroit provision de formes et de tranchets, sans avoir jamais appris le metier de cordonnier. C’est Horace q[ui] me fournit cette pensée
( Sat[yrarum] 3 l.2) [125]
Voi[r] contr[e] les avares sup[ra] fol[io] 22 phr[ases] po[eticas] [126] p.208 [127]
Ce qu’il y a de plus facheux p[ou]r les avares c’est qu’ils amassent avec beaucoup de peine une chose dont la possession est autant ou plus penible,
ou co[mm]e le prononceoit Epicure,
( La M[othe] Le Vay[er], Lett[re] 149) .
Le mecred[i] 17 oct[obre]
Il y a lieu de me faire une forte objection, car enfin me direz vous, quelle apparence que dans un pays de famine vous soyez devenu si delicat qu’il vous ait falu cercher de[s] morceaus ragoutans. Cela seroit bon si vous aviez eté dans quelq[ue] grande ville, où l’abondance vous eut crevé les yeux. En ce cas là il est facile de comprendre que les ragouts vous eussent eté necessaires, et q[ue] p[ou]r vo[us] regaler, il eut falu un raffinement de sausses miraculeux. Fou qui se mele de traitter des gens de ce calibre
( Sat[yrarum] 4, l.2) [128]
Plus fou encore celuy qui ne peut prevenir la satieté, par une varieté prodigieuse de viandes. C’est un secret dont le rat de village se servit quand il convia le rat de ville
Vincere tangentis male singula dente superbo
( Sat[yrarum] 6, l.2) [129]
On pourroit meme comprendre que regorgeant de choses delicieuses, un vil et puant apret*, vous eut remis en appetit, car c’est assés la coutume de demander une soupe à l’oignon q[uan]d on est soû
Mais q[ue] dans un lieu où vous manquiez de toutes choses, vous ayez eté degouté, c’est ce q[ui] passe la croiance. Optimum condimentum fames disoient les Anciens [131][.] Jejunus stomachus raro vulgaria temnit [132] [.]
On ne voit guere les gens affamés faire les difficiles sur le chois des viandes, et s’ils trouvent un morceau de lard, ils n’attendent pas à manger qu’on ait fait cuire une tourte, et si le sommeiller* n’e[st] pas au logis, ils se ruent toujours à bon conte sur le p[remi]er pain qu’ils trouvent.
Sperne cibum vilem : nisi Hymettia mella falerno
Ne biberis diluta foris est promus, et atrum
Defendens pisces hyemat mare cum sale panis
Latrantem stomachum benè leniet.
( Sat[yrarum] 2, l.2) [133]
Le meilleur cuisinier du monde est un sot, en comparaison de la faim q[ue] l’on gagne en bien travaillant
Les echoliers qui sont en pension, et q[ui] n’ont quelquefois qu’une miserable epaule p[ou]r 9 ou 10 peuvent à peine attendre qu’elle soit cuite, bien loin qu’ils se donnent la patience qu’on y fasse de[s] ragouts. Puis q[uan]d ils sont à table Dieu sait co[mm]e l’ esclanche* est balotée. Il lui en prend co[mm]e à celle dont Regnier Sat[ire] 10 parle
Plus dru qu’une navette au travers d’un metier
Glissoit de main en main où sans perdre avantage
Ebrechant le couteau, temoignoit son courage
Et durant que brebis elle fut parmi nous
Elle sceut bravement se defendre des loups
Et de se conserver elle mit si bon ordre
Que morte de vieillesse elle ne savoit mordre [134].
Sudando pinguem vitiis albumque nec ostrea
Nec scarus, aut poterit peregrina juvare lagois
( Ib[idem])
L’homme trop gras et palle à plaisir n’a manger
Ni l’huitre, ni le scare, ou le lievre etranger [135].
Je demeure d’accord avec vous Mr de toutes ces veritez, et je ne puis me deffendre qu’en disant q[ue] j’etois tombé dans ce pitoyable etat, où par un excez de pituite* l’on a veu de[s] gens passer des années entieres sans manger. Les histoires sont pleines de ces exemples. Cela me pourroit etre aussi bien arrivé qu’à un autre
(les Juifs donnoient de[s] breuvages aus condamnez à mort qui leur otoient le sentim[en]t de supplice)
Il n’y a rien d’ admirable* en cet accident si ce n’est qu’il est arrivé tres à propos, la fortune qui se plait si fort au contretems, ne pouvoit rien faire de plus commode que de me faire tomber dans l’inappetence, justem[en]t lors q[ue] je n’avois rien à manger. Je luy suis tres obligé de cette courtoisie, et je n’oublierai jamais cette faveur, quoi qu’apparemm[en]t elle me l’ait faite sans y penser, car à juger d’elle par ses actions, elle ne nous ote jamais ses biens, sans tacher de nous en laisser un grand desir. Elle aime bien mieux faire des Tantales, affamez de ce qu’ils ne peuvent prendre
que des indifferens et des insensibles à leur indigence. Et de vrai quel mal feroit elle à un ho[mm]e, si en meme tems qu’elle le priveroit d’une chose, elle luy en arrachoit de l’ame le desir et l’affection. C’est une grand’pitié que de soupirer ardemm[en]t apres un bien q[ue] l’on possede, co[mm]e font les riches avares, c’est un malheur q[ue] de souhaitter passionnement les biens q[ue] l’on n’a pas, mais d’etre pauvre sans se soucier des richesses et sans les desirer c’est à mon avis une bonne fortune plutot qu’une disgrace. Si bien q[ue] je dois croire q[ue] quand mon capricieus destin m’a jetté dans ce desert* ce n’etoit pas sa pensée q[ue] j’y devinsse degouté. Il n’est pas assez bien faisant pour un procedé si honnete, mais n’importe, je luy en veux tenir conte, ayant plus d’egard à l’effet qu’à l’intentio[n]. Aussi bien n’est il pas sans doutte genereus au point q[ue] celui q[ui] parle ainsi dans Terence
Cum is nil promereat postulari id gra[ti]æ apponi sibi.
Terent[ius] Andr[iae] act 2, sc.1
( v[ide] phr[ases] po[eticas] [138] p.166) [139] Je dirois volontiers q[ue] la fortune ne travaille pas tant à aiguiser ses armes, lors qu’elle nous veut nuire, qu’à nous attendrir le corps et je l’ accomparerois* plus tot à ces serpens des Indes q[ue] l’on dit avaler des ho[mm]es tout entiers, et qui p[ou]r le faire plus facilem[en]t, leur rendent lisse la peau à force de la lecher, je l’accomparerois dis je plutot à ces serpens qu’aux sangliers qui aiguisent leurs deffenses q[uan]d ils veulent se ruer sur leur ennemi. C’est pourquoi si on m’en vouloit croire, l’on n’iroit pas apprendre à tirer des armes contre la fortune, mais au lieu de cela, l’on s’acheteroit un bon plastron, et sans s’amuser à la parade ni à la riposte, on luy presenteroit la poitrine bien cuirassée, et qu’elle s’escrimat là tout son sou. Ce seroit la traitter magistralem[en]t, et luy apprendre son metier, et elle seroit bien attrapée, puis q[ue] nous ne sentirions aucun de ses coups, qui est p[ou]rtant ce qu’elle a p[ou]r but, plus qu’aucune autre chose. Nous pourrions alors dire co[mm]e Anaximandre, frapez à votre aise ce n’est pas Anaximandre, mais l’etui ou le fourreau d’Anaximandre q[ue] vous frappez [140]. Que si la fortune vouloit ruser, et porter ses botes* au deffaut* du plastron, il n’y auroit qu’à se bien couvrir tout le corps, sans laisser rien à decouvert [n]o[n] pas meme le talon, no[us] souvenans du malheur d’Achille. Pour plus grande seureté il seroit bon d’avoir un plastron à queue trainante et aussi elevé par dessus la tete q[ue] ces bonnets q[ue] les p[rinc]es allemans mettent volontiers sur l’ecu de leurs armes. Il vaudroit mieux pecher par excez co[mm]e le Maltin d’ Horace, q[ue] par deffaut
Inguen ad obscænu[m] subductis usque facetus
Un autre en portant un retroussé jusqu’à l’aine
Se rend digne de ris.
( l.I, Saty[rarum] 2) [141]
Et q[uan]d on devroit s’attirer l’indignation de tout un peuple, il n’importeroit alle[r] co[mm]e cet affranchy de Pompée à q[ui], meme Horace en veut tant (
Cum bis ter ulnarum toga
Ut ora vertat huc et huc euntium
Liberrima indigna[ti]o [142].
Pour peu q[ue] je suivisse mon genie* vous me verriez bien tot enfoncé dans la plus sublime morale, et debiter des dogmes
Pythagora[n], Anytique reu[m], doctu[m]que Platona
( Satyr[arum] 4 l.2) [143]
Mais il n’est pas necessaire d’en venir là, et vous vous passerez bien de mes reflexions. Outre qu’apres la longue diete q[ue] j’ay faite, il n’est pas sain de manger à discretion ; et sur tout des viandes aussi mouelleuses q[ue] celles qu’on sert à la table des philosophes. Je vous ay fait grand plaisir, dites la verité Mons[ieu]r, d’avoir quitté au meilleur gout, car vous disiez sans doute en vous meme, cet ho[mm]e cy se va crever de manger de la morale, il a l’estomac affoibli d’une longue abstinence, et il le va charger d’une viande trop forte, encore si on luy faisoit comme au betail de Mesopotamie [144], q[ue] l’on prend soin de retirer des paturages à bonne heure* crainte qu’il n’etouffe de graisse ; mais il n’a pré qui luy puisse rendre cet office. Vous raisonniez ainsi tout seul, ce me semble ; si bien que ma retenue a deu vous surprendre tres agreablement.
Le 18 oct[obre]
En effet j’ay assez bien commandé à mon appetit, et apres avoir seulem[en]t gouté du morceau, je vous l’ay renvoyé tout entier, car Mons[ieu]r ce q[ue]* je me suis arreté en si beau chemin, c’est p[ou]r vous laisser faire toutes les reflexions dont ce beau sujet est capable. J’ay agi à la hollandoise, faisant co[mm]e les filles du logis, qui p[ou]r faire boire leurs hotes, boivent les p[remi]eres et puis leur donnent la canne*, ou pour me servir d’une comparaison plus noble, j’ay fait co[mm]e Didon, qui ayant seulem[en]t touché du bout des levres la grande coupe avec quoi ses ancetres faisoient les libations, la donna à Bitias qui la vuida tres gaillardement
P[rim]aque libato summo tenus attigit ore
Tum Bitiæ dedit increpitans : ille impiger hausit
Spumantem patera[m] et pleno se proluit auro.
J’ay joüé le role de Didon, c’est à vous Mr à jouer celuy de Bitias, car quoi qu’en toute autre chose vous soyez mon maitre et moi v[ot]re humble serviteur, il ne se peut q[ue] sur le fait de la science je ne prenne la part du roy, et ne vous laisse celle du chancelier. D’où il arrivera une chose asses inique, c’est que vous serez moins avantageusem[en]t partagé que moi, à cause q[ue] votre merite surpasse infinim[en]t le mien.
Ce q[ui] me remet en memoire le biais dont je me servis un jour po[ur] satisfaire un ho[mm]e tout à fait scandalizé de ce q[ue] ceux q[ui] ont beaucoup de merite, sont d’ordinaire plus mal dans leurs affaires que les sots. Je luy dis que Dieu etant le pere commun de tous les ho[mm]es il ne falloit pas s’etonner qu’il fit plusieurs lots de ses faveurs, afin q[ue] tous y eussent part. Qu’il faisoit un lot composé d’esprit et d’adresse, un autre de courage et de force, un autre de jugement, un autre de richesses, et ainsi du reste, et q[ue] cela etant il devoit arriver que celui q[ui] n’avoit pas en partage ni l’esprit ni le jugement ni le courage, eut beaucoup de bien, et au contraire que le merite et l’argent etant 2 faveurs differentes c’etoit assez à un ho[mm]e d’avoir ou la p[remi]ere au deffaut de l’autre, ou celle cy au deffaut de celle là. Qu’un pere q[ui] a beaucoup d’enfans et beaucoup de biens, ne laisse pas tout à un seul, que s’il y en a quelqu’un d’estropié il luy fait une portion beaucoup meilleure qu’à un autre en qui il voit des talens propres à luy faire faire fortune. Que Dieu faisoit justem[en]t cela meme ; qu’un sot recevoit de luy le partage d’un fils estropié, et qu’il luy donnoit des biens pour le recompenser de l’esprit et de la capacité qu’il ne luy avoit pas accordée, qu’un habile homme recevoit son habileté en tant moins* de ce qu’il pouvoit pretendre ; q[ue] c’etoit comme sa legitime*, dont il devoit se contenter ; et qu’apres tout il ne seroit pas raisonnable qu’il emportat tout l’heritage et q[ue] ses freres n’eussent rien. Mon homme m’avoua q[ue] mes reponses l’avoient plus touché que n’avoient fait les plus etudiées raisons des theologiens. Mais il avoit pourtant de la peine à digerer cette inegalité de partages qu’il pretendoit etre dans le monde, et il en revenoit toujours là que
Je luy repondis q[ue] co[mm]e notre corps seroit [n]o[n] seulem[en]t monstrueux, mais aussi incapable d’agir, si toutes les parties avoient la meme figure et les memes qualitez que la tete, ainsi le monde ne sauroit subsister, si tous les ho[mm]es etoient egaux en toutes choses ; et qu’entre l’agent et le patient il e[st] absolum[en]t necessaire qu’il y ait difference de qualitez, c’est un p[rin]cipe de l’Echole q[ue] simile [n]o[n] agit in simile [148] . Le monde a besoin po[ur] subsister q[ue] les uns soient necessaires aux autres, ce q[ui] ne seroit pas si chacun avoit tout. Si les riches avoient l’ industrie* de se faire des habits et des souliers[,] q[ue] deviendroient les tailleurs et les cordonniers[scol] si ceux q[ui] ont le bonheur de commander des armées, ou de presider au conseil des p[rin]ces avec gloire, ecrivoient admirablem[en]t bien, q[ue] feroient les pauvres savans[?] C’est pourquoi p[ou]r le mieux Dieu a voulu q[ue] les uns seussent faire les belles actions, et les autres les bien decrire. La pluspart des cap[itai]nes ( La Mothe Le Vay[er] Disc[ours] de l’hist[oire]) q[ue] no[us] savons avoir le plus fait avec l’epée, ont eu d’ailleurs une fort mauvaise plume [149]. Les livres de Pyrrhus et d’ Hannibal furent tels qu’on ne peut pas dire qu’ils ayent rien contribué à leur reputa[ti]on (il cite en marge Denys d’Halicarn[asse] et Cornel[ius] Nepos)[.] Ceux d’ Auguste, de Tybere, de Claudius et de tant d’autres emp[ereur]s ont eu si peu de genie qu’il n’en e[st] rien venu jusqu’à nous [150]. Asinius Pollio trouvoit les Commentaires de Cesar composez avec si peu de soin et de verité, qu’il croioit qu’il les auroit corrigés sans sa mort precipitée. Sueton[ius] in Jul[io] C[æsare] [151] 56 [152]. C’est ainsi q[ue] toutes les graces ne se trouvent que rarem[en]t en un meme sujet, q[ue] le temperam[en]t q[ui] donne les unes no[us] envie bien souvent la possession des autres et qu’il semble q[ue] le Ciel n’ait pas voulu p[er]mettre q[ue] ceux q[ui] font les choses dignes d’etre ecrittes, puissent encore avoir la gloire d’ecrire celles q[ui] meritent d’etre leues.
Là dessus il vint un personnage q[ui] avoit à me parler, et notre dispute cessa q[ui] sans cela etoit p[ou]r durer jusques à la nuit, car mon antagoniste vouloit avoir raison, et se preparoit à me repliquer plusieurs choses. Je le quittai en luy disant que nous devrions no[us] faire justice, qu’il y en avoit bien d’autres qui se pourroient plaindre plus justement, et q[ue] p[ou]r l’ord[inai]re ceux q[ui] crient tant q[ue] le merite n’a pas eté consulté dans la distribu[ti]on des biens du monde, ne sont presq[ue] pas dignes de la petite portion q[ui] leur e[st] echeue. Il comprit q[ue] c’etoit une pierre dans son jardin, et il s’efforcea de m’arreter po[ur] me rendre ce coup de dent, mais il n’y trouva pas trop son conte :
Offendet solido.
( Satyr[arum] 1,
Celuy q[ui] nous vint interrompre, m’ayant dit en peu de mots, ce qu’il avoit à me co[mmun]iquer s’informa du sujet de notre contesta[ti]on, et l’ayant apris, cet homme me demanda t’il, Ne croit il pas etre bel esprit, n’est il pas poete, ne tranche t’il pas du docteur ? Ouy luy repondis je. C’est la coutume de ces gens là poursuivit il, de se plaindre qu’on ne fait pas conte des honnetes gens.
Le 19 octobre
Il leur semble q[ue] quand ils ont fait un sonnet, les aloüettes leur doivent tomber toutes roties dans la bouche, et si l’evenem[en]t ne repond pas à leur attente, ils maudissent la barbarie de leur siecle, ils l’appellent l’age de fer, et c’est beaucoup s’ils n’accusent pas la divine Providence de peu de discernement. Vous en parlez tres bien ; repliquai je, p[ou]r un ho[mm]e q[ui] n’est pas du metier, et Horace q[ui] en qualité de poete, devoit connoitre le naturel des p[erson]nes de sa profession, n’en parloit pas autrem[en]t q[ue] vous voicy ce qu’il en dit • en ecrivant à l’emper[eur]
(Ut vineta egomet cædam mea)
…
Quum lamentamur, non apparere labores
N[ost]ros, et tenui deducta poemata filo :
Quum speramus eo rem ventura[m] ut simulatque
Carmina rescieris nos fingere, com[m]odus ultrò
Arcessas, et egere vetes, et scribere cogas.
( Episto[larum] 1 l.2)
[156]
Ce que vous dites là, repartit il, est de bon sens, je m’etonne q[ue] m[essieu]rs les beaux esprits ne profitent de cette lecon q[ue] leur donne un de leur corps. Et en bonne conscience voudroient ils bien q[ue] tous les bons poetes eussent 10 m[ille] ecus de revenu[.] Cela seroit capable d’exterminer toute la poesie, car quand on se peut passer des etreines du grand monde, on ne se soucie guere de se tourmenter l’esprit apres une ode, un sonnet et un madrigal. C’est quand on a besoin d’excroquer quelques •pistoles, q[ue] l’on s’evertue, et q[ue] l’on fait bien valoir le Parnasse. Le poete q[ue] vous venez de citer ne s’est pas teu sur cet article, car voici ce qu’il en dit parlant de luy mem[e]
Decisis humilem pennis, inopemque paterni
Et laris et fundi ; paup[er]tas impulit audax
Ut versus facerem. Sed q[uo]d non desit habente[m]
Quæ poterunt unq[ua]m satis expurgare cicutæ
Ni melius dormire putem, q[ua]m scribere versus ?
( Episto[larum] 2, l.2)
[157]
Un poete qui a gagné beaucoup par le trafic de ses louanges, se repose finalement[,] dit à Dieu • au Parnasse, et append sa plume au temple d’ Apollon
Au lieu qu’etant pauvre il rime jusques au dernier soupir. Pour coup[er] court, si tous ceux q[ui] savent faire des vers etoient rentez de 10, ou 12 m[ille] ecus, qui •seroit assez ennemi de son repos pour ronger ses ongles à trouver la cheute d’un sonnet ?
Spargeret ? aut viridi frontes induceret umbra ?
( Virgil[ius] Ecl[ogarum] 9)
[159]
Quand il eut cessé de parler, je pris la parole p[ou]r luy dire qu’il y avoit bien du po[ur] et du contre à ce qu’il venoit de mettre en fait, q[ue] je me souvenois d’avoir leu dans la 7 e satyre de Juvenal [160] l’opinion contraire à la sienne solidem[en]t etablie, et q[ue] je pourrois luy faire voir •que son sentiment etoit tres incertain, si je n’avois epuisé mon esprit de contradiction dans la dispute d’où il m’avoit retiré. En effet continuai je si le metier de poëte etoit le grand chemin des richesses, tout le monde s’empresseroit à faire des vers ; •ceux là• memes qui auroient fait fortune par là rimeroient à toute outrance jusqu’à la fin de leur vie, soit p[ou]r n’etre pas ingrats à leurs Mecenes, soit parce q[ue] le talent de la poesie est si tenace, qu’il •ne s’en va qu’avec la piece. Ciceron en sa harangue p[ou]r Murena dit qu’il ne lui seroit pas honnete d’abandonner la plaiderie, apres avoir receu d’elle de si grands avantages,
D’ailleurs c’est un abus de s’imaginer qu’il n’y a que les miserables q[ui] riment. • Plusieurs grands seigneurs s’y adonnent tout de bon, et autrefois à Rome il y avoit grand nombre de poetes qui faisoient plus de frais à s’aquerir les applaudissemens de leurs auditeurs, que des gen[eraux] d’armée à recompenser ceux q[ui] faisoient de[s] vers à leur louange. Horace no[us] l’insinue q[uan]d il dit
Impensis cænaru[m] et tritæ munere vestis
( Episto[larum] 19 l.1)
[162]
Et Perse apres luy
Scis comitem horridulum trita donare lacerna :
Et veru[m], inquis, amo, verum mihi dicite de me.
( Saty[rarum] 1) [163]
Pour conclusion je lui dis que les poetes etoient semblables aux chats, q[ui] ne font jamais mieux la guerre aus rats que lors qu’ils sont bien nourris et bien engraissez ; et sans luy donner loisir de me •repartir, je me separai de luy au grand pas, maudissant de tout mon cœur tout opiniatre qui se plait d’aller jusqu’à la 3me et 4me replique. Mais à peine eus je soupé qu’il m’envoya ses reponses par ecrit, ne voulant pas q[ue] je me couchasse avec la pensée qu’il eut avancé •un sentiment sans avoir de tres fortes raisons po[ur] •le soutenir, tant il est vrai qu’il y a des personnes q[ui] croient qu’il y va de leur honneur de l’emporter dans toutes sortes de disputes. Ce n’est pas mon deffaut ; • j’ay eté autrefois un peu martyr de mes jugemens mais je ne le suis plus, de sorte q[ue] po[ur] le bien de paix je consens facilement qu’un autre croie avoir plus de raison q[ue] moi [164]. Si bien q[ue] je fis dire à mon • homme q[ue] je luy donnois gain de cause, et q[ue] puis qu’il vouloit q[ue] s’il n’y avoit point de beaux esprits pauvres, il n’y auroit • point de poetes, je n’avois plus le mot à dire.
Cepend[an]t Mr vous savez bien qu’il y a eu de[s] roys poetes, car sans aller deterrer dans l’Antiquité un Denys • le Tyran [165] et cent autres, ne sait on pas q[ue] le r[oi] Jaques a fait un poeme sur la victoire de Lepanthe [166]. Ce poeme a eté traduit par Du Bartas [167] et dés là il e[st] facile de connoitre qu’il etoit tres bon. • Les bons peintres ne copient jamais un tableau mediocre ; quelle apparence qu’apres tant de conformités qu’il y a entre la peinture et la poesie, Du Bartas eut voulu travailler apres un mechant original. Je ne voulus pourtant p[oin]t opposer cet exemple aus raisons de mon adversaire, de peur qu’il ne m’envoyat un 2. ecrit pire q[ue] le premier. C’est un ho[mm]e à se deffendre jusqu’à la derniere goutte de son ancre. Remarquez Mr dans cette avanture que la prudence humaine e[st] bien peu de chose. Je quitte un chicaneur pour me sauver de son importunité, et je me jette entre les bras d’un opiniatre q[ui] me fit cent fois plus de mal que n’auroit fait • le chicaneur.
Auguste a fait des vers co[mm]e il conste* par ce passage de Suetone,
Francois I er faisoit des vers grecs, latins et françois, il s’en trouve de manuscrits en diverses bibliotheques, et l’on voit encore en Avignon l’epitaphe qu’il fit de la belle Laure. Charles 9 ecrivoit aussi souvent des vers. Le Pays Œuvr[es] nouv[elles] V la lettr[e] E, p.681 [169]. Quintilien Institutio[nis] oratoria[e] l.x. c.1. ayant parlé de plusieurs grands poetes continue ainsi
Inter victrices hedera[m] tibi serpere lauros.
M. Costar a attribué ce passage de Quint[ilien] à Domitien v[oir] Diss[ertatio] sup[er] Homero] [171] p.136 [172]. Le roy Robert fils de Hugues Capet a receu le titre du plus savant des roys par un concile tenu à Lymoges, et Jean de Serres raporte dans sa vie qu’il etoit [n]o[n] seulem[en]t docte mais aussi devot et qu’on chante encore des hymnes de sa façon et nommem[en]t celui cy O Constantia martyrum mirabilis ; auquel rencontrant* sur le nom de sa femme Constance il la contenta joyeusem[en]t de l’honneur qu’elle avoit d’etre honnorée de ses ecrits lors grandem[en]t prisez de tout le monde. Ce passage e[st] raporté par Mr Gatineau tome 3 p.34 [173][.] Raportez à ce qui e[st] dit icy des hymnes, ce qui se voit des roys de Bourg[ogne] Rec[ueil] de serm[one] p.156, 290 et 294. Voy[ez] Louis d’Orleans Ouvertures des parlem[ents] [174] p.248 [175]•.
Le 20 octobre
Je me repens encore de n’avoir pas imité ce gueux* qui avoit la main effroyablem[en]t galeuse et qui ne chassoit pourtant point les mouches q[ui] y venoient faire curée parce disoit il, que s’il les eut chassées il en seroit venu d’autres à jeun q[ui] l’auroient plus tourmenté. Mon premier adversaire etant deja fatigué, j’en aurois eté quitte pour moins de souffrance, que je ne le fus du second qui avoit toutes les forces. Je me souviendrai toute ma vie de cette journée non sans beaucoup de chagrin, parce qu’il y eut un peu de ma faute. En effet si je ne me fusse point separé du premier disputeur, l’autre seroit entré dans notre conversa[ti]on, et apparemm[en]t ils se seroient bientot acharnés l’un sur l’autre, et moi je me serois tiré d’affaire, co[mm]e fit Horace lors que ce maudit importun qui le suivoit, fut rencontré par sa partie [176]. Car il profita de la querelle qu’ils se firent et se sauva[.] Entre vous le debat M rs.
C’est l’ord[inai]re que ceux qui se battent ensemble apretent à rire aux assistans. Quel plaisir pour bien des nations de regarder co[mm]e du haut d’une montagne la guerre qui est entre la France et je ne sai combien de peuples liguez et bandez contre elle. C’est ce qu’on peut appeller
On se divertit à voir cela co[mm]e faisoient les Romain[s] dans l’amphiteatre. Mais si on pouvoit regarder tout ce q[ui] se passe dans l’ame des spectateurs, toutes les conjectures qu’ils font ; tous les desseins chymeriques qu’ils se representent, leurs pensées, et leurs raisonnemens bizarres, ce seroit un spectacle plus risible, que le spectacle meme ; Combien d’Agamemnons q[ui] roulent dans leur tete des entreprises q[ui] ne seront jamais [178]
H[omère] B. v.36 [179]
et je connoi des gens q[ui] iroient dans l’amphiteatre plutot p[ou]r y voir les creuses imagina[ti]ons des assistans, que pour tout le reste ; co[mm]e Horace a creu q[ue] Democrite se seroit mieux diverti à regarder le p[euple] r[omain] qu’aux jeux memes qu’on luy representoit
Ut sibi præbentem mimo spectacula plura.
( Episto[larum] 1. l.2 ) [180]
Mais je ne m’appercois pas que j’ay sauté sur une reflexion bien haute. Il n’y a q[ue] vous Mr qui me voulut pardonner cette incartade, je suis faché de l’avoir faitte, car je me pouvois bien passer des affaires generales. Mais ce q[ui] e[st] fait est fait. Je reviens à mes disputeurs, et asseurem[en]t j’ay raison de me plaindre de moi meme de ce q[ue] je n’ay pas proffité d’une occasion si belle non seulement po[ur] m’epargner du chagrin mais aussi pour me divertir parfaitement. Ces M rs etant 2 grans parleurs, et fort amoureux de leurs pensées, ils n’auroient pas eté demi quart d’heure ensemble sans se contredire. Dés là la guerre auroit eté declarée ; car parmi des gens de cette humeur cela passe po[ur] un acte d’hostilité, et p[ou]r une rupture manifeste, les argumens, les objections, les solutions, les instances* • et toute l’artillerie de l’esprit de contradiction, eut eté • d’abord en etat, si bien que je ne pouvois manquer d’avoir dequoi rire d’un si grand chamaillis*. Et cela seroit arrivé pour si petite qu’eut eté leur question. Car ils auroient crié, ils se seroient agitez et echauffés aussi bien po[ur] une bagatelle, que pour une terre de 1 000 l[ivres] de rente. Je le puis dire, moi qui en ai fait l’epreuve ayant veu disputer sur des vetilles avec toute la chaleur qu’on auroit seu emploier po[ur] la deffence de sa religion. Je ne peus me tenir de faire remarquer à ces violens disputeurs qu’ils se devoient p[ro]portionner à leur sujet, leur demandant ce qu’ils feroient davantage si un athée ou un impie raisonnoit avec eux sur des matieres de foy q[ui] e[st] la meme demande que je faisois un jour à l’autheur d’un panegyrique. Il s’etoit toujours expliqué par des superlatifs, il n’y avoit rien eu pour luy ni de grand ni d’intrepide, tout avoit eté le plus grand et le plus intrepide qui se puisse concevoir. Avez vous bien regardé à l’avenir lui dis je, quand vous avez ecrit avec tant d’exaggera[ti]ons ? et que feriez vous s’il vous falloit faire demain le panegyrique du Roy. Vous ne vous etés rien laissé de reste ? Vous avez epuisé tous les termes de loüange ? Si j’avois eté à v[ot]re place je me serois mieux menagé, car il n’est pas bon d’avoir un ordinaire si magnifiq[ue] que si un p[rin]ce vous faisoit l’honneur de venir prendre un repas ches vous, il n’y eut aucun moyen d’encherir sur votre chere* d’à tous les jours. Je faisois allusion à une pensée d’ Horace
Sive diem festum rediens advexerit annus
Seu recreare volet tenuatu[m] corpus ubi[que]
Accedent anni, tractari mollius ætas
Imbecilla volet. Tibi quidnam accedet ad ista[m]
Q[ua]m puer et validus præsumis mollitiem, seu
Dura valetudo inciderit seu tarda senectus ?
( Saty[rarum] 2, l.2) [181]
Je trouve dans Mr Menage Obs[ervations] sur la langue fr[ançoise] p[ar]tie 2, ch[apitre] 74 [182] deux passages latins sur l’usage de l’hyperbole. Le p[remi]er est de Seneque
L’autre e[st] de Quintilien, q[ui] dit entr’autres choses
Mes interroga[ti]ons deconcerterent fort le panegyriste, et co[mm]e il cerchoit dans son esprit dequoi se relever de sa confusion Courage lui dis je Mr vous etes plus heureux q[u]e vous ne pensés, car s’il vous faut un jour faire l’eloge d’un grand p[rin]ce ces 3 mots vous suffiront, ce que j’ay dit par flaterie dans mon p[remi]er panegyrique, convient dans toute la rigueur de la verité à celuy que je preconise presentem[en]t, et p[ou]r luy faire trouver la chose plus faisable, j’ajoutay qu’elle avoit eté pratiquée dans une des villes du monde où l’eloquence avoit eté autant estimée, car l’histoire nous apprend q[ue] les Atheniens voulant faire travailler à des ouvrages publics, il y eut 2 personnes qui en demanderent l’intendance. Le p[remi]er fit un tres beau discours, et rempli de magnifiques promesses, l’autre se contenta de ce peu de paroles S[ei]g[neu]rs Atheniens, ce que celui cy vient de dire, je le ferai [185]. Pend[an]t que je luy fis ce conte, son esprit luy revint, de sorte qu’il prit la parole dés q[ue] j’eus cessé de parler, et me dit, que le panegyriq[ue] etoit plus difficile qu’on ne l’imaginoit, et q[ue] les choses en etoient venues à un point qu’à moins d’amplifier, on faisoit tort à celui po[ur] qui on composoit un eloge, parce q[ue] le monde etant accoutumé de prendre les loüanges au rabais, on croioit faire assez de justice •à un ho[mm]e de penser qu’il n’etoit pas sot, lors q[ue] son panegyriste se contentoit d’asseurer qu’il avoit beaucoup d’esprit.
(Seneca Quæst[ionum] nat[uralium] l.4 præ[fatio]) [186].
Qu’ainsi on ne venoit jamais à bout de persuader le public du grand merite d’une personne, sans se servir d’un prodigieux entassement de superlatifs, entrelardés d’adverbes, de conjonctions, et d’autres particules convenables. J’en suis d’accord, repliquai je, mais si pour convaincre le public que quelqu’un a de beaux talens, il est necessaire de representer ces talens sous les plus magnifiques mots de la grammaire ; comment pourra t’on loüer dignem[en]t les vertus sublimes et miraculeuses d’un r[oi][?] La difficulté demeure, c’est pourquoi il faudroit mettre le public sur le pied d’expliquer à la lettre les eloges qu’on donne aus gens, et pour cela il seroit absolum[en]t necessaire q[ue] tout ce q[ue] vous etes de panegyristes renonceat à l’amplifica[ti]on ; peut etre q[ue] dans un an vous rameneriés le public à la droitte et naturelle voye de juger du merite d’une personne, q[ui] e[st] de s’attacher precisem[en]t aux termes dont on se sert pour le decrire. Je me trouvai par hazard en humeur de critiquer, ce q[ui] fit que je n’epargnai pas les loueurs de profession, jusques là q[ue] le panegyriste prit la chevre* et me dit q[ue] je devrois reserver une partie de mes railleries contre ceux qui empruntent les pensées d’un autheu[r] sans luy en faire hommage, Je vous entens repliquai je, vous avez remarqué• un trait de Moliere dans ma petite critiq[ue] [187] et parce q[ue] je n’ay pas allegué mon auteur, vous me croiez digne de censure. Mais vo[us] devriez un peu distinguer les tems. En conversa[ti]on, il n’est pas necessaire de citer, et si j’etois po[ur] publier une satyre contre les panegyristes, je vous asseure bien q[ue] je ne me ferois pas honneur du bien d’autruy ; et q[ue] je rapporteroi[s] chaq[ue] chose à sa source. Il n’y a peut etre ho[mm]e sur la terre plus ennemy que moi de ces harpies. Et je ne trouve rien de plus punissable q[ue] l’effronterie d’un autheur qui usurpe un bien qui avoit couté à un autre une infinité de medita[ti]ons. Si on veut se nourrir à la sueur du visage de son prochain, au moins luy faut il payer sa peine et sur tout lors qu’on la peut payer sans mettre la […] car on e[st] quitte de toute obliga[ti]on p[ou]r dire seulement, un tel a dit cela [188]. Quand il est si facile de s’aquitter de son devoir, et qu’on y manque, c’est sans doutte* que l’on a une sotte vanité. Des gens q[ui] font de livres du soir au matin, avec des materiaux qui ont couté cher à d’autres, devroient à tout le moins avoir autant de discretion q[ue] ce jeune debauché de la satyre, q[ui] faisoit conscience de manger des viandes tres difficiles à attraper sans recompenser ceux q[ui] les leur fournissoient
Cenem ego : tu pisces hyberno ex æquore verris
Segnis ego, indignus qui t[an]t[u]m possideam : aufer
Sume tibi decies ; tibi tantundem ; tibi triplex
( Horat[ius] Satyr[arum] 3, l.2) [189]
Le lundy 29 oct[obre] 1674
Il y a si long tems que les œuvres de Boileau paroissent [190] qu’apparemment il en e[st] arrivé des exemplai[res] jusques ches vous. C’est pourquoi je ne vous en parle pas co[mm]e d’une nouveauté[.] Je ferai seulement une reflexion q[ui] a sansdoutte eté deja faitte, et q[ui] sera bonne en tout tems, c’est que les satyriques sont des veritables boutefeux, et des perturbateurs du repos public, en effet ils allument la guerre dans tous les coins du Parnasse, et donnent naissance à cent libelles diffamatoires. Tout cela me direz vous, n’est pas un grand mal, puis qu’outre le plaisir que les personnes desinteressées s’en font, il y a toujours quelque sottise si bien bernée, qu’elle devient pour l’avenir un ecueil ou un banc de sable metave fervidis evitanda rotis [191] , et c’est autant de pris sur les ennemis du bons sens et de la raison. Je vous l’avouë Mr, et c’est ce q[ui] m’a toujours fait approuver la bonne critique. Cepend[an]t il y a si peu de censeurs qui agissent sans haine ou sans envie, qu’on ne voit guere les injures epargnées dans cette sorte d’ecrits. Or ces manieres sont du tout* violentes, car une injure decochée par un poete n’est pas un moindre crime à luy, qu’à un soldat d’avoir frappé de l’epée. Et la raison la voicy c’est que le soldat n’agit pas moins selon la nature que le poete ; l’un et l’autre se sert des armes dont il se sait servir, et si le poete n’employe pas le baton ou l’epée contre son prochain il ne doit pas s’en faire un merite, et on ne doit pas luy en savoir meilleur gré qu’à un loup de ce qu’il ne rue p[oin]t. En un mot un avocat qui menace quelqu’un de luy nuire dans un procez ne temoigne pas moins de haine qu’un gentilho[mm]e qui menace un paysan de coups de baton, et un autheur qui diffame un ho[mm]e dans un livre est aussi coupable de la transgression de la loy de Dieu, qu’un cavalier q[ui] bat son hote [192]. Mais l’autheur n’a pas rompu les bras à personne
Ut neque calce lupus quemq[ua]m neque dente petit bos.
( Hor[atius] Saty[rarum] 1 l.2) [193]
Cela n’y fait rien, il n’est pas propre à cette sorte d’offense, il a d’autres armes offensives qu’il fait bien valoir. Pourquoi se feroit il honneur de n’avoir pas fait une chose dont il n’etoit pas capable[?] Au reste un satyrique dés le moment qu’il a excité la guerre n’a qu’à se bien tenir sur ses gardes, car non seulement ceux qu’il a touchez, le repoussent, mais aussi il s’attire la haine de ceux qu’il epargne.
( Hor[atius] ib[idem] [194] ) [195]
Un censeur des livres d’autruy q[ui] n’est p[oin]t autheur n’a pas tant à craindre, car il e[st] co[mm]e les pyrrhoniens q[ui] drapent* toutes sortes d’opinions sans craindre qu’on drape la leur, parce qu’ils ne s’attachent à pas une[.] V[oir] le liv[re] de lettr[es] p.50 [196][.] Tout de meme q[uan]d on n’est pas autheur, ceux q[ue] vous bernez ne savent par où se venger. C’est pourquoi on les entend souvent dire, q[ue] ces censeurs fassent des livres, on leur fera voir à leur tour leur ignorance. Semblables à ce paysan d’Italie q[ui] presenta un jour requeste au pape tendant à ce qu’il fut permis aux pretres de se marier
Leurs femmes caresser ainsi qu’ils font les notres.
Cette pensée e[st] de Regnier Saty[re] 9 adressée à Rapin [197]. V[oir] Martial
Le mal qu’on voit etre fait à son voi sin, nous oblige de former opposition* à l’aggresseur, encore qu’il ne temoigne pas en avoir à nous, si bien qu’un medisant ne doit pas plus conter sur ceux qu’il peut dechirer par ses railleries, que sur ceux qu’il a effectivement noirci[s].
Dente lacessiti, fuit intactis quo[que] cura
Conditione super co[mmun]i [200] .
( Hor[atius] Episto[larum] 1
Il est vrai qu’il peut arriver que ceux qui ont eté epargnez, aiment mieux jouir de leur bonheur, que s’attirer l’orage sur la tete par trop de prevoyance, qu’il nous suffise, disent ils, d’avoir evité la touche, et n’allons pas provoquer un aversaire qui nous mangera.
Sectamur ultro quos opimus
Fallere et effugere est triumphus [201] .
Od[arum] 4 l.4
Mais on ne raisonne pas toujours ainsi, et la mefiance oblige souvent les moins courageus à prevenir l’attaque, in prælia trudit inerme[m] [202] . Le meilleur coup d’etat que puisse faire un satyrique c’est de ne se commettre pas à un plus fort que soi. On a creu que Boileau s’est servi de cette politiq[ue] envers Moliere à qui il a donné de l’encens avec profusion dans une de ses satyres [203], et ce q[ui] confirme la pensée de ceux qui ont fait ce jugem[en]t c’est que depuis la mort de Moliere, Boileau a publié fort hardiment ce qu’il trouvoit à reprendre dans ses comedies [204]. Quoi qu’il en soit je trouve Boileau fort digne d’excuse, car ay[an]t fait voir par la querelle qu’il a vertement poussée avec Scarron [205], qu’il ne redoutoit pas d’entrer en lice avec de vieux routiers, et des gens de sac et de corde il a peu se menager en suitte. Mr Pelisson en la pref[ace] des Œuvr[es] de Sarraz[in] [206] dit avoir veu un vieux gentilho[mm]e q[ui] ne voioit qu’à peine. P[ou]r cacher ce deffaut à ses amis, il faisoit un effort extraord[inai]re p[ou]r decouvrir sur leurs habits, ou une tache peu considerable, ou un ruban q[ui] ne fut pas en son lieu, ou quelq[ue] autre chose de cette nature ; q[uan]d il leur avoit donné cette preuve qu’il voyoit, il ne faisoit plus d’effort et retournoit avec moins de regret à son etat. C’est plutot fureur que courage que d’attaquer un comedien de la force de Moliere et la partie est toujours mal faitte q[uan]d il la faut soutenir contre un ho[mm]e q[ui] vous peut mettre en comedie, la plus mortelle sausse qui soit. Un comedien a de grans avantages, et riche tant qu’il vous plairra il ne fait quartier à personne non plus que ces plaisans vagabons, et non domiciliez, qui gagnent leur vie en bouffonnant.
Impransus non qui civem dignosceret hoste
Quælibet in quemvis opprobria fingere sæ[v]us [207]
(Hor[atius] Epist[olarum] 15 l.1)
Je ne connoi point d’ho[mm]e qui eut peu aussi justement que Moliere apostropher de cette façon un satyrique
Ignavus adversum lupos ?
Quin huc inanes, si potes vertis minas
Et me remorsurum petis ?
Nam qualis aut Molossus, aut fulvus Lacon
(Amica vis pastoribus)
Agam p[er] altas aure sublata nives
Quæcunque præcedet fera [208] .
( Epod[on] 6)
Horace parloit ainsi à un poete de son tems nommé Cassius Severus. Pour revenir aus poetes comiques, ils ont cela d’importun co[mm]e je l’ay deja dit, qu’ils tournent en ridicule les gens sans fin et sans cesse, au lieu que les bouffons parasites, dés qu’ils ont mordu quelqu’un, ne s’amusent qu’à ronger les os qu’on leur jette.
Projectum odoraris cibum
( Hor[atius] ib[idem]) [209]
Moliere en particulier avoit la raillerie si forte, que c’etoit comme un coup de foudre d’effet quand un ho[mm]e en avoit eté frappé, on n’osoit plus s’approcher de luy, et on le fuyoit
triste iaces lucis evitandumque bidental
Pers[ius] Satyr[arum] 2 [210].
Il perdoit meme une bonne partie de son esprit co[mm]e on le croyoit anciennem[en]t de ceux qui avoient eté frappez de la foudre, e0pibro/nthtoi [211]. Tout cela est arrivé à l’abbé Cotin, car non seulem[en]t la comedie des Femmes scavantes aliena de luy ses amis, mais aussi luy troubla le jugement [212].
Certa sede manet humor et in gena[s]
Furtim labitur[.]
( Hor[atius] Od[arum] 13,
A Rouen le 13 nov[embre] 1674
Enfin me voicy delivré de ma solitude [214]. Je suis à Rouen par la grace de D[ieu] et j’y entens souvent proner les belles actions de nos braves [215]. Mais je trouve toujours le meme mal dont je me suis tant plaint au commencem[en]t de cette lettre, asavoir q[ue] les gazetiers corrompent et pervertissent la verité de tous les grans evenemens, en effet celuy de France dit continuellement q[ue] nous battons les ennemis ; celuy de Hollande qu’ils nous battent par tout, l’un et l’autre accompagnant sa rela[ti]on de tant de circonstances, que les plus hupéz* s’y trompent. Mais il faut avoüer qu’ils nous donnent souvent de[s] combats imaginaires ; non pas qu’on ne se soit effectivem[en]t battu, mais parce qu’on ne l’a pas fait de la maniere qu’ils disent soit à l’egard du lieu, soit à l’egard du nombre des troupes. Les personnes du metier se moquent avec raison d’une gazette q[ui] se mele de parler de l’ordonnance d’une bataille ; et q[ui] le fait souvent si mal qu’il est du tout* impossible q[ue] la chose se soit passée ainsi. De quoi il ne faut pas tant s’etonner, puis que le gazetier n’a pas eté present aus coups, et q[uan]d meme il auroit eté present, il pourroit bien embarrasser sa narra[ti]on dans diverses impossibilitez, co[mm]e il arriva à Callisthenes lequel tout spectateur qu’il avoit eté du combat d’ Alexandre et de Darius aux detroits de Cilicie po[ur] avoir ignoré la tactique (l’art de ranger en bon ordre les batailles) en fit une narra[ti]on q[ui] a eté convaincue d’absurdité, car on a fait voir des impossibilitez en la description qu’il fit de cette journée ( La Mothe Le Vay[er] Disc[ours] de l’hist[oire] ex Polybio [216] l.12) [217]. Sur quoi on peut dire en general qu’un historien ne sauroit emploier trop de diligence po[ur] voir à tout le moins les lieux où les choses se sont passées. Ce qui etoit fort la coutume des Anciens, car ceux q[ui] se meloient d’ecrire l’histoire estoient presq[ue] toujours en voyage, temoin ce passage de Plaute où Messenion dit à Menechme, qu’à moins q[ue] d’etre dans le dessein d’ecrire une histoire, il lui sembloit qu’ils avoient assez couru le monde.
Redimus, nisi si historiam scripturi sumus [218]
Polybe vint expres en Gaule et passa les Alpes, pour pouvoir bien representer le passage d’ Annibal en Italie : il visita toute l’Espagne et sejourna à Carthage p[ou]r bien parler des actions de Scipion. On a loüé dans Salluste, qu’il s’embarqua une fois tout exprés p[ou]r aller reconnoitre en Afriq[ue] les places dont il vouloit donner la description. La Mothe Le Vay[er] Disc[ours] des historiens [219] .
Mais je sens q[ue] la colere me surmonte, je laisse donc là le gazetier, à l’exemple d’ Archytas de Tarente [220] , qui dit un jour à son fermier qu’il l’assommeroit de coups de baton s’il n’etoit pas en colere. Je puis dire que c’est un semblable motif qui me fait rengainer* à l’endroit de la gazete. Il est vrai que vous y entrez aussi Mr, car la crainte que j’aurois de vous fatiguer trop inhumainem[en]t, par une seconde querelle avec les gazetiers, me retient autant que tout autre considera[ti]on. Joint q[ue] n’etant plus en exil, il est juste que je cesse de rever. Et vous voulez bien que pour finir regulierem[en]t une chose qui est toute pleine de fautes, je vous asseure icy p[ou]r conclusion que je suis etc.
Notes :
[1] Il s’agit de Lamberville : voir Lettre 62, n.11.
[2] Virgile, Bucoliques, iii.84 : « Pollion aime [notre Muse, quoiqu’elle soit rustique]. »
[3] Virgile, Bucoliques, v.45 : « Tels sont tes vers pour nous, divin poète ».
[4] Horace, Satires, i.ix.78 : Bayle change servavit, au parfait, du texte en servabit au futur : « c’est ainsi qu’Apollon me sauvera ».
[5] Sur le combat de Seneffe, voir Lettre 64, n.9.
[6] Bayle reviendra souvent sur le thème des gazettes dans ses œuvres : voir Labrousse, ii.23-36, et A. McKenna, « La lecture contradictoire des gazettes par le jeune Pierre Bayle », in Les Gazettes européennes de langue française (XVII e-XVIII e siècles) (Saint-Etienne 1992), p.167-75.
[7] Bayle suit le texte de la Gazette, n o 83, nouvelle datée de Perpignan du 30 juin 1674, p.671-73.
[8] Ces contestations autour des victoires françaises furent lancées surtout lors de la bataille de Seneffe : voir dans la Gazette, l’extraordinaire n° 100 du 22 août 1674 : « Le combat de Senef : ou la deffaite de toute l’arrière-garde d’Espagne, fortifiée des troupes de l’Empereur, et de celles de Hollande : avec la prise de leurs bagages, par le prince de Condé, commandant l’armée du Roy », p.907-22 ; n° 102, nouvelle datée de Paris du 25 août 1674, p.933-34 ; l’extraordinaire n° 103 du 29 août 1674 : « La liste des officiers faits prisonniers sur les ennemis, en la bataille de Senef, avec leurs blesez », p.935-50, et n° 105, nouvelle datée de Versailles du 30 août 1674, p.960-62. Ce thème de la fausseté des gazettes ennemies devient ensuite un leitmotiv des nouvelles dans la Gazette : voir, par exemple, n° 107, nouvelle de Paris du 8 septembre 1674, p.973-74, et n° 110, nouvelle datée de Versailles du 14 septembre 1674, p.997-98, ainsi que n° 125, nouvelle datée de Paris du 3 novembre 1674, p.1122-23, à propos de la bataille d’Entzheim.
[9] Juvénal, Satires, xiii.109-10 : « Car, lorsque, dans une mauvaise cause, l’audace surabonde, elle passe aux yeux de la foule pour honnête assurance. »
[10] Nous n’avons pas pu identifier ou localiser cet écrit latin, probablement une pièce fugitive d’un ou deux feuillets.
[11] Les juifs avaient été expulsés d’Espagne en 1492 : Bayle ironise.
[13] Ce « nous » est révélateur du loyalisme monarchique de Bayle, encore partagé à cette date par la majorité des huguenots, et dont lui-même ne se départira jamais.
[14] Sur la bataille de Sintzheim, le 16 juin 1674, voir Lettre 60, n.5.
[15] Le ravage des campagnes du Palatinat (vingt-sept bourgs et villages systématiquement incendiés) fut ordonné par Turenne dans l’été 1674 ; il n’atteignit pas cependant le degré d’horreur du sac de ce malheureux pays en 1689. L’électeur Karl-Ludwig, formellement allié à l’empereur depuis le 18 mai, adressa le 18 juillet une lettre à Turenne lui proposant un duel, pathétique anachronisme qui, bien entendu, demeura sans effet. Sur les réactions de Mme Palatine, voir Van der Cruysse, Madame Palatine, p.209-10.
[16] Nous n’avons su déchiffrer cette référence trop laconique et obscure, qui renvoie peut-être à des notes personnelles de Bayle.
[17] Nous n’avons su identifier ce « héros de roman ».
[18] Autre référence personnelle aux notes de Bayle : voir n.16.
[19] Cornelius Nepos, Des grands généraux des nations étrangères, xxiii.xiii.3 : « Les guerres [d’Hannibal] ont eu de nombreux historiens et, parmi eux, deux hommes qui ont vécu avec lui dans des camps et ont partagé son existence tant que le sort le lui permit, Silenus et Sosile de Lacédémone ; c’est précisément ce Sosile qu’ Hannibal eut pour maître de langue grecque. »
[20] Bayle renvoie à la partie de la lettre qu’il écrivit le 18 octobre, voir p.342.
[21] Valère Maxime, Faits et dits mémorables, ii.viii.1 : « Pour empêcher que l’avide désir des honneurs ne rendît sans effet une loi si mémorable, on lui donna l’appui d’une seconde loi, que firent voter L. Marcius et M. Caton, tribuns du peuple. Elle punit les généraux qui, dans leurs dépêches au Sénat, se seraient permis de mentir sur le nombre des ennemis tués ou des citoyens restés sur le champ de bataille. Elle les oblige, dès leur entrée à Rome, à jurer devant les questeurs du trésor que, sur le nombre des uns et des autres, leur rapport au Sénat est conforme à la vérité. » Le second mot de la phrase est enim et non nam, et le quatrième mot avant la fin iis, mais il paraît difficile de penser que Bayle citait de mémoire. Il avait sans doute établi un cahier d’extraits et de citations pour son propre usage et les éditions qu’il utilisait ne sont pas exactement les nôtres.
[22] Plutarque, « Vie de Fabius Maximus », vii, Vies, i.382-83. Il s’agit des victoires d’ Hannibal au cours de la seconde Guerre punique, Trebie en 218 et le lac Trasimène en 217 avant J.-C.
[24] Horace, Odes, iv.ix.26-28 : « tous ceux-là sont accablés sans être pleurés, faute d’avoir été célébrés par un poète français ». Bayle omet trois mots après urgentur et il écrit gallo au lieu de sacro.
[25] A peu près toute l’Europe était alors coalisée contre la France, même si quelques Etats restaient en dehors du conflit, en particulier l’Angleterre. Le seul pays allié de la France, la Suède, qui se trouvait sous une minorité, n’avait pas encore pris d’initiative (voir n.105).
[26] Sur le siège de Besançon, voir Lettre 54, n.7. Bayle suit ici l’extraordinaire de la Gazette, n° 55 du 16 mai 1674 : « Journal du siège de Besançon, avec l’ouverture de la tranchée et les autres particularitez de ce siège », p.421-32.
[27] Bayle se réfère de nouveau à la Gazette, n° 57, nouvelles datées du camp devant Besançon du 13 mai 1674, p.441-44 et de Paris du 19 mai 1674, p.444 ; Extraordinaire n° 58 du 23 mai 1674 : « La prise de la ville de Besançon par l’armée du Roy avec la suite du journal de ce siège », p.464-65 ; extraordinaire n° 61 du 30 mai 1674 : « La prise de la citadelle de Besançon […] avec tout ce qui s’y est passé de plus remarquable » ; et n° 62, nouvelle datée de Besançon du 27 mai 1674, p.493-95.
[28] Candie (actuellement, Hêraklion), capitale de la Crète. Dès 1644, cette île, possession vénitienne, fut menacée par les Turcs, qui la conquirent progressivement. La capitale fut assiégée en 1645, mais ne tomba aux mains des Ottomans qu’en septembre 1669. Peu auparavant, Louis XIV avait envoyé au secours des assiégés quelques troupes, qui arrivèrent fin juin et dont le départ, fin août, détermina le général vénitien Morosini à capituler et à signer un traité de paix : voir Ch. de Terlinden, Le Pape Clément IX et la guerre de Candie (1667-1669) (Louvain 1904). Le départ du contingent français, commandé par Navailles, la flotte l’étant par Vivonne, s’explique par bien des raisons : la mésentente entre Français et Vénitiens, la situation désespérée de la ville assiégée, les relations diplomatiques privilégiées de la France avec l’empire turc, et enfin le désir de paix de Venise, lassée par une guerre coûteuse et interminable. Reste que l’opinion française n’était pas du tout préparée à l’issue peu glorieuse de l’entreprise. Dans la Gazette, un flot de dépêches optimistes, ordinaires et extraordinaires, couvrent les événements depuis n° 77, nouvelle de Venise du 8 juin 1669, jusqu’au constat et au bilan amer de la défaite dans l’ordinaire n o 135, nouvelle de Venise du 28 octobre 1669. Bayle aura peut-être lu l’ Histoire curieuse du siège de Candie (Amsterdam 1671, 12°, 2 vol.) de François-Savinien d’Alquié, un auteur qu’il mentionne à propos d’un autre de ses livres un peu plus bas (voir n.102).
[29] Le singulier est une inadvertance.
[30] Nicolas Fouquet (1615-1680), surintendant des finances, fut accusé de malversations par Colbert (acharné à la perte d’un homme en qui il voyait un rival) et arrêté le 5 septembre 1661. Son procès dura longtemps et, le 20 décembre 1664, ses juges, sur qui de fortes pressions avaient été exercées par le gouvernement qui aurait souhaité la peine capitale, condamnèrent l’ex-surintendant au bannissement. Le roi aggrava ce verdict en emprisonnement perpétuel et fit incarcérer Fouquet au fort de Pignerol, où il devait mourir après onze ans de détention. Fouquet s’était énergiquement défendu et ce procès célèbre donna lieu à la publication de nombreux factums. Le Recueil des défenses de Monsieur Fouquet (Amsterdam 1665-1667
[31] Un procureur était un officier de justice qui représentait une des parties en conflit devant un tribunal. Il rédigeait les pièces du procès en se conformant aux usages de la procédure, qui comportaient quantité de formules stéréotypées et imposaient à l’exposé un ordre déterminé.
[32] Tous ces termes appartiennent à la technique des sièges et au vocabulaire des fortifications destinées à contrarier les efforts des assiégeants. Une demi-lune est un ouvrage presque triangulaire se composant de deux faces formant un angle saillant vers la campagne, et de deux demi-gorges prises sur la contrescarpe de la place, la contrescarpe étant la pente du mur extérieur du fossé. Les demi-lunes étaient destinées à couvrir le débouché d’un pont ou d’une porte. Les bastions étaient de grands corps de terre disposés en pointe sur les angles saillants de la place et comportaient des faces et des flancs ; ils étaient désignés par un toponyme, selon les villes, que les gazetiers mentionnaient dans leurs récits. Une des techniques des assiégeants consistait à creuser des tunnels afin de placer des mines sous les défenses de la place attaquée. Le public français s’était familiarisé avec tout ce vocabulaire particulier, car Louis XIV avait une grande inclination pour la guerre de siège, de sorte que les gazettes étaient remplies de détails à ce sujet.
[33] Sur les conférences entre protestants et catholiques en France, voir E. Kappler, Conférences théologiques entre catholiques et protestants en France au XVII e siècle (thèse Université de Clermont II, 1980 ; Paris 2011), dont la bibliographie est très complète. Bayle décrit bien l’issue toujours indécise de telles rencontres, qui incita les autorités à faire usage de méthodes plus musclées.
[34] Bayle utilisera les mêmes termes à propos de la satire et de la flatterie dont se servent le gazetier et l’historien : voir DHC, « Marillac » (2 e art.), rem. A, et Whelan, The Anatomy of superstition, p.78.
[35] Bayle reviendra sur ce thème des « autheurs contemporains » : voir DHC, « Esope » (1er article), rem. B, et Whelan, The Anatomy of superstition, p.136-37.
[36] Bayle revient au combat de Seneffe : voir ci-dessus, p.301-303.
[37] L’expression « c’est courir un danger d’écrire contre ceux qui peuvent nous proscrire » ne vient pas d’un auteur ancien. Bayle se souvient peut-être ici du second vers d’un monostique en vers trochaïques d’un auteur néo-latin inconnu : « Non facile est in illum scribere qui potest proscribere. » Il se lit (ii.2, p.680, colonne 2) dans un ouvrage de Janus Gruter (1560-1627) : Florilegii magni seu Polyantheæ Tomus secundus (Argentorati 1624, folio, en deux parties). Cette anthologie est présentée comme une seconde partie par référence à la Polyanthea de Domenico Nani Mirabelli, 1re éd. 1507, mainte fois rééditée avec des corrections et des additions. Dans le DHC, « Gruterus », rem. I, Bayle mentionne l’édition de la Polyanthea procurée par Joseph Lang (Langius) : (Lugduni 1604, folio, puis Francofurti 1607, folio).
[38] Bayle retournera à l’idée des « fables dont les gazettes sont remplies » dans les DHC, « Guicciardin », rem.B.
[39] Basnage était à cette date un partisan décidé des Anciens (voir Lettre 29, n.70), tandis que Bayle se rangeait plutôt dans le camp des Modernes (voir Lettre 29, n.44), Minutoli jouant le rôle d’arbitre. A cette date, la Querelle ne concernait que l’esthétique littéraire et ne mettait pas encore en jeu la notion de progrès général de l’Europe, que la philosophie de l’histoire de Bayle n’avalisera pas.
[40] Le « médium » ou « moyen terme » désigne l’élément d’un syllogisme qui est commun à la majeure et à la mineure ; d’où fondement de preuve, inférence, argument.
[41] Bayle sera préoccupé tout au long de sa vie par la polémique autour de la légitimité de la Réforme : voir par exemple Critique générale, viii, ix, xi ;
[42] Voir Molière, Le Malade imaginaire, acte ii, sc.v, le portrait de Thomas Diafoirus : « On n’est obligé qu’à traiter les gens dans les formes [et non pas à les guérir] », et acte iii, sc.iii, le portrait de M. Purgon ; voir aussi Dom Juan, acte iii, sc.i et Monsieur de Pourceaugnac, acte i, sc.v. C’est un trait satirique courant à cette époque dans le portrait des médecins : voir A. Gill, « `The doctor in the farce’ and Molière », French studies, 2 (1948), p.101-28 ; H.G. Hall, « Satire of medecine : fact and fantasy », in idem, Comedy in context : essays on Molière (Mississippi 1984), p.101-15.
[43] Cicéron, Des devoirs, i.xxiv.83 : « Quand la maladie est légère, les médecins la traitent avec douceur ; dans les cas graves, ils sont obligés d’avoir recours à des remèdes périlleux et d’un succès incertain ». Bayle modifie légèrement le texte de Cicéron, qui porte medicorum au lieu de medici.
[44] Nous n’avons pas trouvé cette anecdote dans les œuvres de La Mothe Le Vayer.
[46] Cicéron, Des devoirs, i.xxiv.83 : « Souhaiter l’adversité de la tempête dans le calme, c’est de la folie, tandis que remédier à la tempête par n’importe quel moyen, c’est de la sagesse, surtout si l’on gagne plus dans le règlement de l’affaire qu’on ne perd à hésiter. »
[47] Voir Cicéron, Caton l’ancien, vi.11 : « étant augure, il osa dire qu’on agissait sous d’excellents auspices en agissant pour le salut de l’Etat et qu’on était contre les auspices en étant contre l’Etat ». Bayle écrit fierent et fieri pour ferrentur et ferri.
[48] Cicéron, Des devoirs, iii.vi.31-32 : « Ainsi remplit-il toujours sa fonction d’homme travaillant pour le bien commun de la société humaine. » Et, un peu plus haut (vi.30) : « il est contraire à la nature de déserter la cause commune ». Bayle met fungitur pour fungetur.
[49] « Le salut du peuple doit être la loi supérieure à toute autre » : voir Cicéron, Des lois, iii.iii.8. Cette maxime est rattachée traditionnellement (mais non pas par Cicéron lui-même) à la Loi des Douze Tables, premier code de la loi romaine, connu uniquement par des citations et des allusions.
[50] Gabriel Naudé, La Science des princes, ou considérations politiques sur les coups d’état (Rome 1639, 4 o), qui montre en lui un disciple de Machiavel. Bayle ne disposa pas de cette première édition, mais cite, dans le DHC, celle que procura Louis Du May (s.l. 1673, 8 o). Naudé cite le dicton salus populi dans les premières pages de son chapitre iii. Au reste, l’expression « coup d’Etat » n’avait pas alors le sens actuel ; elle désignait des « actions hardies et extraordinaires que les princes sont contraints d’exécuter aux affaires difficiles et comme désespérées, contre le droit commun, sans garder même aucun ordre ni forme de justice, hazardant l’intérêt du particulier pour le bien public » (éd. 1667, p.103-104). Ainsi, la Saint-Barthélemy est un exemple-type du « coup d’Etat » selon Naudé, c’est-à-dire action des autorités et non pas action contre celles-ci.
[51] Il s’agit peut-être de Maximilien II, depuis 1564 empereur du Saint-Empire romain. Maximilien était tombé gravement malade en quittant Trente à l’époque du grand concile de l’Eglise. Catholique lui-même, mais très tolérant à l’égard des protestants, il était convaincu qu’il avait été empoisonné par son hôte à Trente, incité par les agents de son cousin, Philippe d’Espagne.
[52] Formule de logique. On accepte de discuter sur la base d’une donnée avancée par l’adversaire, mais dont, par ailleurs, on se réserve de discuter le bien-fondé. Autrement dit, on estime pouvoir réfuter son adversaire, même en partant de ses propres prémisses. Bayle utilisera souvent ce mode d’argumentation.
[53] En termes de fortification, un ouvrage à corne est une pièce extérieure, dont la tête est fortifiée de deux demi-bastions joints par une courtine et fermés des deux côtés par des ailes parallèles l’une à l’autre. Ravelin est synonyme de demi-lune. Un demi-bastion est un ouvrage qui ne se compose que d’un flanc et d’une face. Sur la définition de demi-lune et de bastion, voir ci-dessus, n.32.
[54] Juvénal, Satires, i.89-90 : « Ce n’est plus avec quelques bourses que l’on s’en va à la table de jeu : on y apporte, on y risque son coffre-fort. »
[55] Un battoir était une raquette rigide, semblable à une batte de ping-pong. La raquette garnie de cordes ou de boyaux présentait des avantages sur le battoir. Accepter de jouer avec ce dernier instrument contre un adversaire qui se servirait d’une raquette, c’était accepter un handicap.
[56] Molière, Le Bourgeois gentilhomme, ii.2 : la servante Nicole dit à M. Jourdain : « Battez-moi plutôt, et me laissez rire tout mon soûl. »
[57] Allusion à la fameuse règle des trois unités (de temps, de lieu et d’action) qui a régi la tragédie classique française. Bayle emploie ici le mot « comédie » au sens large d’œuvre théâtrale.
[58] « La question est de savoir si, en vertu de sa puissance obédientielle, une pierre peut accéder à la vision béatifique, ou si l’existence de Dieu dépend à tel point de la possibilité de celle de la mouche que, si la mouche avait été impossible, Dieu n’aurait pas existé ». Voir DHC, art. « Dicéarque (disciple d’Aristote) », rem. M. Sur le sens de l’expression « puissance obédientielle » chez les médiévaux, voir E. Gilson, L’Esprit de la philosophie médiévale (2 e éd., Paris 1944), p.359-64. Il s’agissait de rendre compte du miracle en invoquant la potentialité inhérente à la nature créée de devenir ce que Dieu pourrait vouloir qu’elle devienne. Avec beaucoup de ses contemporains, Bayle ne voyait que verbalisme creux dans le vocabulaire théologico-philosophique médiéval et dans les exemples singuliers proposés par les auteurs scolastiques, qui n’ont de sens que replacés dans leur contexte.
[59] Utrum a ici le sens de « savoir si… ». Bayle cite la première question de la « chresme philosophale des questions encyclopédiques de Pantagruel », incluse pour la première fois dans les Œuvres (Lyon 1565, 16 o) de Rabelais et dont la critique actuelle récuse l’attribution à Rabelais : voir S. Rawles et M. A. Screech, A new Rabelais bibliography (Genève 1987), p. 22, 327-30.
[60] Horace, Epîtres, i.xviii.15-20 : « Cet autre est tout prêt à se battre si l’on dit devant lui "laine" et non "poils" de chèvre ; il fait flèche de sottises : "Oui ou non n’est-ce pas moi d’abord qu’il faut croire ?" et "Que je ne crie pas de toutes mes forces pour proclamer mon opinion ? Je ne le voudrais pas même si on me donnait en récompense une seconde vie !" Et quel est l’objet de la discussion ? C’est de savoir lequel est le plus habile de Castor ou de Docilis, ou quelle route il vaut mieux prendre pour aller à Brindes, la voie Minucia ou la voie Appienne. » Bayle déforme le nom de Minucius.
[61] Bayle s’inspire librement de quelques vers de la Première satire de Boileau : vers 4 : « [Damon] Passe l’été sans linge et l’hiver sans manteau » ; vers 77-78 : « Tandis que Colletet, crotté jusqu’à l’échine / S’en va chercher son pain de cuisine en cuisine ». Le quatrième vers semble bien être de la composition de Bayle.
[62] Mathurin Régnier (1573-1613), Satires, ii.39-48.
[63] Encore une référence abrégée, qui désigne sans doute un recueil personnel : voir ci-dessus notes 16 et 18.
[64] Bayle se fait ici l’écho d’une légende. En fait, l’ Hippocratis ac Galeni libri aliquot (Lugduni 1532, 16 o) connut deux éditions ultérieures, en 1543 et 1545, ce qui prouve que le livre avait trouvé des acheteurs. En principe, les médecins avaient au moins une teinture de grec, mais une traduction latine de leurs autorités essentielles était assurément précieuse à beaucoup d’entre eux, d’autant que l’édition procurée par Rabelais fournit aussi l’original grec. Bayle se trompe aussi en croyant que l’ouvrage comportait des commentaires.
[65] « De Ente in communi » signifie : « De l’être en général ».
[66] Dans la Théodicée, i, §88, Leibniz définira l’éduction comme l’action par laquelle les formes sont tirées de la puissance de la matière.
[67] Antonin Ravaille (1605 ?-1676), en religion, Antonin Regnault, dominicain, apprécié par les jansénistes : voir E. D. James, « The problem of sufficient grace and the Lettres provinciales », French studies 21 (1967), p.207. Ses Doctrinæ divi Thomæ Aquinatis tria principia, cum suis consequentiis, ubi totius doctrinæ compendium et connexio continetur (Tolosæ 1670
[68] Théophile Raynaud (1583-1663), S.J., fut un auteur d’une exceptionnelle abondance : ses Opera omnia (Lugduni 1665-1669) ne couvrent pas moins de vingt volumes in-folio, édition faite aux frais de Charles-Emmanuel II, duc de Savoie. C’est le Père Jean Bertet (1622-1692), initialement jésuite puis, après 1681, bénédictin, qui surveilla cette édition monumentale ; aussi est-ce à lui qu’on attribue une Instruction pour se servir des ouvrages du Père Théophile Raynaud, à laquelle on a joint le détail de toutes les traverses qu’il eut à essuyer pendant cette impression : voir Sommervogel, i.1375 ; le savant bibliographe ne donne pas d’autre indication sur cet opuscule introuvable. Bayle consacrera à Théophile Raynaud l’article 6 des NRL du mois de juillet 1685, et, dans la CPD, il le citera comme source pour la liste des Pères qui auraient soutenu que « l’athéisme n’est pas la pire de toutes les opinions » ( CPD éd. Rotterdam 1705, ch.77, et OD, iii.297).
[69] « Auxquels ils ne sauraient résister. »
[70] Le Tartuffe ou l’imposteur, comédie de Molière avait été joué pour la première fois, en trois actes seulement, le 12 mai 1664, et en entier le 29 novembre 1664, et publié en mars 1669. Le nom du personnage était très vite entré dans la langue comme synonyme de faux dévot et d’hypocrite.
[71] Juvénal, Satires, ii.16-21 : « Je rends les destins responsables quand je vois cet homme qui avoue son mal par son air et sa démarche. Voilà des gens dont la franchise est digne de pitié et que leur folie même excuse ; ils sont bien pires ceux qui, contre de tels vices, s’emportent avec des exclamations, et qui, parlant de vertu, remuent le derrière : “Je te révérerais, Sextus, toi qui te tortilles ?” »
[72] Voir Jacques Moisant de Brieux, Epistolæ (Cadomi 1670
[73] Georges Guillet de Saint-Georges (1625-1705), Lacédémone ancienne et nouvelle, où l’on voit les mœurs et les coutumes des Grecs modernes, des Mahometans et des Juifs du pays, par le sieur de La Guilletière (Paris 1676
[74] Georges Guillet de Saint-Georges (1625-1705), Lacédémone ancienne et nouvelle, où l’on voit les mœurs et les coutumes des Grecs modernes, des Mahometans et des Juifs du pays, par le sieur de La Guilletière (Paris 1676
[75] Nous n’avons su interpréter cette formule abrégée de Bayle, et, au surplus, le recueil auquel elle semble renvoyer pourrait être un cahier manuscrit personnel : voir ci-dessus, n.72,
[76] Les observations d’auteurs anciens sur la vie et les mœurs de Sénèque qui seront citées dans les notes qui suivent sont toutes tirées de Johann Heinrich Meibom [Maybaum], médecin de Lübeck, Maecenas, sive de C. Clinii Maecenatis vita, moribus et rebus gestis (Lugduni Batavorum 1653, 4 o).
[77] Dion Cassius, Histoire romaine, lxi.10 : « Il [Sénèque] eut commerce avec Agrippine, la mère de Néron ; dans la plupart des cas il agit de façon contraire à celle qu’il avait préconisée dans sa philosophie. Ainsi, il blâmait les richesses, mais possédait trois mille sesterces ; il condamnait le luxe des autres, mais était en possession de cinq cents trépieds en bois de cèdre, à pieds d’ivoire, et tous de la même dimension, qu’il aurait utilisés pour ses dîners ; il exécrait les flatteurs et honorait les reines et les affranchis, dont il composait des panégyriques ; il condamnait la tyrannie et fut le maître d’un tyran, et incita enfin son disciple Néron à faire disparaître sa mère, et fit beaucoup d’autres choses suivant son bon plaisir. »
[78] « Suillius, dans Tacite ( Annales, xiii.42), estime justifié l’exil qui, sous le règne de Claude, frappa ce Sénèque qui avait apporté l’adultère dans la maison et le lit de Germanicus, ce corrupteur des princesses, cet homme qui avait pu amasser en quatre ans de faveur royale trois mille sesterces. A Rome [Sénèque] prenait en quelque sorte dans ses filets les vieillards sans héritier ; l’Italie et les provinces étaient épuisées par son usure sans limite. » La référence abrégée de Bayle désigne sans doute un recueil personnel (voir n.72).
[79] « [ Sénèque] se reproche à lui-même ( De la vie heureuse, xvii.2) que ses terres sont plus cultivées que ne réclament les besoins naturels et que son mobilier est trop élégant. Sa femme porte aux oreilles le revenu d’une maison opulente et ses jeunes esclaves sont habillés d’étoffes précieuses ; le service de table est un art chez lui, et, au lieu que l’argenterie soit distribuée au hasard et capricieusement, il veut tant de raffinement dans le service qu’il a un écuyer tranchant ; il possède des domaines outre-mer plus nombreux qu’il ne le sait et il a des esclaves plus que la mémoire ne pourrait en connaître. »
[80] « Pour ne rien dire de ce que Fenius Rufus et Sofonius Tigellinus reprochent au même Sénèque dans Tacite ( Annales, xiv.52) au sujet de ses immenses richesses, de sa chasse à la faveur populaire, de la beauté de ses jardins (dans Juvénal, Satires
[81] « De toutes ces choses, pourtant, lui-même ne s’est pas autrement disculpé qu’en disant qu’il n’avait pas le droit de s’opposer aux dons de Néron. Sans compter qu’il fut associé au complot de Pison contre Néron, et qu’il aurait usurpé l’empire au moyen d’assassinats (si seulement il avait fait ce qu’il fallait pour que fussent tués d’abord Néron par Pison, puis Pison lui-même) – selon ce même Tacite, Annales, xiv.7 et xv.56 et 65, et Dion, [ Histoire romaine], lxii.[12-13], d’après Xiphilin. »
[83] Meibom, Mæcenas, xxii.4, p.132-33. Le savant allemand ne cite pas ses auteurs tout à fait littéralement, et parfois les abrège, mais les petites libertés qu’il prend avec les textes n’en modifient pas la signification.
[84] Apparemment, Bayle renvoie ici à la lettre latine de Paul Thomas, sieur de Girac, à Guez de Balzac, origine d’une longue polémique entre Costar et Girac (voir Lettre 29, n.3). Sur les points de la discussion concernant Homère : voir Hepp, Homère en France, p.314-15. Toutefois, pour adopter cette conjecture fort plausible, il faut résoudre deux difficultés mineures. D’une part, Bayle renvoie à une Dissertatio super Homero ; or, la lettre de Girac à Balzac, quand elle fut imprimée, le fut sous le simple titre de
[85] Apparemment, Bayle renvoie ici à la lettre latine de Paul Thomas, sieur de Girac, à Guez de Balzac, origine d’une longue polémique entre Costar et Girac (voir Lettre 29, n.3). Sur les points de la discussion concernant Homère : voir Hepp, Homère en France, p.314-15. Toutefois, pour adopter cette conjecture fort plausible, il faut résoudre deux difficultés mineures. D’une part, Bayle renvoie à une Dissertatio super Homero ; or, la lettre de Girac à Balzac, quand elle fut imprimée, le fut sous le simple titre de
[86] Voir Plutarque, « Caton le censeur », §xxxvii, i.778.
[87] Cicéron, Tusculanes, v.119 : « Tout ce que nous appelons moralité et honneur est [aux yeux des philosophes] une entité chimérique embellie du son de mots vides de sens. » Nousconjecturons que la référence abrégée de Bayle « rec. de serm. », au milieu de cette citation, désigne un recueil personnel : « recueil de sermone » ou peut-être « recueil de sermons ». Voir aussi, sur ce point, ci-dessous, n.166.
[88] Horace, Epodes, vii.11-12 : « Ce n’est pas ainsi qu’agissent les loups et les lions : jamais ils ne luttent que contre des animaux d’une autre espèce que la leur. »
[89] Juvénal, Satires, xv.159-165 : « Mais aujourd’hui les serpents s’accordent mieux que les hommes ; la bête fauve épargne les bêtes à qui l’apparente sa robe tachetée. Vit-on un lion, parce qu’il était le plus fort, arracher la vie à un autre lion ? Dans quelle forêt un sanglier expira-t-il sous la dent d’un sanglier plus grand que lui ? La tigresse des Indes, malgré sa férocité, vit avec le tigre dans une paix perpétuelle ; les ours cruels s’arrangent entre eux. Mais pour l’homme […] ».
[90] Voir DHC, « Barbe », rem. C, où Bayle reprend et l’historiette de Barbe de Cilicie, épouse de l’ empereur Sigismond, et le lieu commun de la comparaison des comportements humain et animal.
[91] François Poulain de La Barre (1647-1723), aux sympathies cartésiennes, passa au protestantisme en 1688 et s’établit à Genève. De l’excellence des hommes, contre l’égalité des sexes (Paris 1675, 12 o), ouvrage anonyme, n’est pas, en fait, une rétractation du livre antérieur du même auteur, également anonyme : De l’égalité des deux sexes, discours moral et physique où l’on voit l’importance de se défaire des préjugés (Paris 1673, 12 o) : voir Bayle, DHC, « Marinelle » et, Poulain de La Barre, De l’égalité des deux sexes, De l’éducation des dames, De l’excellence des hommes, éd. M.-F. Pellegrin (Paris 2011).
[92] François Poulain de La Barre (1647-1723), aux sympathies cartésiennes, passa au protestantisme en 1688 et s’établit à Genève. De l’excellence des hommes, contre l’égalité des sexes (Paris 1675, 12 o), ouvrage anonyme, n’est pas, en fait, une rétractation du livre antérieur du même auteur, également anonyme : De l’égalité des deux sexes, discours moral et physique où l’on voit l’importance de se défaire des préjugés (Paris 1673, 12 o) : voir Bayle, DHC, « Marinelle » et, Poulain de La Barre, De l’égalité des deux sexes, De l’éducation des dames, De l’excellence des hommes, éd. M.-F. Pellegrin (Paris 2011).
[93] Antonio Beccadelli, dit Panormita (1394-1471), célèbre humaniste, aura un article dans le DHC, ainsi qu’ Alphonse V, roi d’Aragon et de Naples : voir Parallela Alphonsiana sive Apophtegmata Cæsarum principumque Germanorum et aliorum, Alfonsi regis dictis et factis memorabilibus, per Antonium Panormitam descriptis, sigillatim opposita per ∆neam Sylvium Piccolomineum, episcopum Senesem, qui postea Pius II (Hanoviæ 1611, 4 o), p.55-56, où plusieurs apophtegmes sont cités qui font la comparaison du comportement humain et animal, et, parmi eux, celui de la veuve de l’ empereur Sigismond (voir ci-dessus, n.88). Les références de pages données par Bayle correspondent à l’édition de 1611 ; la première édition est de 1485.
[94] Claude Joly (1607-1700), chanoine de Notre-Dame de Paris : Voyage fait à Munster en Westphalie, et autres lieux voisins en 1646 et 1647 (Paris 1670, 12 o), p.200-201 ; Joly parle d’un éléphant amené à l’hôtel de Longueville à Münster (où Longueville était l’un des plénipotentiaires français) ; cet épisode poussa Joly à recueillir des informations sur l’éléphant, d’où un « Discours sur l’éléphant », où Joly cite saint François de Sales, qui propose l’éléphant comme exemple de chasteté : voir Introduction à la vie dévote, iii, 39 : « De l’honnesteté du lit nuptial », dans Œuvres, éd. A. Ravier et R. Devos, Paris 1969, p.243.
[95] Claude Joly (1607-1700), chanoine de Notre-Dame de Paris : Voyage fait à Munster en Westphalie, et autres lieux voisins en 1646 et 1647 (Paris 1670, 12 o), p.200-201 ; Joly parle d’un éléphant amené à l’hôtel de Longueville à Münster (où Longueville était l’un des plénipotentiaires français) ; cet épisode poussa Joly à recueillir des informations sur l’éléphant, d’où un « Discours sur l’éléphant », où Joly cite saint François de Sales, qui propose l’éléphant comme exemple de chasteté : voir Introduction à la vie dévote, iii, 39 : « De l’honnesteté du lit nuptial », dans Œuvres, éd. A. Ravier et R. Devos, Paris 1969, p.243.
[96] Virgile, Géorgiques, iii.217-223 (au troisième vers, le texte de Virgile porte Sila et au dernier vers, longus et non magnus : ce sont des variantes de manuscrits) : « [Par ses doux attraits, la femelle] force des amants, rivaux intransigeants, à se battre à coups de cornes. La belle génisse paît dans le grand massif forestier ; eux, s’attaquant tour à tour, engagent de violents combats et se criblent de blessures ; un sang noirâtre baigne leurs corps ; front contre front, ils se heurtent, cornes en avant, avec un vaste mugissement que renvoient les forêts et le lointain Olympe. »
[97] Allusion à Samson, qui tua mille Philistins avec une mâchoire d’âne, Jg. xv.15 : « c’est une entreprise au-dessus des forces humaines ».
[98] Horace, Satires, i.iii.107-110 : « Bien avant Hélène, les hommes s’étaient sauvagement disputé la possession des femmes ; mais ils ont péri d’une mort ignorée, ceux qui, dérobant à la façon des bêtes un plaisir de hasard, furent massacrés par plus vigoureux qu’eux, comme dans le troupeau le taureau abat son rival. »
[99] L’emploi de la forme vieillie
[100] Horace, Satires, ii.iii.103 : « L’exemple ne prouve rien, qui ne résout un problème qu’en en posant un autre. »
[101] Ovide, Métamorphoses, x.323-331 (il s’agit de l’épisode de Myrrha) : « Mais la piété filiale, dit-on, ne condamne pas ces amours et tous les autres animaux s’accouplent sans choix ; il n’y a point de honte à une génisse à sentir son père peser sur ses reins ; le cheval fait de sa fille, son épouse ; le bouc féconde les chèvres qu’il a engendrées et, du germe dont il a été conçu lui-même, l’oiseau conçoit à son tour. Heureux les êtres qui jouissent de ce privilège ! Les scrupules de l’homme ont créé des loix malfaisantes et, ce que la nature permet, des arrêts jaloux l’interdisent. » Dans le manuscrit, le mot concepta est incertain ; on lirait plutôt reperta (inventé, créé) ou repetita (dérivée).
[102] Voir Pr. vi.6.
[104] Horace, Satires, i.i.36-38 (même référence que dans la note précédente) et
[105] Les Œuvres de Q. Horace Flacce, latin et françois, de la traduction nouvelle de Robert et Anthoine Le Chevallier d’Agneaux freres (Paris 1588, 8 o). Il y eut deux impressions la même année, avec pages de titre un peu différentes. L’ouvrage est divisé en trois parties, dont la seconde possède un titre propre : Les Sermons ou satyres de Q. Horace Flacce. La troisième partie, sans page de titre particulière, contient les Epîtres et l’ Art poétique. Nos références ultérieures (n.103, 107-13, 119, 131) concernent cette traduction.
[106] François-Savinien d’Alquié (dates inconnues), médecin et voyageur, Les Délices de la France, avec une description des provinces et des villes du royaume (Paris 1670, 12 o, 2 vol.). Bayle en cite ii.46. L’ouvrage reparut, augmenté, dès l’année suivante : Les Délices de la France, où il est traité de l’estat present de ce royaume, de son gouvernement, de ses officiers et de sa politique. Ensemble, les raretezde ses provinces et tout ce qu’il y a de plus curieux dans chacune de ses villes (Paris 1671
[107] Horace, Satires, i.ii.114-122 ; traduction, ii, 9 r de l’édition citée des frères Le Chevallier d’Agneaux , ci-dessus, n.101.
[108] Il y a ici un contresens sur la traduction de Galli : Horace fait allusion aux prêtres de Cybèle, des efféminés, mais, avec ses contemporains, Bayle traduit
[109] Par un traité signé le 14 avril 1672, la Suède s’était engagée à s’opposer à l’intervention de l’empereur, d’abord par voie amiable, puis, en cas d’insuccès, par les armes, au cas où celui-ci se déciderait à soutenir militairement les Provinces-Unies contre la France. Or, l’Empire avait déclaré la guerre à la France, en même temps que le faisait l’Espagne, à la fin de l’été 1673. Un congrès de diplomates, réunis à Cologne, ne put aboutir à un accord entre les belligérants ; l’enlèvement d’un plénipotentiaire français, Guillaume Egon de Fürstenberg, par les Impériaux, en février 1674, arrêta les pourparlers. Tout à la fin de 1674, les Suédois se décidèrent à attaquer le Brandebourg, sous le commandement de Gustave Wrangel (1613-1676), une offensive dont l’opinion française attendait beaucoup, mais qui allait tourner court après la défaite suédoise à Fehrbellin, le 28 juin 1675, qui couronna une contre-offensive brandebourgeoise. A cette date, Wrangel était vieux et infirme : ses infirmités l’empêchèrent de rejoindre rapidement ses troupes – d’où l’anecdote citée ici par Bayle. En effet, lors des défaites suédoises à Havelberg et à Fehrbellin, Wrangel était encore loin de son armée : il se retirera ensuite et mourra en juillet 1676 : voir Gazette, n o 124, nouvelle de Hambourg du 14 octobre 1674, et n o 138, nouvelle de Hambourg du 6 décembre 1674, ainsi que la Lettre 100, n.11 et 12.
[118] Ces vers de Marot sont cités par Gilles Ménage, Observations […] sur la langue françoise (Paris 1672, 12 o), ch. 39 : « Mors, mordu : tors, tordu : ponds, pondu », p.79 (2e éd. i, ch.40, p.90). Les vers de Marot (Epigramme xli, dans Œuvres complètes, éd. Grenier, s.d., ii.16-17) ont été légèrement modifiés par Ménage : vers 2 : sa femme (et non dame), et, à l’avant-dernier vers : Or ça (et non Adonc). Par ailleurs, Ménage a omis deux vers, peut-être jugés par lui trop libres : « Elle y consent, il s’escarmouche / Et après qu’il l’eut deshousée […] », et il modernise, au vers 7, l’orthographe de « rousée ».
[119] Pierre Borel (1620-1671), médecin de Castres, Trésor de recherches et antiquitez gauloises et françoises reduites en ordre alphabetique et enrichi de beaucoup d’origines, epitaphes et autres choses rares et curieuses, comme aussi de beaucoup de mots de la langue thyoise et theuthfrancque (Paris 1655, 4 o), p.12 (« alucher ») et p.29, citation du Codicille et testament de Jean de Meung , 1 re éd. (Paris 1500), vers 1725-1726 et 1785-1787 : voir Lettre 139, qui laisse penser que cette dernière référence serait sensiblement postérieure à la composition de la lettre à Minutoli.
[120] Aulu-Gelle, Nuits attiques, i.i.1-3. Il s’agit du philosophe Pythagore.
[121] « On reconnaît le lion à sa griffe. »
[122] Horace, Satires, ii.iv.38-39 : « [et on ignore quels poissons doivent être grillés] pour remettre sur le coude les convives alanguis ».
[124] Horace, Satires, ii.iii.117-119 : « Et encore, cet homme de soixante-dix-neuf ans qui couche sur la paille, pendant que dans son armoire ses matelas pourrissent, mangés aux teignes et aux mites. »
[125] Horace, Satires, ii.iii.104 et suivants : « Si quelqu’un achetait des cithares et, après les avoir achetées, s’en formait une collection, sans avoir aucun goût pour la cithare, … [tout le monde serait en droit de le traiter de fou]. »
[126] C’est un renvoi au paragraphe qui achève la partie du texte écrite le 13 octobre : voir p.329.
[127] C’est un renvoi au paragraphe qui achève la partie du texte écrite le 13 octobre : voir p.329.
[128] Horace, Satires, ii.iv.36 : « si l’on n’est passé maître dans la science subtile des saveurs ».
[129] Horace, Satires, ii.vi.86-87 : « cherchant à vaincre, par la variété des mets, les dégoûts de son ami qui touchait à chaque plat du bout des dents ».
[130] Horace, Satires, ii.ii.42-44 : « Mais d’ailleurs le sanglier, le turbot prennent, tout frais, une odeur forte pour l’estomac malade que fatigue une abondance funeste lorsque, trop plein, il préfère le radis noir et l’aunée préparée au vinaigre. »
[131] « Le meilleur assaisonnement, c’est l’appétit. » Cicéron, Des termes extrêmes des biens et des maux, i. i.xxviii.90, cite ce dicton sous une forme un peu différente (« cibi condimentum esse famem ») et l’attribue à Socrate ; il figure dans les Adages d’Erasme, II. vii.lxix, LB ii.630.
[132] Horace, Satires, ii.ii.38 : « rarement estomac vide a dédaigné les mets vulgaires ». Bayle a interverti l’ordre du deuxième et du troisième mot : le texte porte raro stomachus.
[133] Horace, Satires, ii.ii.14-18 : « Quand la lassitude t’aura fait oublier tes ennuis, la gorge sèche, le ventre vide, je te défie bien de faire la fine bouche devant un plat médiocre et toute autre boisson que du Falerne sucré avec du miel de l’Hymette. Ton intendant est dehors, l’ouragan assombrit la mer et ne permet pas la pêche : du pain et du sel, voilà de quoi faire taire le cri de ton estomac. »
[135] Horace, Satires, ii.ii.20-22 : traduction, ii.38 r. Le scare est un poisson de mer, appelé aussi perroquet de mer.
[136] Sénèque, De la tranquillité de l’âme, xi.8 ; le vers de Publilius Syrus cité est très légèrement différent : « Cuivis potest accidere » (ce qui peut frapper l’un peut frapper n’importe qui).
[137] Horace, Satires, i.i.68-69 : « C’est Tantale altéré, essayant de boire l’eau qui fuit ses lèvres. »
[138] Térence, Andrienne, ii.i.330-31 : « J’estime, Charinus, que ce n’est pas le rôle d’un homme bien né, quand il ne rend aucun service, de réclamer qu’on lui sache gré ». Le texte actuel de la seconde ligne est légèrement différent : « nihil mereat postulare id gratiae poni ». La formule abrégée de Bayle à la fin de la citation désigne sans doute un recueil personnel (voir ci-dessus, n.72).
[139] Térence, Andrienne, ii.i.330-31 : « J’estime, Charinus, que ce n’est pas le rôle d’un homme bien né, quand il ne rend aucun service, de réclamer qu’on lui sache gré ». Le texte actuel de la seconde ligne est légèrement différent : « nihil mereat postulare id gratiae poni ». La formule abrégée de Bayle à la fin de la citation désigne sans doute un recueil personnel (voir ci-dessus, n.72).
[140] Il ne s’agit pas d’ Anaximandre, mais, sans doute, d’ Anaxarchus : voir Diogène Laërce, Vie des philosophes illustres, ix.59.
[142] Horace, Epodes, iv.7-10 : « Ne vois-tu pas que tu arpentes la Voie Sacrée avec ta toge de six coudées, que ceux qui t’y rencontrent détournent les yeux sans cacher leur indignation ? » Bayle, au second vers, écrit ter au lieu de trium.
[143] Horace, Satires, ii.iv.2-3 : « Bien supérieurs à ceux de Pythagore, de la victime d’Amytas [ Socrate] et du savant Platon. »
[144] Voir Quinte-Curce, Histoire d’Alexandre, v.i.12 : « On empêche les troupeaux de brouter l’herbe des terres riches et fertiles, de crainte qu’ils ne meurent de satiété. »
[145] Virgile, Enéide, i.736-39 : « [ Didon], ayant parlé, fit tomber sur la table les gouttes de la libation, et, la première, cette libation faite, elle effleura la coupe de ses lèvres, puis la donna à Bitias, en l’invitant vivement à boire ; lui, sans se faire prier, vida la coupe d’or écumante qui était pleine, en s’abreuvant largement. »
[146] Virgile, Enéide, i.736-39 : « [ Didon], ayant parlé, fit tomber sur la table les gouttes de la libation, et, la première, cette libation faite, elle effleura la coupe de ses lèvres, puis la donna à Bitias, en l’invitant vivement à boire ; lui, sans se faire prier, vida la coupe d’or écumante qui était pleine, en s’abreuvant largement. »
[147] Horace, Satires, ii.v.8 : « La naissance et le mérite sans la richesse valent moins que l’algue. »
[148] « Le semblable est sans action sur le semblable. »
[149] Bayle cite très exactement La Mothe Le Vayer, Discours de l’histoire (Paris 1638, 8 o), p.13-14 et Œuvres (Paris 1662, folio, 2 vol.), i.231-78 : Discours de l’histoire où est examinée celle de Prudence de Sandoüal, chroniqueur du feu roy d’Espagne, Philippes III, et évesque de Pampelune, qui a écrit la Vie de l’Empereur Charles Quint, i.233-34.
[150] La Mothe Le Vayer renvoie à Denis d’Halicarnasse, sans précision, et à Cornelius Nepos, au passage cité ci-dessous, n.147.
[151] Asinius Pollio, selon Suétone, Douze Césars, « Jules César », lvi.4.
[152] Asinius Pollio, selon Suétone, Douze Césars, « Jules César », lvi.4.
[153] « Jusqu’ici », en effet, Bayle a cité La Mothe Le Vayer, avec quelques coupures.
[154] Cornelius Nepos, Des grands généraux des nations étrangères, xxiii.xiii.2 : « cet homme si grand [ Hannibal], dont les guerres si importantes se partagèrent l’activité, trouva encore du temps pour les Lettres ; on a en effet des livres de lui, écrits en langue grecque, parmi lesquels un ouvrage adressé aux Rhodiens sur les hauts faits de Cn. Manlius Volso en Asie. »
[155] Horace, Satires, ii.i.77-78 : « Car [l’envie] croira mordre sur une proie facile à déchirer, mais elle la trouvera résistante. » Bayle ajoute au début Nam (car) pour introduire la citation.
[156] Horace, Epîtres, ii.i (à Auguste), 219-220, 224-28 : « En vérité, nous autres poètes, nous nous faisons souvent tort à nous-mêmes (je jette, tu le vois, des pierres dans mon jardin) […] ; nous déplorons qu’on ne se rende pas compte de la peine que nous avons prise pour tisser la trame délicate de notre poème ; nous espérons avoir la chance de t’entendre nous appeler avec bienveillance auprès de toi, dès que tu nous sais occupés à faire des vers, pour nous enrichir et nous obliger à écrire encore. »
[157] Horace, Epîtres, ii.ii.49-54 : « Abattu par la bataille de Philippes, je me traînai à terre, les ailes coupées, ayant perdu la maison et les biens paternels : c’est alors que l’audace de la pauvreté me poussa à faire des vers. Mais aujourd’hui que j’ai le nécessaire, quelle dose de ciguë pourrait me calmer, si je n’aimais mieux dormir que d’écrire ? »
[158] Horace, Odes, iii.xxvi.3-4 : « Aujourd’hui, mes armes et mon luth ont fini de servir, je vais les suspendre aux parois du temple. »
[159] Virgile, Bucoliques, ix.19-20 : « Qui désormais eût chanté les Nymphes ? Qui eût répandu sur la terre les herbes fleuries ? Qui eût couvert les fontaines d’une ombre verdoyante ? » Le texte de Bayle porte frontes (pour frondes ?) au lieu de fontis.
[161] Cicéron, Plaidoyer pour Murena, 8 : « Non, désormais, je n’ai plus le droit, je ne suis plus libre de ne pas consacrer mes efforts à la défense des hommes dans leurs périls. Car si l’activité d’orateur m’a valu des récompenses plus considérables qu’à aucun autre avant moi, renoncer après cela aux travaux qui me les ont procurées, ce serait agir en homme fourbe et ingrat. »
[162] Horace, Epîtres, i.xix.37-38 : « Je ne sais pas, par des invitations à dîner et le cadeau d’une tunique usée, capter une canaille inconstante et me mettre à l’affût de ses suffrages. »
[163] Perse, Satires, i.53-55 : « Tu sais servir une tétine de truie bien chaude, tu sais faire don à un pauvre qui grelotte à ta suite d’un manteau usagé et tu dis "J’aime la vérité, dites-moi la vérité sur ce que je suis." »
[164] C’est peut-être une allusion à la conversion de Bayle au catholicisme en mars 1669, qui entraîna une rupture avec sa famille, tandis que son retour au protestantisme, en août 1670, en faisant de lui un relaps, le mit sous le coup des lois françaises. Minutoli était l’une des rares relations de Bayle que celui-ci avait mises dans la confidence.
[165] Sur Denys l’Ancien, tyran de Syracuse (vers 430-367 av. J.-C.), Bayle suit Plutarque traduit par Amyot, Les Œuvres morales et meslées (Paris 1572, folio, 2 vol.), i.72 F-G : « De la tranquillité de l’âme et repos de l’esprit ».
[166] Jacques VI d’Ecosse (plus tard I er d’Angleterre) (1566-1625), His Majesties poeticall exercises at vacant houres (Edinburgh 1591, 4 o) contient The Lepanto of James the Sixth, king of Scotland : voir The Poems of King James VI of Scotland, éd. J. Craigie (Edinburgh, London 1955-1958), i.197-259.
[167] L’ouvrage cité ci-dessus, n.158, contient La Lepanthe de James VI roy d’Ecosse, faicte françoise par le sieur Du Bartas (Edinburgh 1591, 4 o) : voir The Works of Du Bartas, éd. U. T. Holmes, J. C. Lyons et R. W. Linker (Chapel Hill 1935-1940), iii.506-26. Du Bartas avait été envoyé à Edimbourg par Henri de Navarre, en 1587, pour négocier un éventuel mariage du roi d’Ecosse avec Catherine de Bourbon, sœur du Navarrais. Le mariage ne se fit pas, mais l’accueil réservé à Du Bartas fut très chaleureux : c’est assurément à cette occasion que Du Bartas traduisit du latin le poème de Jacques VI.
[168] Suétone, Douze Césars, « Auguste », lxxxv.2 : « On a d’Auguste un opuscule en vers hexamètres […] et un autre contenant des épigrammes, qu’il composait d’ordinaire en prenant son bain. »
[169] René Le Pays, sieur du Plessis-Villeneuve (1636-1690), poète badin et enjoué qui aura un article dans le DHC (« Pays »), se voulait successeur de Voiture. Les Nouvelles œuvres de Monsieur Le Pays (Paris 1672, 12 o, 2 vol.), ii.2, lettre xxvi (à M gr Du Gué, intendant de Dauphiné), mentionnent, p.298, Charles IX, qui écrivit à Ronsard « souvent en vers et en prose », et p.300-301, François I er . Bayle cite exactement Le Pays, si ce n’est qu’au lieu de « la Maistresse de Pétrarque » il écrit « la belle Laure ». Les autres références de Bayle nous demeurent impénétrables : voir notes 16, 18, 63, 72, 83, 185.
[170] Quintilien, Institution oratoire, x.i. 91-92 : « Je ne cite que ces poètes, parce que Germanicus Auguste a été détourné des travaux littéraires où il s’était engagé par le souci des affaires du monde et que les dieux n’ont guère trouvé suffisant qu’il soit le plus grand des poètes. Cependant, ces ouvrages mêmes qu’il avait entrepris dans sa jeunesse, après s’être écarté du pouvoir suprême, que peut-on imaginer de plus sublime, de plus savant, en un mot, de plus parfait à tous les égards ? Qui aurait mieux chanté la guerre que celui qui l’a faite comme lui ? A qui les déesses qui président aux lettres prêteraient-elles une oreille plus empressée ? A qui Minerve, sa divinité familière, aurait-elle plus ouvert ses arts ? Cela, les siècles futurs le diront mieux, car aujourd’hui ce mérite est éclipsé par l’éclat de toutes ses autres qualités. Mais tu nous permettras, à nous qui servons le culte des lettres, César, de ne pas le passer sous silence et de dire au moins avec Virgile : « Pour toi / Le lierre s’enlace aux lauriers du triomphe » ( Virgile, Bucoliques, viii.13).
[173] Nicolas Gastineau (1620-1696), aumônier du roi, Lettres de controverse à un gentilhomme de la religion prétendue réformée (Paris 1677, 12 o), dont le JS du 15 février 1677 rendit compte. L’ouvrage connut une suite en 1679 : La Grande controverse de la présence réelle de Jésus-Christ en l’Eucharistie, ou la suite des lettres à un gentilhomme de la religion prétendue reformée (Paris 1679, 12 o, 2 vol. présentés comme tomes ii et iii). Au tome iii, p.33-34, Gastineau cite Jean de Serres (1540-1598), frère cadet de l’agronome Olivier de Serres et lui-même pasteur et historien, auteur d’un Inventaire général de l’histoire de France depuis Pharamond jusques à Henri III. La première édition de cet ouvrage est de Paris 1597, in-12 o ; il fut mainte fois réimprimé et Gastineau renvoie à la p.74 de l’édition de Paris 1647, in-folio. Une fois de plus, on a ici la preuve palpable que, pendant des années, Bayle ajouta des références et des passages au texte initial de son brouillon de lettre à Minutoli : voir notes 73, 172 et 187.
[174] Louis d’Orléans (ou Dorléans) (1542-1629) fut avocat général dans le Parlement de la Ligue, mais se rallia finalement à Henri IV. Son ouvrage, Les Ouvertures des Parlements faictes par les roys de France tenant leur lict de justice, auxquelles sont ajoustées cinq remonstrances autrefois faictes en iceluy (Paris 1607, 4 o), fut saisi à sa parution sur l’ordre de l’ avocat général Séguier, mais réimprimé plus tard sans encombre. Bayle cite l’édition de Paris 1612, in-4 o, ch.14, p.247-48, où il est relaté que Robert le Pieux chantait au milieu du chœur des prêtres. Par ailleurs, nous conjecturons que la référence abrégée de Bayle « Rec. de serm. » désigne un recueil personnel : « recueil de sermone » ou peut-être « recueil de sermons » : voir aussi n. 85.
[175] Louis d’Orléans (ou Dorléans) (1542-1629) fut avocat général dans le Parlement de la Ligue, mais se rallia finalement à Henri IV. Son ouvrage, Les Ouvertures des Parlements faictes par les roys de France tenant leur lict de justice, auxquelles sont ajoustées cinq remonstrances autrefois faictes en iceluy (Paris 1607, 4 o), fut saisi à sa parution sur l’ordre de l’ avocat général Séguier, mais réimprimé plus tard sans encombre. Bayle cite l’édition de Paris 1612, in-4 o, ch.14, p.247-48, où il est relaté que Robert le Pieux chantait au milieu du chœur des prêtres. Par ailleurs, nous conjecturons que la référence abrégée de Bayle « Rec. de serm. » désigne un recueil personnel : « recueil de sermone » ou peut-être « recueil de sermons » : voir aussi n. 85.
[178] Virgile, Bucoliques, v.45 : « Tels sont tes vers pour nous, divin poète ».
[179] Homère, Iliade, ii.36 : « Agamemnon songe en son cœur à un avenir qui ne doit jamais se réaliser. »
[180] Horace, Epîtres, ii.i.197-198 : « C’est la foule, plutôt que les jeux, que [ Démocrite] regarderait avec attention, parce qu’elle lui fournirait plus de sujets d’observation que le mime. » Voir
[181] Horace, Satires, ii.ii.82-88 : « [L’homme sobre] pourra, en passant, faire parfois meilleure chère, au retour annuel des jours de fête, ou quand il voudra redonner quelque vigueur à son corps affaibli, ou encore, quand viendront les années et que la diminution de ses forces réclamera un régime plus doux. Mais toi, si, jeune encore et vigoureux, tu prends goût à ces douceurs, qu’y ajouteras-tu lorsque ta santé deviendra mauvaise et que la vieillesse te fera perdre ton activité ? »
[182] Gilles Ménage, Observations sur la langue françoise ; Bayle renvoie à la seconde édition (Paris 1675-1676
[183] Sénèque, Des bienfaits, vii.xxiii.1-2 : « Si l’hyperbole exagère, c’est pour arriver au vrai par le mensonge. Ainsi, celui qui dit “plus blanc que la neige, plus léger que les vents” a dit ce qui ne pouvait être, afin qu’on en crût le plus possible, et celui qui a dit “plus ferme qu’un rocher, plus rapide qu’un torrent” n’a pas imaginé qu’il persuaderait qu’un homme fût plus ferme qu’un rocher ; jamais l’hyperbole n’espère tout ce qu’elle ose : mais elle affirme l’incroyable, pour arriver au croyable. »
[184] Quintilien, Institution oratoire, viii.vi.76 : « L’hyperbole est donc une qualité lorsque la chose dont nous devons parler dépasse les limites naturelles. Il est permis, en effet, de dire plus, parce que nous ne pouvons dire autant qu’il faut et mieux vaut aller au-delà que rester en-deçà. »
[185] Cette historiette est tirée de Plutarque traduit par Amyot, Les Œuvres morales et meslées (Paris 1572, folio, 2 vol.), i.163 F : « Instruction pour ceulx qui manient affaires d’Estat ».
[186] Sénèque, Questions naturelles, iv (« De Nilo »), préface, 9 : « Nous sommes devenus insensés au point de taxer de malveillance celui qui ne nous loue que modérément. »
[187] Allusion à Molière, Le Misanthrope, acte i, vers 49-52, 69-72.
[188] Bayle reviendra à mainte reprise sur le thème de la citation : voir, par exemple, NRL, juin 1684, art.vi, et DHC, « Epicure », rem. E ; voir aussi le commentaire de Whelan, The Anatomy of superstition, p.101-103.
[189] Horace, Satires, ii.iii.234-237 : « Toi, tu dors tout botté dans la neige de Lucanie pour fournir à ma table un sanglier ; toi, pendant la tempête hivernale, tu me pêches du poisson. Je suis, moi, un fainéant, qui ne mérite pas de posséder une fortune. Tiens, prends un million de sesterces ; toi, autant ; toi, le triple. »
[190] Nicolas Boileau-Despréaux, Les Œuvres diverses du sieur D ***. Avec le traité du sublime ou du merveilleux dans le discours, traduit du grec de Longin (Paris 1674, 4 o).
[191] Horace, Odes, i.i.4-5 : le texte porte metaque et evitata : Bayle l’a adapté. Il s’agit de chars durant une course qui doivent « éviter que leurs roues brûlantes ne heurtent la borne ».
[192] Bayle ne délaissera pas cette vision morale de la satire : voir, par exemple, PDC, clxx ; Nouvelles lettres critiques, vi.i-ix ; Dissertation sur les libelles diffamatoires et DHC, « Alciat (Jean-Paul) », rem. D, « Erasme », rem. I ; voir aussi le commentaire de Whelan, The Anatomy of superstition, p.109-11.
[193] Horace, Satires, ii.i.54-55 : « Faut-il s’étonner que le loup n’attaque pas avec la patte et le bœuf avec ses dents ? »
[194] Horace, Satires, ii.i.23 : « en un temps où, même sans avoir été attaqué, chacun craint pour soi et déteste [le moqueur] ».
[195] Horace, Satires, ii.i.23 : « en un temps où, même sans avoir été attaqué, chacun craint pour soi et déteste [le moqueur] ».
[196] Cette référence nous demeure impénétrable : il s’agit sans doute d’un recueil personnel de Bayle.
[198] L’abbé Adrien Baillet, bibliothécaire de Lamoignon, avait publié Jugemens des sçavans sur les principaux ouvrages des auteurs (Paris 1685-86, 12 o, 9 vol.) : voir NRL, déc. 1685, art.ix. Les références de Bayle correspondent à la première édition du livre de Gilles Ménage, L’Anti-Baillet, ou critique du livre de Mr Baillet intitulé Jugemens des Savans (La Haye 1688, 2 vol in-12 o), i.79 : §25 : « Ignorance de Mr Baillet touchant Aristarque », et i.340 : §85 in fine : « Mr Baillet n’aiant jamais fait de vers n’est pas capable de juger des vers » : Ménage cite (i.340) l’épigramme de Martial ( Epigrammes, xii.lxiii.10-11) : « Corrumpit sine talione cælebs / Cæcus perdere non potest, quod aufert » (le célibataire séduit les femmes sans représailles possibles, un aveugle ne peut perdre la vue dont il nous prive), et commente : « Il est bien aisé de parler de l’art, mais il est difficile d’en parler selon l’art […] En un mot : je suis très-persuadé que Mr Baillet ne pourroit pas faire de si bons vers que les plus mauvais de ceux qu’il reprend. » Voir ci-dessus, n.73 in fine, un autre renvoi de Bayle à un ouvrage paru bien après la date de sa lettre, ce qui démontre qu’il a longtemps conservé son brouillon en mémoire et cherché à l’enrichir de références supplémentaires.
[199] Guilielmus Antonius Saldenus (1627-1694), pasteur et bibliographe néerlandais, De libris varioque eorum usu et abusu libri duo (Amstelodami 1688, 8 o) ; aux pages citées par Bayle, il est question d’Aristarque et on trouve une citation de Martial, Epigrammes, i.91 (et non pas 92 comme l’indique Bayle un peu plus haut) : « Cum tua non edas, carpis mea carmina, Laeli, / Carpere vel noli nostra, vel ede de tua. » (« Tu ne publies pas tes vers, Laelius, mais tu critiques les miens. Mets fin à tes critiques ou publie les tiens. ») Cette citation est probablement à l’origine de la mention que fait Bayle deux lignes plus haut.
[200] Horace, Epîtres, ii.i.150-152 : « Ceux que déchiraient, parfois jusqu’au sang, les méchants propos, se plaignirent ; même ceux qui étaient encore indemnes se préoccupèrent de l’intérêt général. »
[201] Horace, Odes, iv.iv.50-52 : « Nous ne sommes que des cerfs, proie assurée à la rapacité des loups ; sans y être contraints, nous nous acharnons contre des gens auxquels il nous suffirait de nous dérober et d’échapper pour mériter le plus beau triomphe. »
[203] La seconde Satire de Boileau est adressée à Molière, pour qui il avait aussi composé des stances flatteuses, « Sur la comédie de L’Ecole des femmes que plusieurs gens frondoient ». Les stances furent insérées dans le recueil Les Délices de la poésie galante des plus célèbres autheurs de ce temps (Paris 1663, 12 o) et publiées de nouveau dans les Œuvres diverses (Paris 1701, 4 o). La seconde Satire de Boileau, quant à elle, parut initialement dans le Nouveau recueil de plusieurs et diverses pièces galantes de ce temps (s.l. 1665, 12 o), et ensuite dans la seconde édition des Délices de la poésie galante (Paris 1666, 12 o) et dans les Satires du sieur D*** (Paris 1666, 12 o ; 2 e édition en 1667).
[204] Voir Boileau, Art poétique, iii.393-400 ; l’ouvrage parut dans les Œuvres diverses (voir n.180) en 1674, Molière étant mort en février 1673.
[205] Boileau a critiqué Scarron dans l’ Art poétique, i.79-90, et, par ailleurs, Scarron avait eu une querelle assez vive avec le frère aîné du poète, Gilles Boileau : voir E. Magne, Bibliographie générale des œuvres de Nicolas Boileau-Despréaux, et de Gilles et Jacques Boileau, suivie des lettres de Boileau. Essai bibliographique et littéraire (Paris [1928] 1929), ii.320-321, et, du même auteur, Scarron et son milieu (Paris 1924), p.273s, où il est fait état de 18 épigrammes de Gilles Boileau contre Scarron.
[206] Jean-François Sarasin [ou Sarrasin] (1615-1654) était entré en 1648 au service du prince de Conti ; poète badin, il était lié avec Scarron. Ses Œuvres (Paris 1656, 4 o) avaient été éditées par Ménage et sont suivies du « Discours sur les œuvres de M. Sarasin » par Pellisson ; l’anecdote citée par Bayle se trouve §xii, p.48-49 : voir aussi A. Viala (éd.), L’Esthétique galante (Toulouse 1989), p.66. En 1674, de Nouvelles œuvres de Sarasin (Paris 1674
[207] Horace, Epîtres, i.xv.28-30 : « [Maenius] était un bouffon parasite errant qui n’avait pas un ratelier fixe. A jeun, il ne savait pas distinguer un ami d’un ennemi, il tournait contre n’importe qui ses méchancetés et ses injures. »
[208] Horace, Epodes, vi.1-8 : « Pourquoi tourmenter des passants qui ne t’ont rien fait, chien lâche devant les loups ? Pourquoi, si tu l’oses, ne pas tourner contre moi tes vaines menaces et ne pas m’attaquer, moi qui te répondrais par un coup de dent ? Car, tel le molosse, ou, le chien fauve de Laconie, redoutables amis des bergers, je poursuivrai, l’oreille droite, à travers les neiges amoncelées, toute bête fauve qui fuira devant moi. »
[209] Horace, Epodes, vi.9-10 : « Mais toi, quand tu as rempli les bois de tes aboiements formidables, tu viens flairer l’os qu’on te jette pour te faire taire. »
[210] La première ligne est apparemment de Bayle et signifie « comme un homme foudroyé et frappé par le ciel », formule qui évoque peut-être l’emploi de fulgoritus par Sénèque, De la colère, iii.xxiii.6. La seconde ligne est tirée de Perse ( Satires, ii.27), Bayle substituant jaces à jacens : « gisant dans les bois sacrés, sinistre bidental à fuir ». Un bidental est une portion de terrain touchée par la foudre et consacrée par le sacrifice d’un jeune agneau.
[211] Ce terme grec, qu’on trouve dans Sophocle, désigne aussi bien une personne qu’a frappée la foudre que quelqu’un d’insensé, qui a perdu la raison.
[212] Le public de 1672 avait facilement reconnu Cotin dans le Trissotin (au début probablement appelé Tricotin) des Femmes savantes (Paris 1672, 12 o) de Molière. Bayle parlera de Cotin dans la RQP, i.xxix.
[213] Horace, Odes, i.xiii.5-7 : Bayle a substitué illi à mihi dans le premier vers : « Alors, et sa raison s’égare, et son visage change de couleur, et, sans qu’il s’en aperçoive, ses larmes coulent sur ses joues. »
[214] Bayle, revenu à Rouen, voyait alors cesser son « exil » à la campagne, à Lamberville, et pouvait de nouveau fréquenter des lettrés rouennais.
[215] Les troupes françaises : revenu à Rouen, Bayle a de nouveau accès aux nouvelles de la guerre. Peut-être désigne-t-il en particulier les "milices du Languedoc", et il penserait alors à des articles de la Gazette, où il avait pu lire, par exemple, les nouvelles de Perpignan du 9 juin 1674, dans n o 73, du 30 juin 1674 dans n o 83, et du 14 juillet 1674 dans n o 89.
[216] Voir Polybe, Histoire, xii.17-22, et La Mothe Le Vayer, Discours de l’histoire : où est examinée celle de Prudence de Sandoüal, i.231-78 : Bayle fait allusion à un passage p.233.
[217] Voir Polybe, Histoire, xii.17-22, et La Mothe Le Vayer, Discours de l’histoire : où est examinée celle de Prudence de Sandoüal, i.231-78 : Bayle fait allusion à un passage p.233.
[218] Plaute, Les Ménechmes, ii.i.247-248 : « Ne vaudrait-il pas mieux retourner chez nous, à moins que nous ne voulions écrire un jour l’histoire ? » Ces vers sont au reste cités par La Mothe Le Vayer dans l’article « Salluste » de son Jugement sur les anciens et principaux historiens grecs et latins, dont il nous reste quelques ouvrages, in Œuvres (Paris 1662, folio, 2 vol.), i.308.
[219] La Mothe Le Vayer, Jugement sur les anciens et principaux historiens grecs et latins, i.285-428 : sur Polybe, Bayle fait allusion à un passage p.308, et sur Salluste à un passage p.377.
[220] Voir Plutarque, Œuvres morales, i.6 D et E : « Comment il fault nourrir les enfants », où l’on trouve l’exemple d’ Archytas, et où Plutarque cite une attitude très similaire chez Platon. La référence à Archytas se retrouve chez Valère Maxime, Faits et dits mémorables, iv.1 : « Exemples étrangers », 1 : « Sumpsissem, inquit, a te supplicium, nisi tibi iratus essem » (je te châtierais, lui dit-il, si je n’étais irrité contre toi).